 Maison du Souvenir
Maison du Souvenir

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Comment nous rendre visite
-
Comment nous rendre visite
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Le comité
-
Le comité
-
![]() Nos objectifs
-
Nos objectifs
-
![]() Articles
Articles
![]() Notre bibliothèque
-
Notre bibliothèque
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Photos
-
Photos
-
![]() Signer le Livre d'Or
-
Signer le Livre d'Or
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
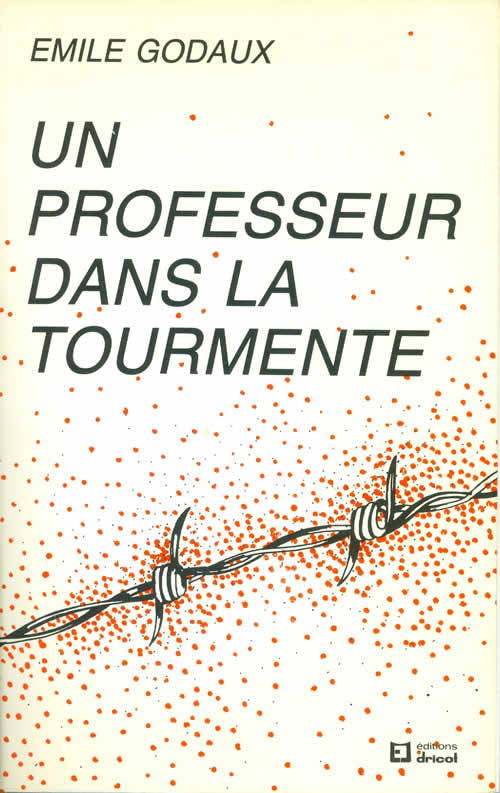

Emile Godaux, l'auteur. Emile Godaux est né à Namur, le 2 septembre 1911. Liégeois d'adoption depuis 1919, il habite successivement à Bressoux, Ougrée puis Alleur. Incorporé au 1er de Ligne à la Chartreuse, en 1934, immédiatement après ses études, il participe à la campagne des 18 jours au 29e de Ligne. Fait prisonnier au combat sur la dérivation de la Lys, le 27 mai 1940, il est envoyé, dans des conditions pénibles, au Stalag XVII B à Krems sur le Danube puis dans un Arbeitskommando, chez les Sudètes, à Hohenfurt (actuellement Vyssi Brod, en Tchécoslovaquie). Il rentrera en Belgique le 18 mai 1945. On trouvera ici le récit de ses aventures depuis la 1re mobilisation jusqu'à son deuxième séjour en Allemagne où il enseigna plus de vingt-quatre ans. Si ce livre comporte certains passages dramatiques, dont la narration d'événements réels rencontrés par l'auteur, il est cependant émaillé d'anecdotes savoureuses qui plairont au lecteur. La description de l'Allemagne des premières années après la guerre figure au dernier chapitre avec quelques détails sur l'occupation par l'armée belge et l'organisation de l'enseignement dispensé aux enfants des militaires. Un professeur dans la tourmente AVANT-PROPOS C'est longtemps après la guerre 1939-1945 que je me suis soudain décidé à raconter tout ce que j'ai vécu pendant cette période tragique. Certes, je ne fus pas un héros et je n'ai accompli que mon devoir. Je songe à mes camarades qui ont souffert dans les mines et les carrières, à ceux des camps de représailles, à ceux qui se sont évadés ou ont essayé de se libérer sans y parvenir, enfin à ceux qui sont revenus blessés dans leur cœur et dans leur chair. Je les admire tous et leur exprime mes sentiments d'amitié profonde. Le récit que l'on va lire est celui des aventures dont je me rappelle encore avec émotion. Il est écrit tout simplement et en toute sincérité. D'autres que moi ont déjà exposé leur cas et nombreux sont ceux qui pourraient nous parler de tout ce qui leur est arrivé. Tous les prisonniers de guerre sont méritants car on leur a enlevé, pendant un long laps de temps, un bien qui nous est très cher: la liberté. Je n'oublie pas non plus ceux qui se sont battus courageusement pendant la campagne des dix-huit jours et dont beaucoup y ont laissé leur vie. A eux aussi nous devons une infinie reconnaissance. Toute ma gratitude va également à mes compatriotes qui ont œuvré courageusement dans la résistance ou qui sont parvenus à rejoindre les armées alliées au prix de multiples difficultés, permettant ainsi la reconquête de notre patrie. CHAPITRE I LA MOBILISATION Faut-il parler de la première
mobilisation, de celle qui eut lieu en octobre 1938, en raison de la menace d'Hitler
sur les Sudètes ? Elle ne dura que huit à dix jours. Après nous avoir rassemblés sur les
hauteurs de la Citadelle de Liège, on nous conduisit dans nos cantonnements
provisoires. Mon régiment était le 25ème
de Ligne, dédoublement du 1er de Ligne caserné jadis à la
Chartreuse. On nous logea dans une école de la rue du Laveu
où je dormis dans une classe, couché sur l'estrade. Puis ce fut le départ vers Beaufays où je passai les nuits dans une villa, sur le
versant de la colline bordant l'Ourthe, aux environs de Sainval.
Pour tout lit, on ne m'accorda qu'un transatlantique de plage. Mais nous restions accrochés à la radio
et suivions la conférence des quatre grands de l'époque : Hitler, Mussolini, Chamberlin et Daladier, conférence qui se déroula tout
d'abord à Bad Godesberg, au Petersberg, endroit que j'eus maintes fois
l'occasion de visiter quand je fus désigné après la guerre pour enseigner à
l'athénée Royal de Rôsrath, près de Cologne, pendant
vingtquatre ans, puis ensuite à Munich où l'on tomba d'accord pour dépecer la
Tchécoslovaquie. C'est avec un cri de joie que nous
apprîmes le résultat heureux de ces discussions, persuadés que la guerre était
écartée pour longtemps. Et ce fut le défilé, à Beaufays, devant les enfants des écoles agitant des drapelets,
comme si nous avions remporté la victoire. On nous ramena à l'école communale de la
rue du Laveu où après quelques jours nous fûmes
démobilisés. Une anecdote mérite d'être mentionnée.
Lors de l'appel du dimanche soir, un jour avant notre mobilisation, beaucoup
d'hommes manquaient à l'appel dans cette école. Et l'adjudant de service de
demander aux sergents : « Allez à Liège et ramenez-moi tous les manquants ! »
C'était justement la foire ! La
seconde mobilisation fut évidemment « la vraie » ! Depuis plusieurs mois, l'Allemagne avait
rompu les accords sur la Tchécoslovaquie et occupé ce pays. Elle menaçait
Dantzig et la Pologne. Le pacte germanosoviétique fut signé, à la stupeur générale,
fin août 1939, au moment où Liège vivait en pleine euphorie en raison de la
très belle exposition internationale de l'eau. 
Notre « home » dans l’abbaye d’Hohenfurth Je me trouvais, à cette époque, en
vacances à la Panne, Hôtel Excelsior, comptant y rester une dizaine de jours. Hélas
! le 25 août fut déclenchée la phase A de la
mobilisation. Cela ne me concernait pas encore mais je m'attendais à être
rappelé d'un jour à l'autre. Et le lundi 28 août 1939, des affiches annonçant
la phase B, je dus regagner Liège. Déjà à Bruxelles-Nord, la gare était remplie
de militaires. L'atmosphère annonçait un danger de guerre. Rentré chez moi, j'appris par ma voisine
que l'on était venu, aux petites heures, m'apporter mon « ordre de rejoindre ».
Je dus me rendre à la gendarmerie de Grivegnée pour le récupérer et, tard dans la soirée, je
pris le tram pour Ans où se trouvait mon unité. Chaque fois que je passe devant
cette petite place qui fait face à la Grand-Place appelée « Ferdinand Nicolay », je revois mon arrivée au « Cercle Saint-Martin »
où je logeai, vu l'heure tardive, sur les sacs entassés dans ce que l'on
appelle à l'armée « le magasin ». Les trains passant constamment derrière ce
bâtiment me faisaient regretter la mer et les vacances. Et c'est sur cette petite place qu'on
nous rassembla plusieurs fois ; comme sergent, je dus « jouer à l'habilleuse »
ainsi que me le proposait un sous-officier de carrière. Je retrouvai « mes » soldats du
temps de mon service militaire et nous faisions partie du 29ème de
Ligne. Après deux jours, nous quittâmes cet
endroit où ma mère et ma sœur étaient venues me voir, pleines d'espoir,
persuadées que tout cela n'était que temporaire. Nous ne descendîmes pas la côte d'Ans où
j'avais été impressionné par un militaire portant le drapeau du 29ème
de Ligne devant l'endroit où est situé actuellement le bassin de natation, mais
c'est par une série de petits chemins qu'on atteignit Seraing. Notre unité s'installa tout d'abord à
l'école communale de la Troque, école aujourd'hui désaffectée. C'est là que
nous apprîmes, le dimanche 3 septembre, l'entrée en guerre de l'Angleterre puis
de la France. J'errai comme une âme en peine dans les rues désertes. Le lendemain,
notre commandant, un réserviste assez âgé, nous adressa quelques mots dans la
cour de l'école, nous faisant espérer que notre pays resterait neutre comme en
1870. 
A une époque où nous étions encore pleins d’espoir La rentrée des classes devant
s'effectuer le 11 septembre, notre compagnie libéra les lieux et s'installa à
Val Saint-Lambert. Une maison vide fut réquisitionnée pour le bureau et le
magasin ; les soldats furent logés à la « maison du peuple », face à la gare.
Au moment où j'écris ces lignes, je viens de constater que cette dernière a
disparu. En outre, toute une rangée de maisons qui l'encadraient a été
complètement rasée. Ce quartier qui était en 1940 une ruche bourdonnante, et
qui continua à l'être plusieurs années après la guerre, est maintenant un
endroit impersonnel, sans intimité mais il est loin d'être un désert: une
magnifique route le traverse. Signe des temps ! Beaucoup de demeures
ont dû être sacrifiées pour améliorer la circulation routière. Lorsque l'on vient de Liège, avant
d'entrer dans le centre de la localité, en face de ce qui fut le train « Decauville
», la maison où se trouvaient le bureau de notre compagnie, le « magasin », le
mess des sous-officiers, est toujours debout, inoccupée, mais les fenêtres aux
boiseries vertes sont maintenant obturées par des planches. Cela laisse
supposer que tôt ou tard la démolition en sera décidée. Elle porte encore le N°
19 et un signe d'arrêt de bus. La population accueillit avec grand cœur
tous les militaires qui vécurent le plus long moment de leur mobilisation dans
cet endroit où beaucoup de gens leur donnèrent asile, adoucissant ainsi
l'éloignement subi par ces soldats ayant quitté leur famille. La plupart étaient néerlandophones
puisque l'on avait groupé en un seul régiment les bataillons des unités bilingues.
Et à cette époque, l'on ne connaissait pas encore nos difficultés linguistiques.
On ne faisait aucune distinction entre les uns et les autres pour que tous se
sentent comme chez eux. Pour ma part, je trouvai une chambre
avec petit déjeuner chez de braves gens, aux environs de notre cantonnement. Et les travaux défensifs commencèrent.
Creusement de tranchées du côté Nord de la rue Basse-Marihaye,
près d'un terril et donc au-dessus du Val Saint-Lambert. C'est là que l'alerte du 11 novembre
1939 nous surprit. Il fallait creuser et le lieutenant Huque m'arrêta, ou
plutôt me demanda de faire arrêter les travaux lorsque nous atteignîmes la rue.
« Une cartouche de dynamite, dit-il, ferait sauter le morceau restant, en cas
de nécessité ». Ce fut donc une première alerte, puis
après environ deux mois de travail devant ce que l'on appelait les éléments C (Cointet), sortes de grandes barrières formant ceinture
entre les forts de Liège, on nous déplaça pour aller creuser de nouvelles
tranchées, en plein bois, dans le domaine de Billancourt, tout en gardant nos
quartiers aux environs de la gare du Val Saint-Lambert. On fêta la Noël dans la « salle de la
maison du peuple » et l'on me demanda même de jouer du piano au cours du
banquet. Des congés de cinq jours avaient été
établis et on pouvait les scinder; c'est ce que je fis. Je regagnai ma famille
à Robermont certains soirs et le dimanche avec une
permission de minuit ou en me mettant en civil. 
La région autour de VYSSI BROD ( Hohenfurth) La deuxième alerte, le 15 janvier 1940,
causée par l'atterrissage forcé d'un avion allemand à Mechelen-sur-Meuse, nous
obligea à rester sur le terrain, dans le froid, jour et nuit. On nous apportait
du vin chaud sucré et notre « pique-nique » se déroula pendant longtemps dans
des wagons du vicinal se rendant à Clavier, ceux-ci étant chauffés par un vieux
poêle à boulets. Heureusement nous ne passâmes que deux nuits à la belle
étoile, dans la neige. Des bruits couraient au sujet d'un
départ en train vers Ostende pour une période de repos. Mais ils furent
démentis et le 11 février, nous quittâmes Val Saint-Lambert à pied pour nous
rendre à Hermalle-sous-Argenteau, près de Visé. La troupe s'établit dans les
salles des fêtes « Au Cheval blanc » et au « Cercle catholique ». Je trouvai une chambre au
rez-de-chaussée de la rue principale d'Hermalle-sous-Argenteau, un vrai salon
donnant sur celle-ci avec un lit et... un piano. La maison appartenait à un
adjudant. Lors de mes soirées, je me perfectionnais en néerlandais car je
faisais partie d'une unité flamande et puis, avant d'être mobilisé, je donnais
cinq heures de cours de cette langue dans un collège de Liège. Quel fut le rôle de la troupe en cet
endroit ? Dresser un réseau de fils de fer barbelés tout le long de la Meuse !
Je fus aussi planton au téléphone parfois, ce qui me permit, comme je l'avais
déjà fait dans le bureau au Val Saint-Lambert, de lire des revues pédagogiques
et aussi de nombreux romans. C'est là que nous vîmes arriver le
printemps et qu'on nous fit les piqûres antitétaniques et antityphiques.
Déjà à Val Saint-Lambert, on avait fait
un appel aux candidats pour aller en France, au D.R.I. (Division de réserve
d'infanterie). Mais ce fut mon ami, un instituteur de Bruxelles qui fut choisi.
Sans doute le commandant de ma compagnie avait-il cru que je désirais rester
près de ma famille. Mon camarade ne participa pas à la campagne des dix-huit
jours et ne fut pas prisonnier. Notre régiment ne resta que six semaines
à Hermalle-sous-Argenteau puis partit pour Flémalle. Ici la vie fut plus
pénible car nous devions garder deux ponts, celui du Val Saint-Lambert et celui
d'Ivoz-Ramet. On était constamment de garde ou de
semaine. La troupe logeait dans la salle des fêtes des « Tubes de la Meuse » et
j'obtins une chambre chez de braves gens qui tenaient un magasin de vélos.
C'est à ce moment que je débutai l'étude de l'anglais et lorsque j'étais de
garde aux ponts, n'ayant pas l'autorisation de dormir, je passais toute la nuit
à me donner des cours de cette langue. L'usine avait mis à la disposition des
sous-officiers une salle pour le mess. C'est à Flémalle que nous suivions la
résistance de la Finlande et que nous apprîmes l'invasion du Danemark et de la
Norvège. Cette fois, on sentait que notre tour viendrait, mais on ne voulait
pas y croire. 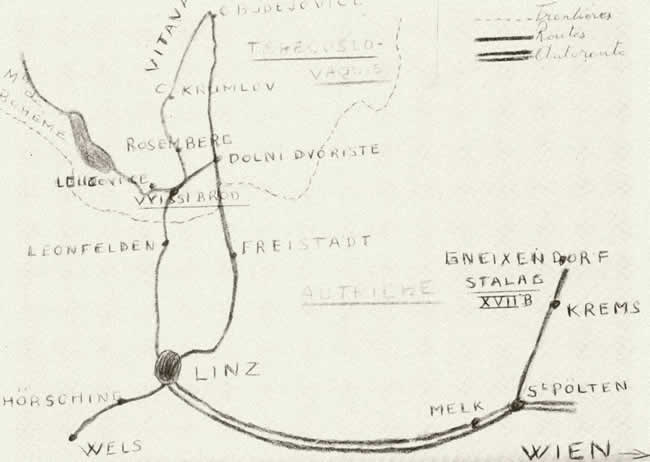
Situation DE VYSSI BROD par rapport à l’Autriche et à la Tchécoslovaquie A l'occasion des différentes alertes, je
devais, armé d'un pistolet G.P., contrôler l'identité des gens qui traversaient
les deux ponts et établir une fiche pour les étrangers. C'est dans ce fameux « Blokhaus » qui gardait le pont d'Ivoz-Ramet
que j'appris, un dimanche où j'étais de garde, que nous partions le mardi pour
une période de camp à Beverloo. Descendant de garde
le lundi à 13 heures, j'eus tout juste le temps de retourner chez moi à Robermont pour dire au revoir à ma mère et à ma sœur et
prendre quelques objets. Et ce fut le départ, à pied, la nuit du
mardi au mercredi. On devait atteindre le camp en trois jours. Comme beaucoup
n'étaient plus habitués à la marche, le nombre des éclopés augmentait et l'on
dut réquisitionner les fameux trams à vapeur du Limbourg. Mais je tins bon et j'arrivai sans
encombre à Leopoldsburg. Et les exercices d'une période de camp recommencèrent.
Les sous-officiers avaient des chambres à deux lits, assez confortables avec
bassin pour se laver. C'était le printemps et la bruyère commençait à fleurir
mais le sable était toujours là et l'on sait si c'est désagréable de marcher
constamment dans un sol sablonneux. Comme j'étais un des rares à avoir « tenu
le coup » pour la marche, on me proposa de partir le premier en permission. Je
refusai car le 12 mai, dimanche de la Pentecôte, je devais assister à une
communion solennelle à Sainte-Foy, à Liège. Je le regrettai plus tard puisque
les Allemands ayant attaqué le 10 mai, je ne pus revoir ma famille avant cinq
longues années. De plus, je n'avais presque pas d'argent et, pendant la
campagne des dix-huit jours, pour manger, il fallait payer. Le 9 mai au soir, après l'exercice, nous
vîmes un avis affiché au tableau de la compagnie: « Le Roi allait assister à
une démonstration de tir réel le 10 mai après-midi et nous devions, comme
spectateurs, porter la capote avec ceinturon et être casqués ». Une journée
reposante se profilait à l'horizon. Cela promettait d'être intéressant. Le
soir, dans notre chambre, nous apprîmes que les permissions de cinq jours
étaient rétablies alors que nous ne pouvions bénéficier que de deux depuis la dernière
alerte. Rien n'était encore officiel mais le bruit causé par cette bonne
nouvelle m'empêchait de dormir; je me demandais si j'allais scinder mon congé. Soudain vers trois heures, le clairon se
mit à sonner l'alerte. Dans cette circonstance, il fallait s'équiper comme pour
partir au combat. C'est ce que nous fîmes en espérant qu'il s'agissait, comme
d'habitude, d'un simple exercice. Nous dûmes abandonner les bâtiments du
camp de Beverloo et attendre au-dehors. Déjà l'on
signalait que la frontière hollandaise était violée et que les Pays-Bas étaient
bombardés. Vers cinq heures apparurent dans le ciel
encore sombre, une multitude de points lumineux : c'était l'aviation allemande.
Le départ fut donné et l'on quitta le camp. La guerre commençait. CHAPITRE II LA CAMPAGNE DES DIX-HUIT JOURS. On espérait encore que ces avions qui
survolaient en masse notre pays allaient simplement attaquer l'Angleterre. Mais
de multiples bruits couraient : la gare de Jemelle
aurait été bombardée et l'aérodrome de Schaffen
aurait été fort endommagé. C'est au pas, précédés par une clique de
clairons, que nous quittâmes Leopoldsburg et nous éprouvâmes une grande
satisfaction en franchissant un pont du canal Albert qui n'avait pas encore
sauté. 
L’auteur en captivité. Nostalgie… A la première halte horaire, des avions
nous survolèrent et nous nous abritâmes dans des caves. Avant de repartir, nous
reçûmes quelques fleurs que des jeunes filles arrachaient dans leur jardin. Le baptême du feu survint quelques
instants après. Un avion volant bas fonça sur nous, tira quelques rafales et
nous eûmes tout juste le temps de nous coucher à côté de la route, dans un
petit bois de sapins. C'est là que je perdis mon masque à gaz qui ne fut jamais
remplacé. Il faut signaler qu'au départ du camp de
Beverloo et d'ailleurs pendant toute une partie de la
campagne, nous étions chargés comme des mulets ! Outre notre fusil, notre
baïonnette, notre pelle ou notre pince coupe-fil,
notre masque à gaz, notre besace, nous portions sur le dos un sac rempli de
linge et supportant une couverture, une toile de tente et une paire de gros
souliers. Les bretelles de ce sac nous sciaient littéralement les épaules et
l'on se demande, encore de nos jours, comment on peut faire la guerre dans de
telles conditions. De plus nous étions fort vêtus : casque, gros pull-over et
capote épaisse. Quand on songe que les Allemands étaient
transportés par camions et ne portaient qu'un simple uniforme, qu'ils pouvaient
facilement exécuter tous les mouvements comme manipuler un fusil ou un
lance-grenades, on se demande pourquoi l'on n'avait pas pris exemple sur eux
puisque la campagne de Pologne avait pu fournir certains renseignements. Nous dirigeant vers l'Ouest, nous
arrivâmes en fin d'après-midi à Testelt près d'Averbode où, harassés, nous pûmes nous coucher dans une
grange, faisant un grand trou dans la paille pour nous réchauffer et connaître naître
un repos bien mérité après une longue journée de marche et une nuit d'insomnie.
Hélas ! tout
cela fut de courte durée et, au milieu de la nuit, ce fut le rassemblement pour
un nouveau départ. Dans la campagne calme et silencieuse on se serait cru en
temps de paix si, de temps à autre, le ronronnement d'un avion allemand ne nous
avait ramenés à la réalité. Ce dernier lançait des fusées éclairantes et le
paysage s'illuminait comme en plein jour. Nous atteignîmes Begijnendijk où nous
pûmes nous reposer toute la journée. La population vaquait normalement à ses
occupations, bien qu'on signalât, dans un café, que la gare d'Aarschot avait
été bombardée. De temps à autre, un avion ennemi rasait littéralement les toits
des maisons, se limitant à une action de reconnaissance. Et à la tombée du jour, on partit cette
fois en direction de Wavre Notre-Dame, près de Putte. Là se trouvait la ligne
KW, deuxième élément de défense du pays, avec des éléments Cointet,
ces barrières bien connues que les Allemands détruisaient au chalumeau. On appelait
ces positions des « tranchées préparées ... à l'avance » et il n'y avait que
des petits trous de cinquante centimètres de profondeur. 
Quelques membres de notre « Arbeitskommando » Nous étions le 12 mai, fête de la
Pentecôte et un radieux soleil nous inondait de ses rayons bienfaisants. C'était le printemps dans toute sa
splendeur et parfois l'on croyait rêver. Et c'est là que ceux qui avaient eu le
bonheur de connaître une dernière permission nous rejoignirent. On leur
distribua un fusil mais ils durent faire tout le restant de la campagne en
tenue de sortie et en bonnet de police. Je ne puis me rappeler combien de fois,
en tant que sergent chef d'un groupe de combat, il me fallut établir la liste
des objets manquants pour chaque homme. Et jamais l'on ne donna suite à cet
inventaire. On nous avait signalé aussi que le camp de Beverloo
ayant été bombardé, on avait dû jeter dans le canal Albert les sacs bleus
contenant nos objets personnels. Nous restâmes quelques jours à Wavre
Notre-Dame et, derrière les tranchées que les soldats s'activaient à creuser le
plus profondément possible, se dressait une maison récemment abandonnée mais
entièrement meublée et qui nous offrait un abri temporaire pour nous restaurer
et nous procurer les soins de toilette. Parfois le propriétaire venait converser
avec nous. Pour la nourriture, il fallait se contenter du pain et du beurre que
les bonnes sœurs du couvent situé derrière nos positions voulaient bien nous
faire .parvenir. A Wavre Notre-Dame se livra notre
première bataille. Le lundi 13 mai fut calme et permit à nos hommes de
consolider nos positions. Mais le lendemain déjà, les Allemands approchaient et
un général venu en inspection cria : « Je veux voir les hommes avec le fusil et
non avec une pelle ». De toutes parts on tirait et l'on ne
voyait rien. Notre chef de peloton nous déclara, qu'étant monté au sommet de la
tour de l'église, il avait aperçu les Allemands. Sur notre aile gauche apparut un char
allemand qui dut se retirer sous le tir des soldats du 14ème de
Ligne. Et sur le parapet de notre tranchée, on entendait siffler les balles.
Notre premier sergent devait se baisser pour venir nous trouver afin de nous
communiquer les ordres. Ceux-ci étaient rares et ne nous donnaient aucun renseignement
sur les événements. Il s'agissait souvent du fameux inventaire sur la situation
en linge et en vêtements. Mais un soir, un ordre nous enjoignit de nous laver
les pieds et de graisser nos chaussures, ce qui nous fit comprendre qu'une
nouvelle retraite se préparait. Le front était à nouveau percé. Et en effet, le mercredi 15 mai, en
pleine nuit, pendant que le tir faisait rage dont celui d'une pièce d'artillerie
placée derrière nous, l'adjoint au chef de peloton me donna l'ordre suivant « Nous
sommes encerclés et il faut nous retirer, aussi, en partant, tes derniers hommes
doivent tirer ! » 
En promenade le dimanche après-midi Un remue-ménage se produisit dans la
tranchée parce que deux soldats qui s'étaient endormis nous coupaient la
retraite et nous empêchaient de suivre l'adjoint au chef de peloton. Que faire ?
J'étais seul avec cinq ou six hommes et il me fallait prendre mes responsabilités.
Nous nous réfugiâmes dans la maison dont j'ai parlé plus haut, croyant trouver
un bon abri dans la cave. « Mais nous allons être faits
prisonniers, me dis-je, il faut sortir d'ici ! » Heureusement, je possédais une boussole,
et, quelques jours auparavant, j'avais repéré la direction de Malines, ville la
plus proche où devait se trouver l'état-major de division. Je pris la tête de
mon petit groupe et nous traversâmes des prairies, sautant au-dessus des
barrières. Ici un incident se produisit. Marchant en file indienne, tous se
fiaient à moi et soudain dans l'obscurité, je vis une forme bouger ! Je
m'arrêtai brusquement et me retournai, blessant le soldat qui me précédait,
avec le bord de mon casque. Il s'agissait tout simplement d'une paisible vache
qui avait quitté le pré. Poursuivant notre retraite à travers
champs et prairies nous entendîmes enfin le bruit du charroi de l'arrière-garde
de notre régiment. Nous étions sauvés ! Et la retraite continua. J'ai appris
récemment par mon chef de peloton rencontré lors d'une réunion d'anciens
élèves, que des autos-mitrailleuses françaises nous avaient relevés et que
cette unité avait été décimée par un intense bombardement. La traversée de Malines, déserte, se fit
sans encombre et nous arrivâmes à Kappelle-op-den-Bos
puis à Ramsdonk où nous fûmes surpris par un
bombardement au moment où un colonel voulait que nous nous alimentions à une
cuisine roulante. Il exigeait même que nous franchissions la zone bombardée, au
pas de gymnastique, comme on le faisait en 14-18. Mais personne ne mangea et,
conduits par un lieutenant de l'active que j'avais eu comme chef au début de la
mobilisation, nous contournâmes l'endroit dangereux. « Sauvons notre peau »
nous déclarait-il. J'avais perdu ma compagnie et nous
n'étions plus qu'une poignée d'hommes marchant dans une colonne d'artillerie.
Fatigué, je m'assis sur un caisson, derrière un canon tiré par des chevaux et,
si mes jambes se reposaient, tout mon corps était secoué tellement la route
était mauvaise. Je repris rapidement la marche et, avec
mes soldats, nous circulions la nuit et une partie de la matinée pour nous
reposer parfois dans une prairie, le long d'une haie ou dans un bois. Mais nous
ne parvenions jamais à dormir. Déjà à Wavre Notre-Dame, on nous avait dit
d'abandonner les objets lourds et surtout notre havresac. Nous parcourûmes ainsi la distance qui
nous séparait de Malines à Gand en évitant les agglomérations et nous arrivâmes
dans les environs de cette dernière ville où, après avoir franchi le pont du
canal de Gand à Terneuzen, notre compagnie fut reconstituée. 
Le lac gelé dont il fallait extraire la glace Il faut signaler que pendant cette
marche à travers une grande partie de la Belgique, nous ne fûmes jamais
survolés par d'autres avions que des avions allemands. Pendant la campagne, je
ne vis aucune fois un avion anglais ou français. Notre défense terrestre
s'acharnait à tirer sur les avions ennemis sans les atteindre et une fois, en
marchant en colonne l'un derrière l'autre, à la distance réglementaire de trois
mètres cinquante, un fragment d'obus de cette défense contre avions vint tomber
près de moi, à un mètre de mon dos. Je me retournai et ne vis plus rien
tellement ce fragment était profondément enfoui dans le sol. J'avais été miraculeusement
épargné. Vers le 20 mai, notre régiment se
déploya en défensive, derrière le canal de Gand à Terneuzen, entre Evergem et Terdonck. Nous faisions face à un talus où se dressaient
les grands réservoirs à essence de la société Saint-Clair. Et là, nous devions rester plusieurs
jours. Les soldats se mirent à creuser des tranchées et à les recouvrir de tôles
pour se protéger. Précaution et protection illusoires ! Nous étions placés à
côté d'une ferme où, de temps à autre, nous pouvions obtenir deux œufs sur le
plat pour cinq francs. C'était un léger baume sur nos plaies morales car ces
retraites continuelles et cette perspective d'avoir bientôt à nous battre n'étaient
pas du tout réjouissante. On ne savait pas grand-chose
des événements. Nos gradés nous répétaient que l'on allait bientôt capituler ;
après cinq jours la Hollande avait déposé les armes et les Allemands venaient
d'atteindre Abbeville ; bref nous étions cernés. D'ailleurs des avions ennemis
lancèrent des tracts où une petite carte montrait la situation avec un avis
disant que nos chefs allaient s'enfuir par avion. Une seule fois nous parvint un
communiqué signalant que les Français avaient lancé à Gand une contre-attaque «
qui n'avait pas été sans succès » et que notre artillerie bombardait Terdonck. En cet endroit, on attendit quelques
jours. Une patrouille de volontaires traversa le canal puis vint faire son
rapport : « elle n'avait rien remarqué ». Vers le 23 mai, nos positions furent
bombardées par l'artillerie ennemie et plusieurs de ses obus percèrent les
réservoirs à essence, ce qui affola nos camarades de première ligne qui, pris
de panique, reculèrent. On les obligea à retourner sur leurs positions. Pour la première fois, la pluie se mit à
tomber et les fumées des réservoirs retombant sur nos visages, les noircirent
complètement. Le front fut percé une fois de plus et
l'on nous proposa une contre-attaque. Pendant la distribution des munitions, le
lieutenant Huque, mon premier chef de peloton à la mobilisation, me dit : « Godaux, cette fois c'est pour de bon ! » Il devait être tué
le 28 mai en se défendant courageusement avec plusieurs officiers de notre
bataillon. Il fallait avancer dans les buissons, en direction de Terdonck et l'on dut même reculer car nos petits canons de
4,7 tiraient trop court et nous étions en danger. Après être restés cachés dans la nature,
nous reçûmes l'ordre de repli. On repartit en direction de Zomergem. J'ai
toujours conservé cette image représentant la campagne autour de Terdonck et quand, prisonnier cette fois, je repassai en ce
lieu, les réservoirs fumaient toujours ; le long du canal, des tombes avaient
été creusées avec comme seul ornement un casque reposant sur une baïonnette.
C'étaient des tombes belges. On voyait dans chaque casque le trou creusé par la
balle ennemie. 
L’hiver pénible dure 7 mois La traversée de Zomergem se fit sans
encombre et le 25 mai nous étions aux environs d'Ursel.
A la tombée du jour, le régiment se mit en route vers cette localité. Soudain
un sifflement caractéristique se fit entendre; d'un bond, nous sautâmes dans le
fossé au bord de la route. Quelques obus tombèrent à côté de celle-ci; il y eut
des blessés et, paraît-il, quelques tués. J'étais tellement nerveux que je
serrais de mes mains les bottes du médecin terré devant moi. Puis l'on repartit et il nous sembla
que, des fenêtres d'une maison, on lançait des signaux lumineux. On s'arrêta
dans un bois, aux environs d'Oostwinkel. C'est en cet endroit que se passa la
journée du dimanche 26 mai. La nature était si belle et, couchés parmi les
floraisons printanières, nous avions par moments l'impression que la guerre
avait cessé. Mais des avions allemands nous survolaient de temps à autre et nos
canons de 4,7, ne les atteignaient jamais. Un avion belge, volant bas, apparut
au-dessus de nos têtes et tous les soldats se mirent à applaudir car c'était le
premier que l'on voyait. Sans doute allait-il effectuer quelque reconnaissance ?
Nous avions appris que dès le premier jour de la guerre notre potentiel aérien
avait été détruit au sol. Et ici, on ne comprend pas ! On avait pourtant disposé
de beaucoup de temps pour se préparer à une attaque éventuelle. Dans un coin du bois, telle une étagère
de bibliothèque, la réserve de grenades semblait attendre une utilisation qui
ne vint jamais. Peut-être avait-on peur des accidents, d'une maladresse
probable ? Elles n'auraient servi qu'en cas d'offensive mais les nombreuses
retraites, les bruits de capitulation en raison de l'encerclement de nos forces
avaient certainement détruit le moral de toute l'armée. A nos côtés, une batterie d'artillerie
faisait un vacarme épouvantable et, à l'état-major de bataillon, on avait dû
placer des bandelettes de papier aux fenêtres ouvertes. Cet état-major se
tenait dans une petite maison abandonnée où il fallait aller se ravitailler. Il
faut rendre hommage à notre colonel qui venait en side-car jusqu'à la ligne de
front et nous ordonnait de nous éparpiller. La solde ne fut pas payée; le
sous-officier payeur à qui on la demanda répondit qu'il n'avait que de gros
billets. Imprévoyance ! Dans l'après-midi du dimanche 26, un avis parvint à notre commandant de compagnie: « Tout mouvement de troupe devait être arrêté ». Et la nuit se passa dans le bois. Pendant que nous étions couchés ou assis sur des feuilles humides, dans des conditions telles qu'il était impossible de se reposer, notre artillerie se mit à tirer sans relâche. A l'aube, l'ordre de s'ébranler arriva. La classique préparation d'artillerie nous avait convaincus que la grande contre-attaque se préparait. On avançait lentement en file indienne et soudain un tireur isolé entra en action. « Continuez, ordonna notre commandant, il tire à pouf ! » Parvenus à quelques centaines de mètres de la lisière, notre surprise fut grande. De part et d'autre de la route, des fusils étaient abandonnés. Un blessé nous demanda s'il y avait un médecin parmi nous. Une compagnie entière s'était rendue 

Notre premier Noël en captivité « On va bientôt voir les Allemands » me dit un collègue. Et c'était vrai. Nous étions à peine arrivés à l'orée du bois que nous aperçûmes des cyclistes ennemis qui s'avançaient paisiblement vers nous. Ils étaient à une distance de cinq cents mètres environ. C'est alors qu'un soldat du groupe voisin (je commandais le premier groupe), pris de panique, se mit à tirer en l'air, ce qui eut pour effet d'arrêter les Allemands qui se couchèrent puis se mirent à courir en diagonale pour atteindre le bois et nous attaquer sur le flanc. Notre armée possédait des petits chars T 13 conduits par deux hommes dont un officier. Ce dernier, commandant l'unique char qui nous protégeait demanda à être flanqué de deux groupes de combat. Et ici se produisit une grave erreur. L'adjoint au chef de peloton nous donna l'ordre de sortir du bois et de nous déployer dans un champ labouré, sans le moindre couvert, sans la moindre fosse. Quelle cible ! Ce fut pour moi un moment d'intense émotion. L'ennemi caché derrière les buissons, à deux cents mètres de nos lignes, commença à tirer sur nous. Il ne nous restait qu'une chose à faire : nous terrer le plus possible. Je grattai le sol avec mes ongles; les balles sifflaient autour de ma tête et l'une d'elles ricocha sur l'extrémité de mon soulier. Puis les Allemands lancèrent des grenades avec leurs « Minnenwerfer », engins que nous ne possédions pas. Il faut reconnaître qu'on nous jetait dans la bataille sans nous avoir donné le moindre renseignement et aussi avec des groupes de combat incomplets, certains dépourvus de l'arme principale: le fusil mitrailleur. Notre petit char T 13 reçut un obus de plein fouet et recula dans la forêt. Un avion ennemi nous survolait sans cesse et nous étions bien seuls. Personne ne s'occupait de nous alors que nous aurions dû être soutenus. Plusieurs de mes hommes qui avaient osé lever la tête pour tirer ou voir ce qui se passait furent tués et parmi ceux-ci mon caporal fusilier. Un de mes soldats atteint d'une balle dans le bras réussit à revenir en arrière pendant qu'un camarade le couvrait par son tir. Croyait-on que nous allions arrêter le colosse allemand avec une poignée d'hommes ? Après trois quarts d'heure de cette situation tragique, deux de mes soldats agitèrent un mouchoir blanc, se levèrent avec difficulté, tenant les bras en l'air et me disant que plusieurs de nos voisins ne bougeaient plus. Je fus le dernier à me redresser et, devant nous, un sous-officier ennemi braquait son révolver en nous ordonnant de courir derrière lui. Affolés, nous lui obéîmes. Arrivés dans les lignes adverses, nous fûmes saisis par le grand déploiement de l'armée allemande. Que de combattants ! Et quel équipement pour se protéger ! Des feuilles sur les casques, des branchages autour du corps et fort peu de bagages. J'avais été sauvé de la mort cette fois tout comme je l'avais été près du canal Albert, ainsi qu'à Ursel, et comme je devais l'être plus tard en captivité lorsque, chargeant un wagon de gros arbres, un gigantesque treuil allait s'abattre sur moi si l'on n'avait pas crié mon nom de même lorsqu'un ami et moi nous faillîmes mettre le feu à une réserve de bois de la menuiserie, avec nos cigarettes. Dans ce dernier cas, c'eût été la peine capitale pour cause de sabotage. Un caporal allemand nous fouilla, conduisit notre groupe de cinq ou six vers l'arrière en nous disant : « Regardez ma carte ! Nous occupons presque tout votre pays. » Devant une infirmerie de campagne, un commandant belge, assis sur une chaise, la tête entourée d'un énorme pansement tout ensanglanté, délirait. Dans un fossé gisait un soldat belge, mort. La guerre m'apparut alors dans toute son horreur, dans toute sa réalité ! Il me semblait avoir vécu un cauchemar mais il fallait imputer cela à la fatigue, aux longues nuits d'insomnie. 
A l’intérieur du cloître avec mon meilleur compagnon Et notre gardien continua à nous diriger vers une destination inconnue. Partout les Allemands occupaient fermes et maisons abandonnées. Ils nous regardaient en riant mais ne se moquaient pas. Sur leurs camions, ils avaient inscrit notre mot de passe : « Arlon-Léopold ». Nous avions dû abandonner notre casque, notre ceinturon, notre besace. Heureusement que j'avais conservé mon « bonnet de police ! » Un officier supérieur allemand me demanda, en français correct, ce qui signifiait ce « pompon argenté » qui ornait ce bonnet. Il me déclara aussi que, la veille, notre artillerie les avait « canardés ». Pendant que nous avancions, celle-ci tirait toujours et, connaissant bien ce sifflement des obus, nous voulions nous coucher. Mais notre sentinelle, très avertie, nous rassurait en montrant l'endroit où le projectile allait tomber. Cet homme avait l'habitude de localiser les chutes d'obus. Et au sujet de cette situation, j'étais étonné de voir que notre artillerie tirait dans le vide. Les Allemands avaient déplacé leurs troupes loin du point de chute de nos obus. En outre, un ballon captif, espèce de petit dirigeable, leur permettait d'observer, d'une certaine hauteur, une grande surface du champ de bataille. On traversa le canal Gand-Terneuzen à Zelzate sur un pont construit par le génie allemand puis nous atteignîmes Sleidinge où l'on nous parqua dans l'église. Ce fut notre premier camp de prisonniers. Pour moi, la campagne était terminée. J'avais frôlé la mort de très près et, lorsque j'entends des discussions au sujet du comportement de notre armée, je me dis que nous n'aurions pas pu mieux agir. Que de morts inutiles ! Je regrette qu'on ait laissé des gradés sans instructions au moment où « la grande bataille qui nous attendait » fut arrivée. En outre, pourquoi nous avoir abandonnés, pourquoi avoir laissé deux groupes de combat en plein champ labouré sans avoir essayé de nous appuyer par la gauche ou la droite ? Au sujet de cette guerre-éclair, beaucoup de choses resteront mystères. Pourquoi certains furent-ils obligés dès leur capture de remettre leur carte d'identité alors que nous pûmes garder la nôtre pendant presque toute notre captivité ? Ce ne fut que quelques jours avant l'arrivée des troupes américaines qu'on nous les confisqua. Sans doute cette mesure s'imposa-t-elle par la multiplicité des évasions. Lorsque le caporal allemand (Gefreiter) chargé d'amener les prisonniers vers l'arrière nous prit en mains, il nous déclara : « Vous êtes en train de couvrir la retraite des Anglais à Dunkerque ». Je lui rétorquai que je n'en savais rien et que, comme soldat, je me bornais à exécuter les ordres. J'appris plus tard que cette affirmation était exacte et que le contingent anglais avait pu ainsi être sauvé pour continuer la lutte qui allait mener les armées alliées à la victoire, mais quatre ans après seulement ! CHAPITRE III APRES LA CAMPAGNE Certes l'armée belge a fait tout son
devoir et, d'après les nombreux ouvrages que j'ai lus sur la guerre, je puis
dire que certains régiments se sont bien battus et que beaucoup de militaires
se sont conduits en héros. Il y a eu quelques défections sans doute mais nous
avons tenu dix-huit jours alors qu'un grand pays comme la France demandait
l'armistice trois semaines après notre capitulation. On avait même capturé des
ennemis. 
Nous somme trois Liégeois Avec le recul des événements, on peut se
poser la question suivante : « Pourquoi n'a-t-on pas capitulé quelques jours
plus tôt ? » On aurait épargné bien des vies humaines car, vu la disposition
des forces militaires, nous étions condamnés depuis plusieurs jours. Les alliés
reculaient, les Allemands avaient atteint la mer depuis un bon bout de temps et
l'étau se resserrait toujours. En outre les Anglais rembarquaient et il n'y
avait aucun espoir de reconquête, à nous seuls ! Qu'attendait-on de nous ? Nous n'avions
pas d'aviation, pas de chars, pas de planeurs, pas de parachutistes, etc ... On nous faisait marcher la nuit pour livrer le
combat en plein jour. Nous étions épuisés et il fallait livrer une dernière
bataille avec des moyens dérisoires. Par contre le soldat allemand était
aguerri. Son armée avait remporté une grande victoire en Pologne et, comme je
l'ai déjà dit, il était transporté par camion et légèrement équipé. De plus il
était fanatisé par l'esprit nazi, Hitler savait qu'il lui serait facile de
vaincre la Hollande, la Belgique et la France. Que l'on songe à la rapidité avec
laquelle tomba le fort d'Eben-Emael ; au fameux train dont le chef de convoi
demanda en néerlandais le passage pour ses troupes « en retraite », à la ruse
utilisée pour franchir certains ponts du canal Albert en maîtrisant leurs
gardes, à l'esprit combatif de ces soldats qui allaient de succès en succès !
Il est prouvé que les assaillants du fort d'Eben-Emael s'étaient déjà exercés
chez eux sur un obstacle semblable. Nous étions bien préparés pour une
guerre à la mode de 1914-1918 mais pour une guerre-éclair ? Aurions-nous pu, en
quelque endroit que ce soit, avec nos moyens de bord, repousser l'armée
allemande ? Dès qu'une résistance était décelée par cette dernière, son
aviation venait tout anéantir et les chars détruisaient la position, contournant
les obstacles dressés sur les routes. En outre, il y avait l'exemple de la
Hollande qui avait capitulé après cinq jours. Oserais-je ajouter que, tout
comme le soldat français, le soldat belge s'était encroûté pendant la
mobilisation qui dura huit mois; il avait connu les « délices de Capoue » et,
souvent désœuvré, se préoccupait surtout de la nourriture, de ses plaisirs et
de ses permissions. Resterait-on neutre ? Beaucoup le
croyaient. L'attaque contre la Belgique fut un crime. Qu'avions nous commis
comme faute ? Mon opinion personnelle, c'est que, dans
la défensive, le soldat est plus démoralisé que dans l'offensive. Dans cette
dernière, il avance, remporte des succès et cela l'enivre... Mais lorsque l'on
recule sans arrêt... Ajoutons que la jeunesse allemande était endoctrinée,
fanatisée, exercée à l'agressivité et la suite des combats le démontra. 

Dimanche d’été dans les jardins de l’abbaye Après la campagne de l'Ouest, Hitler qui
ne parvint pas à faire plier l'Angleterre, eut encore assez de forces pour
anéantir, quelques mois plus tard, la Yougoslavie, la Grèce et une énorme
partie de l'U.R.S.S. Au vu de ces événements, la campagne de
1940 nous apparaît comme une « promenade militaire ». La capitulation de l'armée belge causa
un véritable soulagement chez beaucoup. Mais si la Hollande avait démobilisé
toute son armée et si ses soldats avaient pu regagner leur foyer, ce ne fut pas
le cas pour nous. Le roi Léopold III était resté au pays ;
on avait capitulé et le bruit courait qu'il fallait se tenir groupés, que l'on
allait reconstituer les régiments, etc ... Lorsque le Roi demanda au général Von Reichenau : « Que devient mon armée ? » Il répondit : «
Elle est prisonnière de guerre ». Mais personne ne pensait qu'on allait nous
conduire en Allemagne ! « Demain nous allons nous atteler à reconstruire notre
pays » déclara Léopold III. Et les ordres de bataillon contenaient cet avis : «
Cessation des hostilités. Les commandants de compagnie me fourniront pour 11
heures leur situation en hommes et en armes ». Ces ordres, je ne les lus
qu'après la guerre dans un ouvrage consacré à la campagne de notre bataillon. J'avais été fait prisonnier « les armes
à la main » et je croyais que mon statut était spécial. Peut-être que si je
m'enfuyais et revêtais l'habit civil, serais-je considéré comme déserteur ?
Mais plus tard, au camp de Krems-Gneixendorf, Stalag
XVII B, je retrouvai mes camarades sous-officiers et soldats capturés après la
capitulation. Ce qui est dommage, c'est qu'aucun de
nos chefs ne nous ait avertis que nous partions vers l'Allemagne. Même des
officiers suivaient la colonne de prisonniers. Le bruit courait qu'on se
rendait au camp de Braaschaert pour y être
démobilisés puis lorsque, le 29 mai, nous franchîmes la frontière hollandaise,
des gens « bien informés » nous affirmèrent que l'on allait être démobilisés
dans l'île de Walcheren. Toutes nos illusions tombèrent lorsque
l'on nous embarqua sur des péniches à Waalsoorden. J'appris
plus tard que des unités complètes furent affectées à certains travaux en
Belgique dont ceux qui consistaient à enlever les fils de fer barbelés dressés
le long du canal Albert. De plus, sur notre passage, en partant
pour les Pays-Bas, plusieurs personnes nous disaient : « Où allez-vous ? Un tel
est déjà rentré chez lui. » La pagaille fut indescriptible. Il faut
dire que nous étions au Nord de la Belgique et que nous n'eûmes pas la chance
de repasser aux environs de Liège pour nous échapper comme certains le firent. 
Une « autre sortie » dominicale Beaucoup étaient tellement persuadés
qu'on allait être démobilisés qu'ils suivirent docilement la colonne. Un de mes
camarades de captivité était entré dans une maison où il passa une nuit
confortable chez de braves gens et, le lendemain, prit l'autobus pour rattraper
la file des prisonniers afin de ne pas rater une démobilisation probable. En ce qui me concerne, ne désirant pas
être déserteur mais résolu à accomplir mon devoir jusqu'au bout, je m'en
remettais aux bruits qui couraient comme d'ailleurs j'avais été obligé de le
faire pendant toute la campagne. En traversant Lokeren, l'attitude de nos
gardiens changea et ils nous obligèrent à serrer les rangs, invitant les civils
charitables à venir déposer vivres et boissons au pied de notre très longue
colonne. Partout aux fenêtres apparaissaient des visages attristés et nous nous
sentions un peu humiliés. L'image de ces religieuses nous regardant avec
compassion reste encore présente dans ma mémoire. Je n'eus qu'une seule fois
l'occasion de m'échapper, c'était non loin de la frontière hollandaise, en
pénétrant dans le corridor d'un café. Avec le recul du temps, je pense que
j'aurais dû m'introduire dans la cave pour m'y cacher. Mais le tenancier
aurait-il accepté de me donner des vêtements civils, de me nourrir ? Je n'avais
plus qu'une centaine de francs sur moi ! Certains sont retournés en militaire,
empruntant des voitures, utilisant des moyens de transport sans être inquiétés
tandis que d'autres ont été arrêtés par l'autorité occupante. Il y en a même
qui, rentrés chez eux à Liège, ont dû, d'après un avis de celle-ci, se
présenter à la Citadelle pour y être démobilisés. Ils n'en sont pas sortis et
ont pris le chemin de l'Allemagne. On voit dans tout cela le rôle de
l'uniforme : un civil n'est pas inquiété dans le désordre d'une capitulation de
l'armée. Ce qui arriva à nos deux gardiens à Hohenfurth
en Tchécoslovaquie le prouve aussi. Comme nous, ils gardèrent leur uniforme et
se firent cueillir par les Américains pour partir en captivité. L'un d'eux
m'avait affirmé qu'il était soldat et restait fier de l'être. Le gardien d'un Kommando voisin se mit en civil et vint dire bonjour, bien
à l'aise, à ses anciens prisonniers français venus se joindre à nous. Il
fallait en effet se grouper. Il y eut beaucoup d'injustices dans ces
circonstances. Hitler fit libérer uniquement les Flamands et Von Falkenhausen réussit à faire admettre le retour de gens qualifiés
: directeurs commerciaux, fonctionnaires de transports, gendarmes, douaniers,
policiers, ouvriers agricoles, personnel du gaz, de l'eau et de l'électricité et
d'autres encore mais hélas ! les enseignants n'en
furent point. Puis rentrèrent les malades, les vrais et les faux, et aussi ceux
qui réussirent à s'évader. Au 18 janvier 1945, les Allemands
recensaient 67.591 P.G. Belges dont 4.000 officiers et 6.600 sous-officiers ;
1.698 P.G. Belges étaient morts en Allemagne. Et l'on s'installa dans la captivité,
gardant toujours l'espoir que la guerre serait vite finie, espoir qui allait en
s'amenuisant au fur et à mesure que les années s'écoulaient. On fêta la Noël 40 entre nous, avec un
magnifique sapin que l'on était allé chercher dans le bois ; on nous permit
d'assister à la messe de minuit par une fenêtre de l'oratoire du couvent des
Cisterciens où nous étions installés. Ce fut un Noël d'espérance, certains que
l'on était de rentrer bientôt au pays. N'avions-nous pas en effet reçu, depuis
septembre ou octobre, des lettres de nos familles où l'on nous racontait que
plusieurs trains de prisonniers belges ramenaient ceux-ci dans leur foyer ?
Nous nous demandions si l'on ne nous oubliait pas. Mais nos gardiens et les
civils allemands ignoraient qu'une discrimination entre Flamands et Wallons
avait été décidée. A nos questions, ils répondaient : « Bientôt ! » 
Essai de cavalerie ! Il y eut énormément de cas particuliers tels celui de ces militaires qui, après être restés trois mois dans le Midi de la France soit juin, juillet et août 1940, furent soi-disant « rapatriés » par les autorités françaises et dont le train, arrivé à la ligne de démarcation, fut dévié vers l'Allemagne. On pourrait citer aussi celui de ces prisonniers qui reçurent un cachet pour être démobilisés et celui de certains qui furent obligés de passer un examen de néerlandais, leur situation étant douteuse. On nous occupa, dans notre « Arbeitskommando », comme la plupart, selon nos aptitudes... Mais comme j'étais professeur, on ne savait que faire de mon humble personne et heureusement que je connaissais assez la langue allemande pour que l'on me respecte et me donne des travaux légers. Malheureusement, ce ne fut pas toujours le cas et décharger des wagons de charbon ou charger des wagons de gros arbres, cela exigeait d'énormes efforts. De plus, je jouais le rôle d'interprète et rendis de nombreux services à mes camarades dont j'étais l'homme de confiance. Je devais tout traduire mais je me gardais bien de le faire pour les insultes afin d'éviter des ennuis à ceux qui les proféraient. Et, en raison de ma profession, j'organisai mes moments de loisirs, en me donnant des cours de langues, en lisant beaucoup car la Croix-Rouge de Belgique nous envoyait outre des romans, des livres de toutes les branches scolaires. Je me perfectionnais dans la langue allemande grâce à une grammaire et à des revues que deux jeunes de la localité, étudiants d'un « Gymnasium » de Krumau (actuellement : Cesky Krumlov) venaient m'apporter en y joignant parfois... deux ou trois cigarettes. Leurs études terminées, ils furent mobilisés et expédiés rapidement au front russe. Je revis l'un d'eux, revenant en permission avec une jambe en moins. Ils devinrent religieux et m'envoyèrent, après la guerre, un souvenir de leur première messe dite au monastère de Melk en Autriche. Bref, ma seule consolation durant cette période, je la trouvai dans l'étude et la lecture. Pendant tout mon séjour dans ce pays des Sudètes, je fus étonné par l'ignorance dans laquelle les habitants étaient tenus. Personne ne voulait croire que l'on avait commis un crime en violant la neutralité de notre territoire. Certains croyaient même que nous avions attaqué les premiers. Beaucoup se réjouissaient des succès allemands et croyaient à la victoire du « grand Reich ». Nous devons vaincre, disaient-ils, et la foi nous sauvera ! Mais c'était la foi dans la victoire et celle-ci ne vint jamais. Nombreux étaient les Allemands aspirant à une paix séparée avec les alliés occidentaux afin de s'unir à ces derniers pour refouler l'armée soviétique mais ce n'était qu'une trompeuse illusion. Sans doute ignoraient-ils Yalta ? CHAPITRE IV LA CAPTIVITE (1940-1945) Fait prisonnier à Oostwinkel,
près d'Ursel, non loin de Gand, le 27 mai 1940 vers 9
heures, j'ai été conduit par les Allemands à Sleidinge
où j'ai passé ma première nuit de captivité sur trois chaises de l'église du
village. (Sleidinge est tout près d'Evergem). J'y
suis retourné après la guerre, accomplissant une sorte de pèlerinage
historique. Le 28 mai, jour de la capitulation de l'armée belge, on nous a dirigés vers Lokeren puis Mœrbeke (Flandre orientale) où ma seconde nuit de captivité s'est déroulée dans une filature. Le 29 mai, aux petites heures, nous avons quitté cet endroit. Et j'entends encore un habitant de la ville intercéder auprès d'un officier allemand pour qu'il nous libère parce que nous avions des femmes et des enfants. Et ce dernier de répondre : « Ils ont tué nos soldats; eux aussi ont une famille ». 
Les paysages tourmentés et sauvages des Monts de Bohème On se mit en route vers Hulst et Waalsoorden où l'on embarqua dans des péniches afin d'atteindre l'Allemagne en deux jours. Ce fut un voyage pénible : nous étions serrés dans la cale, sans manger ni boire, sans rien pour nous asseoir ou reposer notre tête. Beaucoup passèrent la journée et la nuit sur le pont ; on ne pouvait quitter sa place sinon elle était occupée lorsqu'on revenait. Ayant dépassé Emmerich, nous débarquâmes à Rees où un train nous attendait pour gagner notre premier camp à Lathen, au Nord, dans l'arrondissement d'Oldenburg. Le séjour n'y fut pas mauvais; les soldats épluchaient les pommes de terre et les sous-officiers se reposaient. Mais la nourriture était frugale. Après huit jours, un train nous conduisit en Autriche : voyage pénible dans un wagon à bestiaux où je dus dormir, la tête sur le soulier de mon voisin qui remuait sans cesse. Le jour, on regardait le soleil pour s'orienter, on racontait qu'on allait travailler dans les mines de sel et, aux escales, nos gardiens restaient muets. Toutes les villes étaient pavoisées pour la victoire de Dunkerque. Il y eut un arrêt à Nurenberg pour recevoir de la Croix-Rouge allemande, un morceau de pain et un peu de café. Puis ce fut l'arrivée à Sankt-Pôlten, au nord de Vienne où l'on changea de train. Celui-ci nous conduisit à Krems, sur le Danube. En traversant cette ville nous étions étonnés de l'accoutrement des habitants habillés tous en Tyroliens. On se serait cru dans une station de vacances et la guerre n'apparaissait pas. Les gens nous regardaient avec curiosité. Personne n'osait nous adresser la parole. Il est vrai, et nous ne sûmes que plus tard, que des affiches apposées un peu partout rappelaient que les prisonniers de guerre devaient être traités avec indifférence (Nicht-Achtung) et qu'un ennemi restait un ennemi ! On gravit un chemin qui nous mena sur les hauteurs de la ville, dans un petit village appelé Gneixendorf. Mon séjour à Krems fut extrêmement pénible. On nous parqua dans de grandes tentes pendant deux jours. Il fallut dormir une nuit sur l'herbe humide, sans sac de couchage, sans couverture. Je retrouvai là mes collègues de ma compagnie qui me racontèrent ce qui s'était passé après ma capture. Plusieurs officiers de mon bataillon s'étaient défendus avec acharnement et avaient été tous tués. Et c'est avec soulagement que nous pénétrâmes dans le camp ! Alors se déroulèrent les séances de douches, de désinfection et l'on nous coupa les cheveux à ras. Puis ce fut la fouille : on prit mon argent, mon stylo, ma boussole, quelques papiers et l'on inscrivit tout ce qui figurait sur ma carte d'identité. Puis l'on nous photographia par groupes, chacun présentant un écriteau avec le numéro matricule que l'on venait de nous attribuer. Je reçus le numéro 9625. Quelques jours plus tard, on nous permit d'envoyer à nos familles une carte imprimée où figurait la mention : « Je suis prisonnier en Allemagne, au Stalag XVII B, sous le numéro ... Je suis bien. Signature. 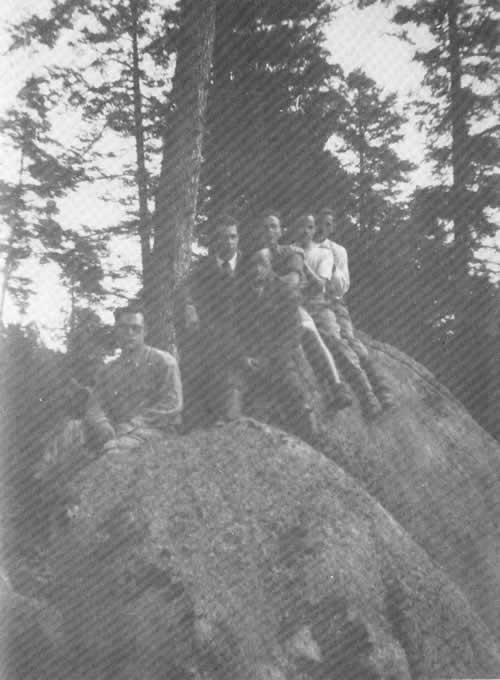
Les paysages tourmentés et sauvages des Monts de Bohème « Il n'y avait que des prisonniers belges dans ce camp. Tout le monde a déjà entendu parler de ces fameux Stalags entourés de barbelés, surveillés par des sentinelles braquant une mitrailleuse du haut de leurs « miradors ». Un nombre impressionnant de baraques bien alignées pouvaient être remplies par des centaines de prisonniers. Des Polonais nous y avaient précédés et nous étions frappés par la prévoyance des Allemands. On aurait dit, qu'avant de commencer la guerre, ils savaient déjà qu'ils devraient « loger » beaucoup de monde. On sépara les Wallons des Flamands et je dus abandonner mes compagnons d'armes. Les militaires des cantons d'Eupen et de Malmédy eurent le privilège d'une baraque spéciale. J'y revis plusieurs de mes condisciples du collège d'Eupen où j'avais été pensionnaire pendant trois ans. Ils jubilaient car ils allaient retourner dans leurs cantons annexés. Joie éphémère ! J'appris, 30 ans plus tard, qu'un de mes compagnons de 4ème Latin-Grec avait été tué au front russe. C'est lui qui, sur ma demande, avait écrit à ma mère, dès son retour, pour la rassurer sur mon sort. Mais dans ce camp de Krems, la faim nous tenaillait. Un quignon de pain, un bol de soupe aux épluchures de pommes de terre avec quelques grains de riz et parfois un dé de viande qu'on avait pêché dans la marmite et qu'on mettait à part pour le distribuer aux vingt prisonniers dont j'étais responsable, un peu de confiture, quelques grammes de fromage fondu, de l'Ersatz de café, tel était le menu du jour. Ce fut pour moi un festin, une fois seulement, lorsqu'un soldat de ma compagnie, ayant travaillé hors du camp, m'apporta une demi-pomme de terre. On était si faible que l'on restait couché presque toute la journée sur un lit à trois étages, fait de planches et recouvert de paille. Je choisissais toujours l'étage supérieur pour avoir plus d'air. Chaque soir, les aumôniers nous réconfortaient au cours du chapelet suivi immédiatement d'un « crochet » où se produisaient quelques talentueux camarades. Un avocat liégeois nous distrayait par des conférences touchant aux sujets les plus divers. Le dimanche, tout le monde était tenu d'assister à la messe. Personne ne pouvait rester dans la baraque, et les aumôniers-brancardiers devaient briser les hosties en miettes pour satisfaire les nombreux communiants. Même le général allemand, commandant du Stalag, était présent au premier rang. Un soir, revenant d'une petite promenade dans le camp, je m'aperçus qu'on avait volé ma ration de pain. Heureusement un avocat de Binche avec qui je m'étais lié d'amitié eut la gentillesse de partager son quignon de pain avec moi. 
Après un long hiver (sept mois de neige), l’espoir renait dans la solitude de la nature renouvelée La nuit, la captivité était plus désagréable encore. Le va-et-vient incessant vers les toilettes et les projecteurs qui n'arrêtaient pas de balayer coins et recoins, tout cela troublait notre sommeil. En outre, on se grattait souvent et les soins hygiéniques n'apportaient aucune amélioration. Nous étions, sans le savoir, attaqués par les poux. Un médecin français, car nos alliés arrivaient à leur tour, ne le vit point et m'administra... un dépuratif ! L'eau ne manquait pas et le lavoir de la baraque était constamment occupé. N'insistons pas sur les toilettes ! Dans un réduit « ad hoc », plusieurs rangées de chaises trouées étaient juxtaposées et les conversations y menaient bon train. Que de fausses nouvelles ! Des camarades étant allés travailler à la gare de Krems avaient vu sur des wagons les noms des provinces belges... Le commandant du camp aurait dit à l'un de nous, atteint d'appendicite : « Vous vous ferez opérer chez vous dans quinze jours ». Un civil, membre de « l’Arbeitsfront », venait choisir les prisonniers. Je fus un des derniers à partir au travail ; bien que sous-officier, j'y fus obligé. Inscrit dans un groupe de trente, je fus séparé de celui-ci lorsqu'on arriva au numéro 20 et je suivis, le lendemain, d'autres camarades dont l'un habitait mon quartier à Liège et que je connaissais de longue date. Entre nous naquit une vive amitié et il me rendit de nombreux services. Menuisier de son état, il avait confectionné un pied en bois pour que nous puissions ravauder nos chaussettes. C'était en outre un bon « cuistot » et un bon coiffeur. Il s'appelait Charles Freuville. Nombreux furent les prisonniers qui essayèrent de s'alimenter par tous les moyens; certains voulant se procurer des légumes dans le potager entretenu par nos sentinelles furent vite refoulés par celles-ci qui n'hésitèrent pas à actionner leur mitrailleuse et les balles crépitèrent sur le toit de ma baraque. Je quittai le Stalag XVII B le 4 août 1940, avec 19 camarades, pour un Arbeitskommando situé en Tchécoslovaquie, soit à Hohenfurth (actuellement Vyssi Brod). Cette fois on avait disposé des bancs dans des wagons à bestiaux afin de nous assurer un « léger » confort. Nos deux vieux gardiens, un peu déphasés, oublièrent de faire attacher le wagon à Zartlesdorf (actuellement Horni Kalisté) et nous arrivâmes à Gross Umlowitz. Il fallut attendre pendant plusieurs heures le retour de notre train et, pendant ce temps, autorisés par le chef de gare, nous pûmes arracher toutes les cerises de l'unique cerisier rencontré pendant mes cinq ans de captivité. Quelle aubaine après une période de diète ! Enfin, on arriva à Hohenfurth, un samedi. Notre Arbeitskommando se trouvait dans un monastère (dont les moines furent chassés par la Gestapo un an après notre arrivée). Là nous attendaient de multiples occupations, soit en forêt ou dans l'agriculture, car comme au moyen-âge, le monastère comprenait brasserie, menuiserie, scierie, porcherie, ferme, jardins et, dans les environs, une grande étendue de bois. Je fus occupé partout et dus accomplir de durs travaux pendant la première moitié de mon séjour là-bas. J'en parlerai plus loin dans mon chapitre sur Hohenfurth. C'est en mars 1943 que je fus affecté à la scierie d'Obermuhle, près de Rosemberg (actuellement Rozmberk) pour accomplir en majeure partie des travaux de bureau. Je devais souvent quitter ce dernier pour charger les wagonnets de planches, calculer le chargement des wagons, disposer les planches en tas ordonnés, mesurer le volume des arbres reçus, prendre note de ce qui avait été scié. A l'intérieur, je recevais les gens qui achetaient du bois à brûler, rédigeais les factures et encaissais. Nous partions à trois tous les matins vers 7 heures et arrivions à la scierie après une marche de quatre kilomètres. Le retour s'effectuait en tram, vers 16h30, avec une « Ausweiss ». 
Français et Belges groupés à l’abbaye heureux d’être libérés (Mai 1945) Nous pouvions écrire à nos familles trois fois par mois sur des formulaires et recevoir un colis mensuel. Notre Arbeitskommando s'enrichit de Français après deux ans. Nous dormions à huit dans une grande chambre avec lits superposés. Je fus heureux d'aller travailler à la scierie juxtaposée à une centrale électrique fournissant le courant aux trams de la région (Sud de la Bohême). C'était autre chose que de travailler en forêt, dans une porcherie pendant les six mois d'hiver ou à la récolte de la glace en janvier, ou au nettoyage des sentiers enneigés, ou au chargement des wagons d'arbres ou au déchargement des wagons de charbon, ou à la récolte des pommes de terre, ou enfin à la batteuse de la ferme. Le patron de la scierie, anti-nazi, m'annonçait les bonnes nouvelles entendues à la radio suisse. Le soir, je m'empressais de les communiquer à tous les prisonniers de guerre que je rencontrais. Cet homme m'envoyait parfois commander un wagon de charbon ou un autre destiné à charger des planches, des poutres. Je marchais seul dans le bois et, pendant la bonne saison, je m'asseyais en pleine nature, lisais, rêvais... J'atteignais ainsi, après quatre kilomètres en forêt, la gare isolée de Rosemberg dont le chef qui avait perdu son fils à Poitiers me faisait écouter la radio étrangère. Durant la première partie de ma captivité, j'avais donc accompli un tas de besognes désagréables ; on ne savait que faire de mon humble personne et je devais seconder mes camarades comme si j'avais leurs capacités et j'essayais de les égaler. Je dînais avec eux au Kommando puis lorsque je fus désigné pour la scierie, j'emportais mon casse-croute préparé par les vieilles servantes de l'ancien monastère. A trois, un Français, un Belge et moi-même nous longions la vallée de la Moldau par tous les temps. Heureusement nous ne travaillions pas le samedi après-midi ; celui-ci étant consacré au nettoyage de notre chambre; ni le dimanche, réservé à la promenade ou au jeu de cartes. Pendant les premiers temps, un moine du couvent disait la messe pour les prisonniers puis cela fut interdit aux prêtres allemands. Nous eûmes alors la visite mensuelle d'un prêtre français, prisonnier également. Tous les prêtres belges avaient été rapatriés puisqu'ils faisaient partie du service de santé. Je me chargeais de rassembler les objets du culte auprès du sacristain de l'abbaye. Homme de confiance et interprète, je dressais les listes de mes camarades, recueillais leurs désidérata et devais atténuer les propos injurieux qu'ils prononçaient à l'égard de notre gardien, leur évitant ainsi la punition. Pendant un certain temps, je remplis les mêmes fonctions pour les Français puis ces derniers, plus nombreux, se choisirent un compatriote en raison de l'origine différente des colis dont la répartition s'avérait parfois délicate. 
Le départ en car vers le champ d’aviation d’Hôrsching le 15 mai 1945 Il y aurait beaucoup à raconter sur cette période de cinq années et j'évoquerai plus tard de nombreuses anecdotes. Et le 6 mai 1945 arriva la libération. C'était un dimanche. La petite ville d'Hohenfurth offrait un visage bizarre sous les drapeaux blancs arborés. Nos deux sentinelles avaient brûlé toutes leurs archives, distribué nos colis et attendaient les ordres ... C'est alors qu'un prisonnier français du Kommando du centre de la villette vint nous trouver et nous annoncer qu'ils étaient libérés. « Venez saluer les Américains, disait-il, ils sont chez nous ! » Nous partîmes à deux et vîmes nos libérateurs qui défilaient, défilaient... Partout, dans les rigoles, des fusils abandonnés... Les anciens « dignitaires nazis » étaient rassemblés et gardés sur la grand’ place. J'entrai dans le café où habituellement on nous autorisait à pénétrer dans une petite salle située à l'arrière et me fis coudre sur la manche, par la jeune fille de la maison, un petit écusson belge. Et cette fois, dans la petite ville, de nombreux chars encombraient les rues principales. En retournant au monastère pour aller dîner, je rencontrai mes deux gardiens escortés par un soldat américain, la baïonnette au canon. Ils étaient prisonniers à leur tour et me donnèrent la main en disant : « Nous ne nous reverrons plus. » On les conduisit à l'école transformée en caserne. Ils pleuraient. Et ce 6 mai 1945 fut un jour inoubliable ! De nombreux Français venus nous rejoindre s'occupèrent de se procurer de vivres et confisquèrent le poste de radio du cabaret de l'abbaye. Deux des leurs, cuisiniers de profession, réquisitionnèrent des cochons et le soir, on fit un festin dans le grand local précédemment occupé par nos gardiens. Les troupes allemandes en retraite avaient installé un hôpital dans notre monastère mais ... sans malades ! Il y avait une cantine et, conduits par un des nôtres, des soldats américains firent sauter le cadenas pour s'emparer de chocolat, d'alcool, de tabac, de cigarettes, etc ... Pendant une dizaine de jours, ce fut la joie d'être libérés ! On se promenait partout. Je demandai à un Feldwebel de me prêter son vélo pour aller voir ce qui se passait chez mon ancien patron de la scierie. Avec toute sa famille, il avait dû céder son appartement aux Américains et se loger dans une baraque où se trouvait le bureau, endroit qui m'avait vu travailler, manger, rêver, lire, discuter avec mon chef. Les Américains obligèrent les préposés à la Centrale électrique à la refaire fonctionner car ces derniers, par sabotage sans doute, avaient démonté les machines pour empêcher les trams de rouler. Les ouvriers allemands voulurent que j'explique à nos libérateurs qu'ils étaient incapables de les remonter, ce que je refusai. Quel plaisir j'éprouvais à voir les anciens chefs nazis occupés à défaire les barricades érigées sur les routes à l'aide d'arbres et gardés par les Américains ! Constamment ces derniers entraient dans notre local pour venir boire l'alcool confisqué à la cantine allemande. Un soir, l'un d'eux, me prenant sans doute pour un Allemand, braqua son révolver sur moi, me demandant où rencontrer des femmes. Je répondis évasivement. Nous étions vraiment libres d'aller où nous voulions et nous pouvions constater combien la mentalité de la population avait changé. Certaines personnes haut placés avaient peur et venaient m'affirmer qu'elles avaient toujours été opposées au régime nazi. Elles espéraient sans doute que j'allais intervenir en leur faveur tout comme nos deux geôliers qui cherchèrent après moi quand un Américain les fit prisonniers. Peut-être croyaient-ils que j'allais intercéder pour eux ? Tous les civils nous respectaient et nous saluaient d'un beau sourire. Beaucoup étaient étonnés de nous voir assister à la messe du village le premier jour de notre libération et le curé nous demanda en français si nous voulions nous confesser. Quel spectacle que celui des habitants pillant les camions de leur propre armée en déroute ! Nous avions des bons de réquisition. La riche demeure du docteur nazi était occupée par l'Etat-Major américain et c'est devant celle-ci que nous rencontrâmes deux soldats russes. Probablement assuraient-ils la liaison ? Le sol de la petite ville était jonché de fusils et d'équipements divers. Devant moi, le conservateur des biens juifs entassés dans le couvent remit deux révolvers aux Américains juchés sur leur char et me déclara : « Vous êtes témoin ! » La femme d'un garde-chasse, nazi convaincu et qui nous avait fait travailler me demanda d'intercéder auprès de ceux-ci pour garder la carabine de son mari mobilisé et leur expliquer que c'était son gagne-pain. Bien entendu, je refusai. Depuis plusieurs jours, nous assistions au recul des armées allemandes et au défilé des charrettes remplies d'objets divers que les civils hongrois, harassés, faisaient tirer par des chevaux maigrichons. 
L’abbaye vue de dos Nos gardiens étaient restés jusqu'à la dernière minute, croyant que tout allait changer avec la mort du président Roosevelt, ensuite espérant que les Américains ne franchiraient pas l'ancienne frontière autrichienne. Leur compagnie située à Freistadt en Autriche ne répondait pas au téléphone. Quelques jours avant notre libération, ils nous avaient confisqué nos cartes d'identité et, une heure avant celle-ci, ils nous distribuèrent nos colis et brûlèrent leurs paperasses. Et au sujet de cette ville de Freistadt, je me rappelle y être allé en train, escorté par mon gardien, afin d'y chercher les colis que l'armée allemande harcelée par les bombardements et l'avance des alliés ne nous faisait plus parvenir. Je dus y passer la nuit dans un local réservé aux prisonniers et je vis un prisonnier russe confectionner une cigarette avec de l'herbe séchée et un morceau de journal. Alors, nous lui fournîmes quelques cigarettes occidentales. Au sujet de ces dernières, il faut signaler que pendant longtemps et surtout la dernière année, on nous rationna. Heureusement que l'on avait reçu des cigarettes américaines et pendant tout un temps des françaises sinon la période où l'armée allemande nous fournit des cigarettes polonaises appelées « Junack » nous avait enlevé le goût de fumer, ces dernières étant faites d'un tube en carton de 3 cm avec un autre de 2 cm en papier pour y mettre le tabac. Tout au début de notre captivité, nos deux premiers gardiens, assez âgés, se conduisirent en pères de famille et, le dimanche soir, rentraient avec un tas de mégots ramassés dans les cafés de la villette. Certains s'empressaient d'en faire des tas pour les distribuer mais je préférai m'abstenir de les utiliser. Il y eut cependant une ombre au tableau de notre libération : un de nos camarades était atteint de scarlatine et il fallut l'isoler puis s'occuper de lui pour le retour. Lorsque plus tard nous arrivâmes au champ d'aviation d'Hërsching, en Autriche, nous fîmes une demande d'admission pour lui à l'hôpital de Mauthausen. Nous y fûmes mal reçus par les Américains qui nous déclarèrent que beaucoup d'hospitalisés étaient atteints de maladies contagieuses. Enfin il revint avec un médecin français qui s'occupa de lui au cours du trajet. Pour reparler de l'arrivée des Américains à Hohenfurth, disons qu'elle fut calme. Ceux-ci fouillaient les maisons, inspectaient les ponts et un de leurs officiers nous donna des directives. Enfin le 15 mai 1945, le commandant des U.S. demanda que l'on choisisse, parmi nos camarades, des conducteurs d'autobus. Il nous fournit deux magnifiques autocars et deux Français se portèrent volontaires. 
Vue partielle de la villette Et ce fut le départ que je faillis rater car j'étais allé chez les braves vieilles servantes de la cuisine du couvent pour faire remplir ma gourde de café sucré. Je rejoignis le car par un escalier menant à la grand-route, raccourci qui me fut d'un grand secours. Nous dîmes adieu à Hohenfurth, pénétrâmes en Autriche, traversâmes Linz et l'on arriva au champ d'aviation d'Horsching. Celui-ci offrait un spectacle curieux. Que de carcasses d'avions allemands ! Vraiment la défaite de notre ennemi s'étalait devant nos yeux. Les avions américains décollaient toutes les cinq minutes pour rapatrier nos camarades français mais il n'y avait pas d'instructions pour les Belges. Nous dûmes passer deux nuits dans le car, veiller à ce qu'on ne nous vole pas nos effets car il y avait des rôdeurs. A un certain moment un cri retentit : « On part ! » Nous voilà en train de courir vers le hangar d'embarquement. C'était une fausse nouvelle et quand nous regagnâmes notre car, quel gâchis ! Des civils avaient démonté les roues, enlevé le moteur et même volé des objets personnels. Je ne fus pas lésé : j'avais pris mon havresac avec moi. Pendant ces deux jours, les Américains nous donnèrent pour toute nourriture des boîtes contenant des déjeuners habilement préparés: biscuits, poudre à café, gruau d'avoine, chocolat, etc ... Et grâce à l'intervention d'officiers français, notre départ fut organisé pour le jeudi 17 mai. Après une désinfection rapide au D.D.T., une poudre qu'on injectait dans notre pantalon, nous nous rangeâmes par groupes de 30. Etant sergent, je dus, une fois de plus, dresser la liste de mes hommes. On attendit d'abord dans le hangar de l'aérodrome où des rôdeurs nous volaient notre valise dès qu'on tournait le dos puis on nous rangea au bord de la piste. Quel soulagement lorsque nous pénétrâmes dans l'avion libérateur ! Mais quelle appréhension aussi ! Je m'assis sur mon sac à dos dans un endroit où l'on avait ajouté un plancher. Je remarquai plus tard que je me trouvais dans ce qui avait été le trou à bombes. Par certains interstices, j'apercevais à 1.200 mètres de hauteur les ruines des villages bombardés. Les Américains nous avaient remis des directives par écrit et l'une d'elles nous enjoignait à nous placer en avant de l'appareil lors de l'atterrissage. Le tout se terminait par « Plaisant voyage ! » On pouvait circuler dans l'appareil et j'admirai le tableau de bord. Enfin nous survolâmes la Belgique : beaucoup de terrils ! Nous vîmes Charleroi, le Borinage... Où allait-on nous déposer ? Certains craignaient que l'on aille... en Angleterre. Mais l'atterrissage eut lieu à Merville près de Lille. (Alors que les Français arrivaient à Evere !) Pas de Belges pour nous accueillir ! Il faut rendre hommage aux Français qui nous gratifièrent d'un colis et mirent un train de nuit à notre disposition pour Tournai où nous débarquâmes à l'aube. Dans cette ville eurent lieu les formalités de rapatriement (carte d'identité, avance sur la solde, visite médicale) qui durèrent toute la journée. Puis ce même jour, le soir du 18 mai, nous prîmes un train pour Schaerbeek où le personnel de la Croix-Rouge nous distribua du café. Enfin un dernier train nous amena à Liège. 
Les habitants pillent les camions militaires allemands Et ici, je dois signaler un beau geste ! Comme je devais rentrer à Robermont et que le dernier tram partait à 22h30 (il était 22h.), un brave camionneur nous conduisit, mon ami Freuville et moi, au terminus du tram 10, place Saint-Pholien. L'arrêt « Rue des Prairies » était supprimé mais on fit exception pour nous. Mon camarade alla prévenir ma famille pendant que j'attendais dans une ruelle voisine et, ce 18 mai au soir, j'étais chez moi. Rien n'avait changé ! Ma mère avait recouvert mon bureau d'un immense drapeau belge. Je fus heureux de brûler mes habits militaires et tout mon linge car pendant cinq années nous avions été incommodés par cette bestiole que l'on trouve rarement chez nous : la puce. Alors commencèrent les visites de la famille, des amis et des voisins. Je repris la vie normale de l'homme libre, heureux d'avoir retrouvé ceux que j'aimais, parcourant ma bonne ville de Liège et voyageant dans mon cher pays. CHAPITRE V HOHENFURTH. Hohenfurth,
actuellement Vyssi Brod, se
trouve à six km. de la frontière autrichienne et à
environ trente-six km. au nord de la ville de Linz. C'est une coquette cité tchécoslovaque
que les Allemands avaient annexée à l'Allemagne lors des accords de Munich. Située au pied des monts de Bohême elle
a une altitude semblable à celle de la Fagne belge et le climat continental lui
donne un hiver rude et long. La neige la recouvre pendant six mois et la
population s'y est adaptée. Pendant tout l'hiver retentit le bruit des
clochettes agitées par les chevaux tirant un grand traîneau. Cette localité est bordée par la Vitava (ou la Moldau) qui se dirige vers Prague. A cet
endroit, la rivière fait un large coude avant de pénétrer dans la forêt. Le nom
d'Hohenfurth signifie, en traduction littérale, un
gué élevé. Deux gares desservent la localité : Hohenfurth-ville et Hohenfurth-Stift (Couvent). Une seule rue commerçante monte en
direction de la frontière autrichienne et l'autre qui lui est perpendiculaire
longe la vallée. Jalonnée de quelques villas, elle conduit au monastère perché
sur un vaste plateau et qui domine toute la région. Cette abbaye appartient à l'ordre des
Cisterciens et ressemble tout à fait à ce qui existait au moyen-âge : un épais
mur d'enceinte englobe pharmacie, brasserie, auberge, ferme, porcherie, forge
et au centre, une magnifique église flanquée d'un cloître et d'un immense
couvent. De splendides jardins ainsi que de grands vergers rendent l'ensemble
moins austère qu'on pourrait le croire. A l'entrée sont disposés les bureaux et
les cuisines. Nos deux chambres sont situées devant le bureau du Père Abbé. Mais si tout évoque un christianisme
bien suivi comme la jolie chapelle entourée du petit cimetière où sont enterrés
les moines, et les longs couloirs ogivaux, il faut se rendre à l'évidence : le
Reich a mis la main sur le tout, a désigné un administrateur, bref a mis sous
séquestre tous les biens appartenant à la communauté religieuse. Celle-ci, « tolérée
» encore pendant une année, reste dans la partie appelée « Clausura
», dessert l'église puis sera expulsée sous nos yeux en 1941. Les locaux seront
utilisés d'abord pour en faire un camp de réfugiés de langue allemande
provenant de Bessarabie puis plus tard, on y entassera les biens juifs de
France, de Belgique, de Hollande. Les murs seront recouverts de peinture noire
pour protéger les bâtiments contre toute attaque aérienne, la couleur beige
étant trop voyante. Cette région porte le nom de « Bohême-Moravie
» et appartint à l'Empire d'Autriche-Hongrie qui s'effondra après la guerre
1914-1918. Elle fut alors attribuée à la Tchécoslovaquie et les habitants
faisaient partie des trois millions et demi de Sudètes. Les villes les plus proches
sont, au Nord : Budweis (actuellement Ceske Bude-jovice),
au Sud : Linz. Annexés par Hitler et englobés dans la «
Grande Allemagne », la plupart de ces gens étaient fanatisés par les libertés
qu'on leur avait promises. Ils déclaraient que, sous le régime tchécoslovaque,
leurs droits étaient bafoués et les postes administratifs leur étaient refusés.
Partout on vous saluait d'un « Heil Hitler ! » qui
nous offusquait. Le pays était pauvre. Il vivait surtout
de ses forêts. Le bois était le seul combustible utilisé dans de gigantesques
poêles en terre cuite. Ce n'est que vers le milieu de la guerre que les premiers
wagons de charbon arrivèrent. On ne connaissait pas les « frigidaires » et, en
janvier, la récolte de la glace dans les étangs était destinée à la brasserie,
aux cafés et à la boucherie du village. On vivait aussi de la chasse, les bois
étant peuplés de chevreuils que l'on nourrissait l'hiver, en se rendant sur les
hauteurs où l'on avait dressé de petites huttes remplies de paille. Certains de
mes camarades, conduits en traîneau jusqu'à huit cents mètres d'altitude ont
admiré ce système qui consistait à protéger le gibier pour le tuer après. 
Les camions de la Croix-Rouge allemande délaissés devant la basilique Les fruits se réduisaient aux pommes et
aux poires. Pas de fraises, pas de reines-claudes, pas de groseilles, pas de
raisins. Vers la fin de la guerre, arrivèrent, des pays occupés, des convois de
bananes et d'oranges. Il y avait certes quelques grandes
fermes toutes étatisées et l'on récoltait surtout du seigle, de l'orge et du
maïs. La population ne consommait jamais de pain blanc mais toujours du pain de
seigle agrémenté de grains d'anis. Pas de tartines mais on découpait le pain en
petits morceaux que l'on mangeait à la cuillère dans de grands bols contenant
un Ersatz de café, espèce d'orge grillé. Bien entendu, seuls les hommes
indispensables étaient restés au pays, les autres étant, dès dix-huit ans,
embrigadés dans l'armée. Les femmes étaient toutes obligées de travailler sans
distinction de classe sociale. Elles portaient un fichu sur la tête, un pour le
dimanche et un autre pour la semaine. De l'autre côté de la Moldau, sur la
rive droite, deux grandes fermes perchées sur une haute colline dominaient le
paysage. Des prisonniers y travaillaient et je dus même participer à la rentrée
des céréales. Tous les terrains étaient en pente et la moissonneuse-batteuse
n'existait pas encore. Nous étions entourés de montagnes
puisque notre Kommando se situait au pied des monts
de Bohême et, lorsqu'un orage éclatait, cela faisait un bruit épouvantable. On connaissait la plupart des gens du
village qui nous saluaient aimablement mais demeuraient muets sur les questions
d'ordre politique. On m'appelait « Herr Professor » et souvent on se demandait à quel travail
m'affecter. A notre arrivée à Hohenfurth,
un changement s'était produit en nous. La nourriture, bien que frugale, était
propre, servie dans des assiettes et le pain n'était pas encore rationné. Nous
avions l'impression que l'on s'occupait de nous en veillant à ce que nous
soyons convenablement habillés et en nous permettant d'acheter, grâce aux « Lagergeld » ce qui nous manquait comme produits non
alimentaires. Et un rasoir fut le premier objet que je m'offris. Un jour, un ami me dit qu'il venait de
découvrir des poux dans son lainage. Une inspection personnelle me démontra que
je subissais le même fléau. D'autres s'aperçurent aussi de ce triste
parasitage. Alors notre sentinelle prit contact avec
le directeur de la maison d'arrêt de la villette et nos vêtements, notre linge,
furent passés à la vapeur dans un grand cylindre affecté à la désinfection des
prisonniers civils. Comme nous ne pouvions rester nus, on
nous permit de garder notre manteau. C'était cocasse de nous voir traverser la
grande cour de l'abbaye dans cette tenue, sans le moindre dessous ! Et
justement ce jour-là, arriva un officier allemand chargé de contrôler le Kommando. Il se fâcha, reprochant à la sentinelle de nous
laisser partir dans cet accoutrement. Quelle humiliation ! Quand nous récupérâmes notre bien, il
fallait voir comme notre aspect était lamentable avec la veste et le pantalon
rétrécis et devenus verdâtres. L'un de nous avait oublié son porte-monnaie en
cuir dans une poche et celui-ci était minuscule. 
Véhicules abandonnés par l’armée allemande devant l’abbaye Enfin ces désagréables bestioles ne nous
incommodèrent plus ! Les Allemands les craignaient car, affirmaient-ils, elles
pouvaient transmettre le typhus. Les puces les remplacèrent mais de celles-ci
on s'occupa moins. Les civils aussi en étaient gratifiés dans cette région où
les salles de bain n'existaient pas, où les cadres vivaient dans trois pièces,
où les travailleurs se contentaient d'une cuisine et d'une chambre à coucher.
L'horloger du village ne possédait qu'une place contenant son atelier et ses
meubles. Nous prenions notre bain dans les baquets en bois de la buanderie de
la ferme, le samedi après-midi, et nous en profitions pour laver notre linge. Ma
connaissance de la langue allemande me servit beaucoup et je refusai certains
travaux. Un officier allemand m'ayant ordonné de charger des bottes de foin, je
laissai tomber la première et il me donna un aidant. Il existait au centre du village un
second Arbeitskommando où travaillaient Français et
Belges. On les rencontrait parfois conduisant des charrettes tirées par des
chevaux. C'était tout naturel pour la population. Le dimanche, nous nous y rendions
souvent l'après-midi, surtout en hiver. Ce petit groupe logeait dans un
bâtiment annexé à une ferme et en même temps à un café. L'arrière-cuisine était
réservée aux prisonniers qui pouvaient y consommer. Ajoutons que, bien que Belges, nous
avions les mêmes privilèges que les Français dont le pays collaborait avec
l'Allemagne. On nous accordait la permission de sortir par petits groupes le
dimanche de 14 à 17 heures. Un responsable était désigné et aucun gardien ne
nous accompagnait. Nos geôliers nous laissaient aussi partir seuls au travail
et, s'ils venaient nous inspecter, ne portaient plus le fusil. C'est pendant une de ces sorties
dominicales que trois Français de notre Kommando
s'évadèrent. Nous leur avions fourni les vivres que nous recevions dans nos
colis. On ne s'aperçut de leur absence qu'au soir, vers neuf heures, quand
notre gardien vint faire l'appel. Celui-ci était vert de rage et le
Feldwebel, « officier de contrôle » qui logeait à l'étage de notre bâtiment,
descendit quatre à quatre les escaliers. Je fus le premier à être interrogé.
Nous gardâmes un mutisme absolu. On ne sut jamais si nos trois compagnons
avaient atteint la Suisse. On pourrait s'imaginer que nous vivions
en touristes ! Mais s'il y avait des moments de détente bien nécessaires sur
une période de cinq ans de captivité: promenades dans le bois, deux ou trois
séances de cinéma au village et deux séances de variétés pour tous les
prisonniers de la région, si l'on faisait des blagues même, il ne faut pas perdre
de vue que nous étions privés de liberté, que nos pensées s'envolaient souvent
vers notre pays, que beaucoup d'entre nous se tracassaient pour leur femme,
leurs enfants, les membres de leur famille et l'on attendait le courrier avec
impatience. 
Devant l’avion qui va nous ramener… en France En outre la nourriture n'était pas des
plus riches et les pommes de terre remplaçaient fréquemment la viande qui
certains jours était inexistante. Il fallait avoir les nerfs solides pour
garder un bon moral. Retournerait-on jamais ? On finissait par se dire « Peut-être
dans un an, ou dans deux ? » Et puis les travaux étaient durs et,
quoique professeur, je fus occupé à un tas de fonctions pénibles. Nous avons
commencé par casser des pierres que nous retirions de la Moldau et nous avons «
construit » une route dans le bois pour permettre le passage des charrettes
véhiculant les arbres. Nous avons chargé de gros arbres sur des wagons de
chemins de fer, arbres qu'il fallait rouler à la main ou avec un levier en
bois. Je faillis être tué par un énorme treuil qui allait tomber sur moi si un
camarade ne m'avait averti à temps. La récolte de la glace en janvier nous
obligeait à recoudre nos moufles tous les soirs. Je me trouvais dans la grande
cave de la brasserie où, avec un maillet en bois, je devais frapper sur les
blocs de glace qu'on déchargeait par le soupirail quand un de ceux-ci me sauta
aux yeux et je fus blessé à l'arcade sourcilière ; j'en ai conservé la marque. Nous avons joué aussi le rôle de
bûcheron et l'hiver, il fallait rester toute la journée dans la forêt enneigée,
nous chauffant de temps en temps à un feu de bois. Les Allemands mobilisant davantage, les travaux
durs nous incombèrent et l'on était astreint à décharger à deux, le facteur et
moi-même, un wagon de 20 tonnes de charbon en une demi-journée. Tout l'hiver, nous marchions avec des
galoches et le raccommodage journalier des chaussettes s'imposait. L'armée
allemande ne nous fournissait que des loques (Fusslapen).
Quelques prisonniers furent mieux lotis,
ils étaient fermiers et on les occupa dans l'agriculture où ils bénéficiaient
d'une meilleure nourriture. Par esprit patriotique, il nous fallait freiner
l'ardeur au travail de ces jeunes gens pour qui celui-ci était l'occasion de se
défouler. On ne se privait pas de leur dire de ralentir. Pour la première fois de ma vie, je dus
conduire une charrette tirée par un cheval vers Loucovice
où je vis une papeterie gigantesque qui occupait des prisonniers russes. Le
contremaître allemand les dirigeait à coups de bâton. Je fis part de mon
indignation à la sentinelle allemande qui trouvait cela normal. J'avais eu des
difficultés à traverser le porche du monastère car la charrette avait accroché
une borne latérale. Et je dus plusieurs fois crier au
cheval : « Zurück ! » Les habitants de cette localité ne
tarissaient pas d'éloges au sujet des prisonniers français qui, disaient-ils,
avaient travaillé avec une application sans pareille, ce qui était tout le
contraire de leurs successeurs. C'est en cet endroit que l'officier de contrôle
me conduisit pour jouer le rôle d'avocat et d'interprète à propos d'un prisonnier
français des environs qui, contrairement à ses camarades, avait refusé le
travail et répondu grossièrement à ses employeurs. Ici je dus être très
diplomate, une fois de plus, pour traduire les expressions du malheureux accusé
et lui éviter ainsi le départ vers un camp de punis. Quelques petits sabotages purent être
accomplis. Tout d'abord dès que notre gardien ou notre contremaître s'éloignait
ou avait le dos tourné, on arrêtait le travail. On fit sauter la courroie d'un
petit moulin destiné à trier le grain un nombre incalculable de fois et notre «
chef » tournait, tournait... sans s'apercevoir que le tri ne s'effectuait pas.
Avec le même, Ludwig, on dut, dans une cave où l'on entreposait une grande
quantité de pommes de terre, séparer toutes celles qui étaient pourries de
celles encore comestibles. On déplaça avec une pelle tout le tas d'un coin à un
autre en ayant soin de mettre une couche de bons tubercules au-dessus des
mauvais. Et ainsi on ne remplit que quelques brouettes de ces derniers. Evidemment
il s'agissait de la nourriture réservée aux porcs. Et que dire aussi de la
truie qui ayant mis bas douze porcelets recommença huit jours après ? Lors du
nettoyage des étables, nous avions tout simplement interverti le placement des
animaux et notre benêt de porcher ne l'avait pas compris. 
Quadrimoteur américain chargé de nous rapatrier Dans le dépôt de la menuiserie, on
déplaçait quelques planches puis l'on se reposait en fumant. C'est ainsi que
nous mîmes le feu au toit et, grâce à quelques seaux d'eau, on évita un drame.
Le trou fut bouché en camouflant l'incident et le menuisier ne s'en aperçut
qu'en plein hiver lorsque la neige pesant sur notre réparation de fortune fit
tomber le tout. Nous avions évité la peine de mort car si le dépôt de menuiserie
avait brûlé ... ! Un grand nombre de chats des environs
disparaissaient, ils passaient à la casserole de même que le très bel hibou du
garde-forestier. Les œufs étaient ramenés des fermes en quantité industrielle ;
naturellement les camarades fermiers les négociaient et l'on pouvait avoir six
œufs pour un paquet de mauvais tabac. Au printemps, en vidant les fosses
d'aisances de notre Kommando pour répandre le contenu
sur un grand jardin du monastère, quelle ne fut pas la stupeur de nos geôliers
lorsqu'ils virent apparaître partout sur le terrain des coquilles d'œufs ! Ils
essayèrent bien de nous prendre en flagrant délit pendant le souper alors qu'on
était occupé à les cuire mais leurs pas martelés par de grosses bottes nous
avertissaient et l'on cachait tout. Il fallait charger un wagon de grosses
poutres, c'était un 15 août, jour non férié pour les Allemands. Nous venions
d'arriver du Stalag et, prétextant la faiblesse en raison de la maigre
nourriture reçue dans ce dernier, nous en laissâmes choir quelques-unes et l'on
nous dispensa de poursuivre le travail. Nos camarades français déchargeaient des
wagons remplis de bouteilles de vin de France. Ils s'amusaient à laisser tomber
les casiers en disant : « Tu veux en voir la couleur ? » Ceux que je vis agir
ainsi et que je connaissais en partie étaient devenus de leur plein gré « travailleurs
civils volontaires ». Ils vivaient dans des camps et jouissaient d'une certaine
liberté. C'était le résultat de la politique de Pétain qui avait permis cette
option. Mais ils n'étaient plus protégés par la Convention de Genève sur les
prisonniers de guerre. Et plus tard, lorsque nos alliés entrèrent en Allemagne,
ils demandèrent à redevenir prisonniers de guerre. Eurent-ils des ennuis pour
leur action ? Je l'ignore. Cela ne concernait pas les Belges. 
Me voici, à gauche, tenant la liste des camarades dont je suis resposable Le menuisier du monastère dut un jour
réparer le clocher de l'église; une pierre menaçait de tomber. Comme j'étais
temporairement occupé chez lui, je dus participer à cette équipée et l'on me
demanda de monter au sommet de la tour. J'avais une tendance au vertige et ce
ne fut pas chose aisée. Les escaliers s'arrêtaient loin du sommet et je devais
mettre un pied sur le support d'une cloche puis sur un autre afin d'atteindre
l'endroit où l'on avait besoin de mes services. Tout cela s'accomplissait
au-dessus du vide et l'on me tendit la main tellement j'étais craintif. Il faut
dire qu'un moindre faux pas m'aurait coûté la vie. Pour intervenir en cas d'incendie, on
plaça des sacs de sable dans tous les greniers du couvent et il me fallut
marcher comme un équilibriste sur la grosse poutre soutenant le toit du
vaisseau principal de la nef sinon on risquait de percer celui-ci et c'était
l'inévitable chute au milieu de l'église. Si au début nous vivions un peu comme
les pensionnaires d'un établissement d'instruction, conduits au travail en
rangs par notre sentinelle ayant l'arme à la bretelle, on finit par nous
séparer et il y eut l'équipe agricole et celle des bûcherons. La première englobait
cependant un tas de métiers: dégagement de la neige sur les chemins, travail à
la brasserie, à la menuiserie, peinture et maçonnerie. Quand l'abbaye vit sa
communauté religieuse dissoute par la Gestapo, un an après notre arrivée, les
bâtiments furent occupés par des réfugiés allemands de Bessarabie puis, lorsque
ces derniers partirent, on entreposa tous les biens volés aux Juifs dans les
pays occupés et l'on peignit le monastère en noir. Je fus réquisitionné par un
peintre viennois (on ne savait à quel travail m'affecter) et ce dernier me
demandait de faire marcher à la main la pompe destinée à projeter la couleur
et, si le tuyau se bouchait, il me disait « Pumpen,
Emile ». Le jour où les Américains arrivèrent, je
leur signalai ce que contenait le couvent et ils mirent immédiatement un
gardien pour empêcher les vols et aussi rétablir la justice, c'est-à-dire
permettre la restitution des biens volés. Les services médicaux étaient
rudimentaires. Je dus aller en fraude chez le dentiste du village qui, pour ses
soins, me réclama deux paquets de cigarettes américaines ! J'appris plus tard
que, nazi, il fut pendu par les Tchèques. Le dimanche, notre équipe de football se
mesurait à celle d'un Kommando de Leonfelden
en Autriche. Chaque fois que nous traversions l'ancienne frontière autrichienne
à l'aide d'une charrette de notre ferme, nous chantions l'hymne de la victoire.
Connaissant le piano, j'eus l'occasion
de donner des leçons... d'accordéon à la fillette de la ferme. C'est ainsi que
si l'on voulait s'amuser, le dimanche soir, on allait chercher l'instrument et,
avec un camarade qui s'était procuré un violon, nous organisions des séances de
chants et de danse. Les divertissements étaient rares. Le dimanche, on nous
conduisit deux ou trois fois au cinéma de la villette et le film qui me plut
beaucoup s'intitulait : « Histoire du baron Von Münchausen
». Des artistes belges se produisirent pour
un spectacle de variétés, l'unique d'ailleurs, et je reconnus deux chanteurs
que j'avais pu entendre à Liège, au « Britannique » et à Blankenberge au « Cécil ». Je leur parlai, les félicitai pour leurs
prestations, mais après la séance. En effet, je n'avais pas voulu monter sur
scène, comme l'avait demandé, à la cantonade, un officier allemand. Celui-ci
exigeait un discours de remerciements dans lequel il aurait fallu exprimer sa
reconnaissance envers les autorités allemandes. Je feignis ne rien avoir
entendu. Cet officier apprit plus tard mon identité et voulut me créer des
ennuis, mais mon « Kommandoführer » me défendit ; il
avait trop besoin de moi comme interprète ! Le même officier manifesta encore son
mécontentement lors d'une séance organisée par les prisonniers français à Kienberg (Loucovice), localité
située non loin de Vyssi Brod
et actuellement au bord de lacs artificiels créés après la guerre. J'aurais dû
féliciter ces derniers pour la pièce de théâtre qu'ils avaient jouée et qui consistait
à parodier la vie au Stalag XVII B : appels, travail, corvées, repas, séances
de désinfection, etc ... Le spectacle se terminait
par le fameux chant : « Maréchal, nous voilà ! » . Et à cette occasion, signalons que les
Allemands ne faisaient pas de distinction entre prisonniers français et belges,
sans doute parce que nous parlions la même langue. Dans les avis officiels, on
nous qualifiait de « Prisonniers occidentaux ». 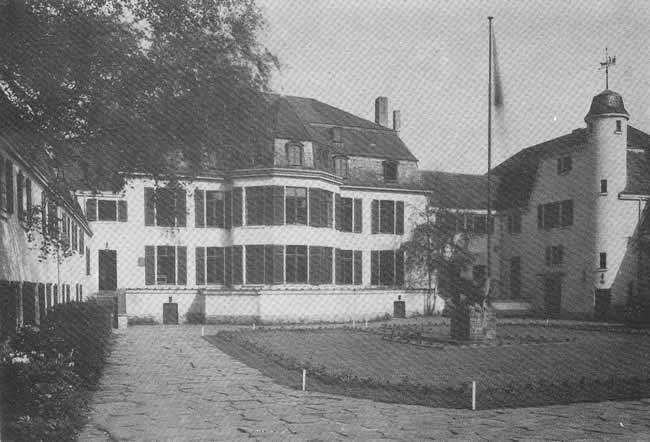
L’Athénée Royal de Rösrath, près de Cologne Certes la « collaboration pétainiste »
nous permit quelques maigres adoucissements dans notre vie de captif : départ
au travail sans gardien, promenade sans escorte pendant trois heures le
dimanche après-midi, un certain respect de la population qui nous croyait tous
collaborateurs parce que la presse signalait avec enthousiasme le départ des « légionnaires
» et des travailleurs « volontaires » de notre pays mais tout cela était peu de
chose par rapport au fait d'être séparés de notre famille, à l'obligation
d'accomplir des travaux très différents de notre condition professionnelle, au
manque de confort dans le logement, à la maigre nourriture distribuée et à
l'exil imposé. Une fois, certains des nôtres
s'habillèrent en femmes et se mirent à danser... Quelques jours plus tard, de
mauvaises langues de la localité vinrent se plaindre auprès de nos geôliers,
assurant que des femmes étaient venues danser dans notre local. Il y eut aussi les séances de
projections lumineuses. Une simple boîte à souliers percée d'un trou sur lequel
on avait placé un verre épais et une grosse ampoule encastrée dans la boîte
permettait de projeter sur un mur, en gros plan, les photos des membres de nos
familles et beaucoup de cartes-vues récoltées çà et là. Une troupe française vint jouer « Le
malade imaginaire » devant trois cents de nos camarades à Leonfelden
et l'on me demanda de faire sur la scène un petit discours pour remercier les
acteurs. Signalons encore l'histoire de la « clé
cachée ». Nous avions subtilisé la clé de notre chambre et notre geôlier dut
faire appel à un membre du parti, homme brutal, fanatisé, pour que l'on « fasse
semblant » de la retrouver après plusieurs heures de recherches. On parlait souvent avec les civils et
peu osaient dire ce qu'ils pensaient. Certains chez qui on sondait le terrain pour
connaître leur opinion nous déclaraient : « Nous devons nous taire sinon nous
risquons la pendaison ». Même ceux qui paraissaient naïfs se taisaient, parfois
terrorisés. Beaucoup croyaient que nous avions attaqué les premiers ! Un jour, je découvris dans un grenier,
un journal du 10-5-40, c'était le « Vôlkischer Beobachter » et en 1ère page, figurait
l'euphémisme : « Neutralité de la Hollande, de la Belgique et du Luxembourg
prise sous notre protection. » On ne parlait pas d'invasion. La plupart des habitants étaient
satisfaits d'avoir du travail, de la nourriture, et un bon salaire. C'était
l'euphorie créée par leur soi-disant libération du joug tchécoslovaque et aussi
par les nombreuses victoires que l'Allemagne venait de remporter. Tous les
postes de commande étaient dans les mains de gens du parti. D'ailleurs
n'était-ce pas une obligation d'en faire partie ? Le directeur de l'entreprise
était un hitlérien convaincu. Nous avions protesté parce qu'il nous saluait
ainsi que ses subordonnés d'un « Heil Hitler »
retentissant. Et à la suite de cela, tous nous rendirent notre salut par le
fameux « Grüsse Gott »
bavarois et autrichien. Quand les Allemands connurent leurs
premières défaites, les jeunes considérés comme indispensables durent rejoindre
le front. Il ne resta plus que des prisonniers de guerre et des travailleurs
étrangers dans la population masculine. 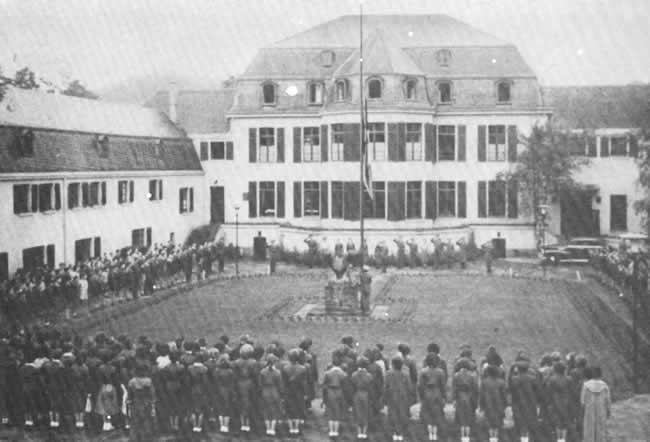
Salut matinal au drapeau, à Rösrath en 1952-1953 Et tout à la fin, c'était amusant de
voir les chefs d'entreprises défiler en rangs serrés sous le commandement de la
« Volksturrn », le dimanche matin. Une nuit, un nazi vint nous réveiller
pour construire un barrage d'arbres sur la route d'où allaient foncer les chars
américains. Nous refusâmes arguant de la convention de Genève. Quelques
semaines avant la fin de la guerre, les Allemands croyaient encore à la
victoire. « Nous devons vaincre » disaient-ils ! Les autorités allemandes
craignaient une rébellion de la part des prisonniers et des déportés à
l'approche des armées alliées, à tel point que le 7 juin 44, lendemain du
débarquement, une voiture occupée par quatre officiers de la Wehrmacht s'arrêta
devant notre Arbeitskommando. On me fit appeler,
comme homme de confiance et interprète, pour me demander si j'étais au courant
de « l'invasion ». Je répondis que je l'ignorais, ce qui évidemment était faux.
Un des officiers me déclara dans un mauvais français : « Ils sont déjà
repoussés. » La propagande battait son plein et le
commandant de la compagnie chargée de nous administrer ne manquait pas de nous
vanter les succès allemands, chaque fois qu'il venait nous inspecter. « La
guerre sera vite finie, déclarait-il, nous avançons vers... Odessa ! » On le
surnommait « Bouboule » étant donné sa carrure trapue. C'était un gros
gueulard. Dans
la scierie où je travaillais, le personnel recevait le journal de la région,
c'était « Die Volkstimme » et j'avais le loisir de le
parcourir à mon aise. Je ne doutais pas qu'il ne fût truffé de mensonges et
j'étais habitué aux « replis élastiques » ! Lors de l'entrée des alliés à
Bruxelles, je pus lire que la « populace » avait incendié le palais de justice
de la capitale ; or c'était l'occupant qui, de cette façon, avait détruit
toutes ses archives compromettantes. On y déclarait aussi que lorsque les Américains
étaient entrés à Eupen, ceux-ci auraient été tous tués si les yeux des Eupenois avaient pu tirer... En outre les communiqués
racontaient chaque jour que les bombes des alliés avaient uniquement atteint
des écoles et des hôpitaux... Il fallait être naïf pour croire à de telles
sornettes. Certains habitants d'Hohenfurth
s'imaginaient que la vie continuerait normalement après le passage des
Américains et mon directeur me disait : « Ce serait agréable si nous pouvions
tous continuer à travailler ensemble comme nous le faisons maintenant ! » ... Quelle ne fut pas la fureur du
contremaître de la scierie, quand le 1er mai 1945, lendemain du
suicide d'Hitler, un de nos camarades arbora un drapeau noir confectionné avec
une couverture ! Ces malheureux Allemands des Sudètes
ignoraient que, trois mois après la cessation des hostilités, ils seraient
chassés de leur pays. Et ce fut la libération. Les Américains
entrèrent dans la ville où chaque maison avait arboré un drapeau blanc. Nous
étions libres, nous déclara un officier américain et l'Etat-major allait nous
donner des bons de réquisition. Quelle joie de parcourir en vainqueur toutes
les rues de la cité ! Cela dura quinze jours puis un officier
U.S. mit deux cars à notre disposition et nous choisîmes deux chauffeurs parmi
nos camarades. Nous étions nombreux : Belges et Français des environs s'étaient
rassemblés chez nous. Je pus sauver un Alsacien de la captivité en lui
fournissant un pantalon kaki. Devant emporter un sac à dos avec le
strict minimum, je pénétrai dans un camion allemand, en vidai un et, à ma
grande stupeur, en sortis toute une lingerie féminine. C'était le sac d'une
infirmière allemande. Mais c'était la guerre et je n'avais rien sauf une valise
en bois que je plaçai chez le menuisier du village, valise qui me revint deux
ans après par l'ambassade de Belgique à Prague. Le tabac et le chocolat avaient
disparu. 
Le bâtiment des classes à Rösrath La plupart des Sudètes, eux qui avaient
tant cru à la victoire allemande, affichaient une mine déconfite. Il fallait
voir, le jour de l'arrivée des Américains, la population se livrer à de
nombreux pillages, s'emparant de ce qui se trouvait dans les camions allemands
abandonnés un peu partout. A l'école du village qui avait servi en dernier lieu
de caserne, les Sudètes choisissaient des bottines, des vêtements militaires,
du riz, de la farine et que sais-je encore. Nous y allâmes aussi. Les Américains séjournèrent plusieurs
mois à Hohenfurth. Il fallait neutraliser l'armée allemande
qui s'était retirée en Tchécoslovaquie et en Autriche. Nous fûmes les derniers à être libérés
par la glorieuse armée du général Patton. A quelques kilomètres de nous
s'étalaient déjà les troupes russes. En vertu des accords de Yalta, les
Américains évacuèrent la Tchécoslovaquie et les habitants de la région des
Sudètes furent chassés de celle-ci qui les avait vus naître. Ils furent transplantés
en Bavière, durent abandonner maison, meubles, bétail. Pendant des mois, celui-ci fut délaissé
et périt. Puis tout fut repeuplé par d'autres populations et la vie reprit son
cours. Un immense lac artificiel fut créé à Lipno, localité au sud d'Hohenfurth, et hameaux, fermes, prairies, bois y furent
engloutis. Mais Hohenfurth,
localité importante, a retrouvé une nouvelle vie, au coude de la Vitava, aux confins de la Bohême. On l'appelle Vyssi Brod et elle est
entièrement tchécoslovaque. Je pris congé d'un brave prêtre qui
desservait la basilique du monastère. S'il nous parlait avec anxiété pendant
notre captivité, il exprimait maintenant sa joie d'être un homme libre. Je le
mis en contact, en latin, avec l'aumônier américain, pour qu'il explique la
situation du monastère séquestré par le Reich. Il me reçut chez lui avec un camarade
et nous passâmes une charmante après-midi en bavardant autour d'une table où le
café et les petits gâteaux donnaient un air de fête. Le conservateur viennois, ancien major
de l'armée autrichienne, chargé de veiller sur la collection des monnaies de
Vienne amenées à Hohenfurth, me reçut dans son
appartement et me demanda d'écrire quelques lignes dans son livre d'or, ce que
je fis volontiers. Je constatai que la signature du chancelier Schussnig figurait sur une page proche de celle où j'avais
apposé la mienne. Plusieurs personnes avec qui j'avais eu
d'excellents rapports et qui étaient contre le régime, m'écrivirent après la
guerre et je leur répondis. Puis, le temps faisant son œuvre, on perdit tout
contact. D'autant plus que les Sudètes durent émigrer et, si je devais
retourner dans cette ville, je crois que je ne retrouverais plus aucune
connaissance. C'est en effet en Bavière et en Hesse que la plupart résolurent
de s'installer. La guerre avait provoqué de multiples
transplantations de peuples et lorsque nous vîmes ces files de réfugiés,
Hongrois, Roumains et autres fuyant la zone des combats, on se mit à penser à
l'exode de 1940 chez nous, quand de nombreuses familles poussant des charrettes
de toutes espèces se dirigeaient vers le Sud, espérant échapper aux horreurs du
terrible fléau. Tout un personnel travaillait au service
de ce conservateur dont j'ai parlé ici plus haut. Un certain Ruckert, nazi convaincu et anti-juif acharné, m'adressait
souvent la parole pour discuter des événements. Lorsque le Japon et l'Amérique
entrèrent en guerre, il m'assura que cette situation allait précipiter la fin
des hostilités. Ce personnage, installé en 1941, avec sa
femme et sa fille, dans une aile du couvent dissous, changea d'opinion devant
le chagrin de sa fille Lola dont le mari, officier, venait d'être tué en
U.R.S.S. Celle-ci, tout de noir vêtue, ne savait comment soulager sa peine et,
à l'occasion de la Noël, m'offrit un petit colis accompagné d'une lettre où
elle exprimait sa douleur, tout en me faisant espérer un retour proche auprès
des miens. Cette famille m'invita même à goûter puis, un beau jour, sans le
moindre petit adieu, quitta précipitamment la villette. Certaines idylles
amoureuses se produisirent chez des prisonniers célibataires et, si l'un de nos
camarades vint, après la guerre, rechercher celle qu'il avait aimée en travaillant
dans une ferme et l'épousa, il n'en fut pas de même d'un autre qui ne donna
plus signe de vie à la jeune fille qui se trouva enceinte après son départ. Dans ce dernier cas, il y avait eu
mariage à la maison communale d'Hohenfurth, après
l'arrivée des Américains mais, en raison de l'expulsion des Sudètes, les
archives de l'état-civil furent probablement détruites et le prisonnier de
guerre ne fut pas inquiété. Peut-être fut-il désapprouvé par sa famille ? Les prisonniers de guerre rentrés chez
eux, sans cérémonie aucune d'ailleurs, se remirent au travail, dispersés à tous
les coins de leur patrie. Beaucoup de gens semblaient avoir oublié qu'à la
capitulation, l'armée belge avait été faite prisonnière dans sa totalité sur
ordre du Reich et de nos chefs militaires qui obligèrent les régiments à rester
groupés. Le fait d'avoir donc été P.G. ne pouvait être considéré comme un
déshonneur ou une faute de tactique au combat, surtout que celui-ci était très
inégal. 
Une de mes classes dans le magnifique cadre de verdure de l’Athénée Souvent pendant ma captivité, mon passé
d'enseignant s'emparait de mon imagination vagabonde et de multiples réflexions
surgissaient dans mon esprit ! Moi qui me plaignais de donner cours à des
classes toujours très nombreuses, qui rentrais à mon
domicile fatigué, énervé, tracassé, que devais-je penser maintenant ? Tout cela
n'était rien à côté des pénibles travaux manuels que je devais exécuter et des
souffrances morales que, comme tout prisonnier de guerre, je ressentais. Heureusement l'espérance nous soutint au
fil des jours et notre libération s'accompagna de la victoire ! CHAPITRE VI L'APRES-GUERRE De retour au pays, je connus la joie de
revoir tous ceux qui m'étaient chers. Un congé de repos de trois mois nous
ayant été accordé, je pus faire le tour de la famille. Mais quel bonheur de retrouver son pays,
ses amis, les gens que l'on voyait si souvent avant la guerre ! Je me remis rapidement
à la vie normale et mes yeux s'émerveillaient à la vue des étalages des
magasins. La sensation d'être désormais un être libre s'amplifiait chaque jour. Dès que l'année scolaire recommença, un
25 septembre, je repris mes occupations avec un plaisir et une ardeur sans
pareille. Mon directeur s'étonnait de ma réadaptation rapide. Quatre ans après mon retour, je fondai
un foyer et la vie s'écoula paisiblement, ayant retrouvé ma situation dans ce
même collège de Liège. Puis en 1952, pour des raisons
administratives, ma place fut supprimée et le ministère me désigna pour
l'athénée royal de Rôsrath à 17 km de Cologne. Une
nouvelle vie commençait. J'avais quitté l'Allemagne le 17 mai
1945 et je la retrouvai sept ans après. Celle-ci se relevait tout doucement
mais il y avait encore à Cologne des rues bordées par des monceaux de ruines.
La cathédrale dont une des tours avait été frappée de plein fouet par une bombe
n'était que partiellement réparée. Il en était de même pour la gare dont
l'immense verrière ne gardait cependant aucune trace. Les Allemands étaient depuis longtemps
résignés à la défaite et l'aide apportée par le plan Marshalles
avait réconfortés. Les Belges étaient respectés et des places de parking
étaient réservées aux alliés devant la cathédrale. Les marchandises coûtaient fort cher et
pour nous, la bonne période était révolue. Je n'ai pas connu l'époque où l'on
circulait en tramways pour deux cigarettes belges ni celle où les Allemands étaient
amateurs de notre café. Les Belges vivaient dans des cités et
leurs maisons, nouvellement construites, étaient fort confortables. Il y avait
peu de contact avec la population allemande. A part le pain et la viande, tout
s'achetait à la cantine militaire. Lorsque l'on s'adressait aux Allemands
du gros village où s'est établi l'athénée pour enfants des militaires, il n'y
avait d'après eux aucun ancien membre du parti nazi. Tous avaient fui. La plupart des habitants venaient de l'Allemagne
de l'Est où ils possédaient des hôtels ou de grandes entreprises. Le mythe
Hitler s'était évanoui et l'on n'en parlait jamais. Plusieurs avaient été prisonniers en
France, en Belgique, en Amérique même mais leur captivité n'avait pas été si
longue que la nôtre. Ceux qui se trouvaient en U.R.S.S. y restèrent
malheureusement beaucoup plus longtemps et, suite à l'intervention d'Adenauer,
revinrent seulement après 8, 10, voire 12 ans. On s'aperçut alors que beaucoup avaient
disparu et, lorsque les trains de rapatriés arrivaient, le quai était rempli de
mères ou d'épouses qui tenaient une pancarte avec le nom de l'être attendu. L'athénée de Rôsrath
dépendait à cette époque du ministère de la Défense Nationale. Les professeurs
portaient l'uniforme d'officier, étaient soumis aux règlements militaires et ne
pouvaient regagner la Belgique qu'avec un titre de congé auquel on avait droit
dix fois par an. Le lundi et le jeudi, à sept heures quarante-cinq se déroulait le salut au drapeau. L'inspecteur-préfet et les professeurs ayant cours à la première heure y assistaient dans la cour d'honneur devant les élèves mis au « garde à vous » et portant aussi un uniforme militaire : les garçons en « battle dress » et les jeunes filles en tailleur bleu comme des hôtesses de l'air. Après la cérémonie, les enfants gagnaient leurs classes en rangs et au pas cadencé. On se serait cru dans une caserne ! Quand j'arrivai à la gare de Cologne, le 14 septembre 1952, un dimanche soir, veille de la rentrée des classes, j'étais désemparé. Je téléphonai à un collègue qui voulut bien me conduire à l'endroit que l'on m'avait destiné : un home de repos pour sous-officiers. En entrant, je fus saisi par le brouhaha qui régnait dans une salle immense et bondée de gens devisant joyeusement pendant qu'un orchestre allemand égrenait des mélodies connues. C'était en somme un lieu de rencontres des familles belges. Je devais y loger six semaines avec un autre professeur et, comme il n'y avait que nous deux pour rester à demeure dans ce home, nous écoutions l'orchestre pour nous seuls en choisissant même nos morceaux puis nous montions travailler dans nos chambres vers dix heures. L'occupation de l'Allemagne était toute différente de celle que j'avais connue à partir de 1922 à Krefeld, cette magnifique ville de Rhénanie où j'avais vécu avec mes parents jusqu'en 1924. A cette époque, les Belges étaient les grands maîtres et vivaient dans des maisons réquisitionnées; ils étaient vraiment incorporés à la population allemande. Malgré la nostalgie que provoque chez certains l'éloignement de la patrie, nous vivions heureux dans un pays où tout se vendait à un prix dérisoire. Mais cela ne dura guère ; l'inflation arriva rapidement et l'on vit apparaître des billets de milliards de marks. Ensuite vint le mark-or avec le renchérissement des denrées. L'Allemagne ne payant pas ses dettes, la Rhur fut occupée, tous les chemins de fer furent administrés par les pays alliés et je revois encore nos militaires tenant le rôle de chefs de gare et exerçant toutes les activités ferroviaires. Un jour de juin 1955, je partis de Rôsrath pour aller revoir Krefeld, ville dont je gardais d'excellents souvenirs d'enfance et je la trouvai fort meurtrie par la guerre. L'immense gare au cachet imposant et la « Dyonisus-kirche » où se déroulaient nos cérémonies religieuses étaient restées intactes. Une seule des trois demeures que nous avions habitées était encore debout. Aussi, c'est impressionné par tout ce que j'avais retrouvé après tant d'années que, comparant le passé au présent, je vaquai le lendemain à mes occupations quotidiennes. Après quelques années, l'athénée fut repris par le ministère de l'Education Nationale et la vie s'y déroula comme dans tous les établissements scolaires de Belgique. Le tourisme s'étant développé, le passage de la frontière fut facilité et de nombreux civils visitèrent l'Allemagne. Aujourd'hui ce pays s'est nettement relevé et les traces de la guerre ont complètement disparu. Une gare moderne à Cologne a remplacé l'ancienne et la cathédrale est tout à fait restaurée. J'étais parti pour deux ans et j'y restai plus de vingt-quatre années, jusqu'à la limite d'âge. Je pus me rendre compte que notre armée s'était modernisée : elle avait ses chars, ses véhicules blindés, ses parachutistes, une aviation de classe, une force navale, des fusées et des armes anti-chars. Aux unités de nos alliés, nos troupes n'avaient rien à leur envier. L'organisation de notre « dixième province » était vraiment réussie. On y trouvait comme actuellement, de véritables petits villages, de coquettes cités, de jolies chapelles, des écoles aux bâtiments spacieux et où se donne un enseignement de qualité, des cantines, des centres sportifs, des clubs, etc ... La guerre était bien oubliée et notre jeunesse fraternisait avec celle d'une grande nation très accueillante. Le retour définitif au pays posera à beaucoup des problèmes de réadaptation. Mais il faut avoir confiance ! Avec de la bonne volonté et de la patience, on triomphe de toutes les situations. Beaucoup en ont déjà fait l'expérience et de plus les retours pour un court laps de temps sont devenus fréquents grâce à la création de voies rapides. Celles-ci ont permis de multiplier les contacts avec la mère-patrie. CONCLUSION D'aucuns pourraient croire, qu'après une
quarantaine d'années, beaucoup de souvenirs se sont estompés. Pour moi, il n'en est rien et mon
imagination vagabonde aisément dans le passé. Tous ces événements surgissent
dans mon esprit comme s'ils étaient récents et de nombreux détails ne
m'échappent point. Certes il y aurait encore beaucoup de
choses à rappeler mais je doute que des faits pour moi trop anodins aient pu
intéresser le lecteur. Si j'ai vécu une carrière de professeur
sans histoire, si je me suis trouvé dans des classes de toutes espèces pendant
trente-cinq années, je n'ai pas connu de faits transcendants comme ceux qu'il
m'a été donné de subir pendant la dernière guerre. Cette longue période d'août 1939 à fin
mai 1945 constitue pour moi une importante tranche de vie et elle m'a permis de
mûrir et de connaître davantage le caractère humain. Malgré la guerre qui embrase certains
endroits du globe et bien que les pays continuent à s'armer à outrance, il faut
espérer qu'un jour les hommes finiront par s'entendre et surtout par s'aimer. Alleur-Ans,
le 18 mai 1985, Un grand merci aux « Editions DRICOT » de Visé de nous avoir autorisé la retranscription de ce magnifique travail. |
© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©