 Maison du Souvenir
Maison du Souvenir

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Comment nous rendre visite
-
Comment nous rendre visite
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Le comité
-
Le comité
-
![]() Nos objectifs
-
Nos objectifs
-
![]() Articles
Articles
![]() Notre bibliothèque
-
Notre bibliothèque
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Photos
-
Photos
-
![]() Signer le Livre d'Or
-
Signer le Livre d'Or
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
Lidia, la
fillette de trois ans qui survécut 11 mois à Auschwitz 
Lidia à l’âge de cinq ans Nous venons
de nous remémorer l’enfer d’Auschwitz 80 ans après sa libération. Lidia
Makysymowitz est parmi les rares survivantes qui vivent encore en 2025. Son
histoire est bouleversante. Ses parents étaient des résistants catholiques
biélorusses. Cachée dans une sorte de cave à pommes de terre, une
« Zemlyanka », creusée dans la forêt jouxtant la frontière de la
Pologne, leur repaire avait été découvert par les soldats allemands… Le père avait pu s’échapper mais la mère,
Anna Boczarowa, leur fille Luda (plus tard, son prénom deviendra Lidia) et les
parents d’Anna sont emmenés à Auschwitz. Luda vient
d’avoir trois ans et sa mère 22 ans quand elles débarquent de leur wagon, en
décembre 43, sur la rampe du camp maudit. Aussitôt les déportés sont
sélectionnés. Les grands-parents de Luda sont dirigés vers les chambres à gaz
tandis que la mère et sa fille passent devant le SS sélectionneur. Ce dernier
n’est rien d’autre que le docteur Mengele. Luda est un bambin tout menu, aux
traits très fins… Mengele tombe sans doute sous le charme de l’enfant qui est
épargné pour devenir un de ses sujets d’expérimentation. Luda est alors séparée
de sa mère et emmenée dans la baraque qui recueille les enfants destinés aux
études sordides du médecin nazi. On imagine aisément les affres de cette
séparation mais elle a sans doute permis que Luda et sa mère puissent rester en
vie car, sur la rampe, toutes les femmes et enfants débarqués ensemble étaient
destinés à la chambre à gaz. Luda n’a que
trois ans mais des « flashs » de souvenirs de cette époque lui
resteront à jamais : le regard du sélectionneur, le visage de sa mère au
moment de la séparation… le tatouage de son numéro. Dans les premiers jours de
la séparation, sa maman, gardée en vie comme main d’œuvre, parviendra, de temps
à autre, à quitter son bloc pour rendre visite à sa fille. Chance incroyable,
son bloc n’est qu’à cinquante mètres de celui des « enfants de
Mengele » mais pour y arriver, elle doit ramper dans l’obscurité, avancer
dans la boue mètre après mètre pour ne pas être repérée par les sentinelles.
Cela représentait un énorme risque. Luda raconte dans ses mémoires qu’à
l’occasion d’une de ces visites, sa mère fut repérée, sans doute par le kapo du
bloc. Elle dut alors se défaire des quelques oignons qu’elle comptait donner à
sa fille avant d’être tabassée au point de perdre ses dents de devant ! Le bloc des
enfants est affreusement sale. Il n’y a pas d’eau. La Kapo occupe une pièce à l’entrée et règne sur
les enfants avec un bâton et un fouet !. Le régime consiste en un peu de
pain et de soupe et avec parfois une espèce de café préparé avec des herbes.
Les seuls évènements qui ponctuent la journée sont l’appel dans le bloc et les
visites de temps à autre de Mengele qui vient chercher des enfants pour ses
expériences. Luda est si menue qu’elle parvient de temps à autre à se
soustraire aux expériences en se cachant dans les coins les plus inaccessibles
du bloc. Les enfants cherchent à disparaître de n’importe quelle façon et leur
ultime recours est de croire que se cacher leur visage avec les mains suffit à
les rendre invisibles du SS ! Les enfants ne peuvent sortir du bloc et les
journées se passent pour eux assis sur les planches qui servent de lits, les
jambes pendantes et leurs têtes dodelinant sans arrêt. Avec la
malnutrition, des furoncles apparaissent sur le corps des enfants jamais lavés
et la mort devient coutumière dans ce bloc. Malgré ses cachettes, Luda est
sélectionnée à plusieurs reprises pour des transfusions sanguines ou des
inoculations de substances, notamment dans les yeux. Souvent, on la ramène
évanouie. De Mengele, Luda se souviendra, non de ses traits, mais de son regard
glaçant. Un jour, Luda fiévreuse est envoyée à l’hôpital du camp qui comprend
un service de pédiatrie où une
doctoresse russe (sans doute une erreur, il doit s’agir d’une pédiatre
allemande du nom de Lucie Adelsberger) fait ce qu’elle peut avec des moyens
dérisoires. Cette médecin est prise de pitié devant Luda et parvint à faire
muter sa mère à l’hôpital comme femme de
corvée. C’est là un véritable miracle
car la maman de Luda peut à nouveau s’occuper de sa fille pendant quelques
jours, ce qui augmente considérablement ses
chances de guérison… Mais, un jour, alors que Luda entame sa convalescence, les
rumeurs font part d’une prochaine sélection dans le bloc de la pédiatrie : les
enfants trop faibles et désignés par le médecin SS seront conduits vers une des
quatre chambres à gaz. La maman de Luda, avec la complicité de la doctoresse
parvint cependant à faire « enlever » sa fille par un prisonnier,
homme de corvée, qui va la déposer dans
le bloc des enfants cobayes. La Kapo accepte le retour de l’enfant sans trop de
problèmes et Luda retrouve à nouveau la désastreuse ambiance de la prison pour
enfants. Le séjour de
Luda dans ce bloc durera 13 longs mois, jusqu’au jour où le camp, menacé par
les troupes russes, est évacué. Les prisonniers entament alors une « marche
vers la mort » dans le froid glacial de janvier 45. Les enfants et les
malades grabataires sont abandonnés dans le camp. Luda se souvient de la
dernière visite de sa maman dans son bloc : sa mère lui avait pris la tête
entre ses mains pour l’observer longuement et l’embrasser avant de lui faire
son ultime recommandation : « N’oublies jamais ton nom et d’où tu
viens ! ». Luda gardera effectivement en mémoire la phrase qui beaucoup plus tard lui sera précieuse :
« Je suis Luda Boczarowa, j’ai
cinq ans et je viens de Bielorussie » ! Les enfants
restent enfermés dans leur bloc malgré le départ de leur kapo. Heureusement
pour eux, l’attente ne sera que de 36 heures.
Les soldats Russes rentrent dans le camp et, dans leur sillage, les
femmes de la ville d’Oswiecim[1]
qui jouxte Auschwitz Birkenau. Ces femmes ont pitié des enfants du bloc et les
recueillent alors dans leurs foyers. Une d’entre elle recueille ainsi Luda
désespérée de ne pas avoir retrouvé sa mère. Elle quitte le camp avec cette
Polonaise qui la sauve de l’enfer et qu’elle appellera beaucoup plus tard
« maman Bronislaw ». Luda ne pleure cependant jamais en pensant à sa
maman disparue car dans son bloc, pleurer, crier était des comportements punis
par les coups de la Kapo. Elle avait donc appris à cacher ses sentiments pour
survivre. Luda sera
élevée avec amour mais non sans une certaine sévérité, par cette Polonaise et
son mari restés sans enfants. Quand ses parents adoptifs décidèrent de la
baptiser, ils lui donnèrent le nouveau prénom de Lidia. Lidia est une petite
fille qui s’épanouira dans la Pologne de l’après-guerre malgré tout ce qu’elle
a subi ; sa famille d’accueil est pauvre mais personne n’est triste. Lidia
n’oubliera cependant jamais sa vraie mère. Adolescente, elle écrit au siège de
la Croix-Rouge internationale à Hambourg qui lance alors une recherche pour
trouver ses parents. Les mois passent mais, un jour, on lui communique que l’on
a retrouvé trace de sa mère en URSS et que celle-ci la recherche désespérément
depuis des années. Sa maman, survivante de la marche de la mort, avait subi
plusieurs semaines de soins médicaux après sa libération (elle n’avait plus que
37 kg). Par après, elle eut la chance de retrouver, à Minsk son mari vivant. Ce
dernier s’était engagé dans l’armée russe après s’être échappé de Biélorussie.
Le couple reconstitué avait ensuite recherché leur fille dans tous les
orphelinats de l’URSS puisqu’on leur avait dit que tous les enfants orphelins
de Birkenau y avaient été envoyés. Lidia se
maria avec le fils d’un voisin polonais nommé Arthur Maksymowicz en 1961 à
l’âge de 21 ans, juste avant d’être informée par la Croix-Rouge que ses parents
l’attendaient avec impatience à Moscou. La rencontre miraculeuse après tant
d’années est préparée et médiatisée par
le régime soviétique. Une date est fixée en 1963 et pleine d’appréhension pour
cet évènement à la fois tant désiré et tant craint, Lidia s’embarque, avec
toute sa famille adoptive, dans le train qui l’emmène à Moscou. A l’arrivée,
sur le quai, c’est une foule qui l’accueille. Maman Anna, la vraie mère de
Lidia, en apercevant sa fille, s’évanouit d’émotion et les secours doivent la
prendre en charge. C’est son père bouleversé qui vient alors à sa rencontre en
pleurant ! Après la longue séance photo, tous les arrivants sont
transportés dans un hôtel et c’est seulement dans le salon de l’établissement
que fille et mère s’embrassent après 18 ans de séparation. Suivent des heures
frénétiques jusqu’à la visite prévue au Kremlin suivi d’un long voyage organisé
dans de nombreux endroits de l’URSS. Lidia a alors l’occasion de faire
connaissance avec ses deux sœurs nées après la guerre. L’angoisse reste
cependant encore présente chez la jeune femme qui craint l’avenir. Elle
soupçonne les autorités russes et sa maman de vouloir la convaincre de
rejoindre la localité de sa famille naturelle à Donetsk mais Lidia, elle se
sent maintenant plus polonaise que russe. Finalement, ce qui la sauve de ce
dilemme est son récent mariage qui lui donne le prétexte de rejoindre son
nouveau foyer polonais à Oswiecim. L’apaisement le plus grand à ses angoisses
lui fut obtenu lorsque ses deux mamans se serrèrent dans les bras l’une de
l’autre ! Lidia garderait alors ses deux mamans aussi précieuses pour elle
l’une que l’autre ! 
A gauche la maman adoptive, au centre Lidia, à droite sa mère naturelle Anna Boczarowa, à l’hôtel Leningrad de Moscou. (Photo extraite du livre « La petite fille qui ne savait pas haïr » Editions J’ai lu N°14133) 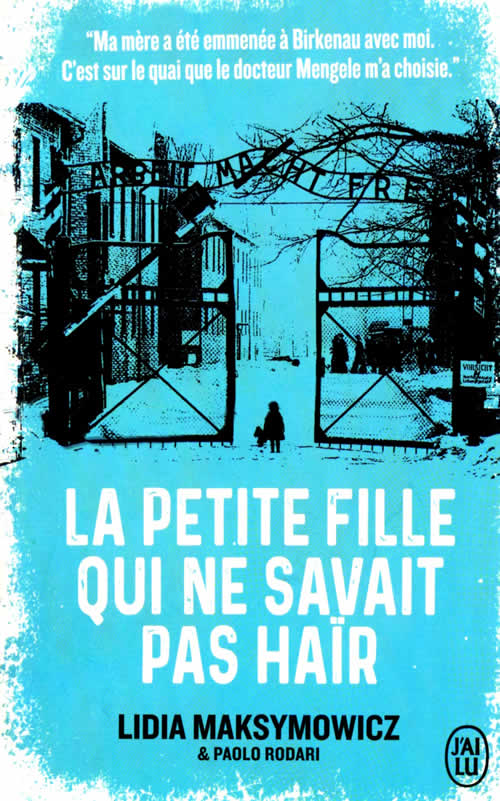
Lidia (elle
gardera son prénom polonais) accueillit
le pape Jean-Paul II en 1989.
Il posa sa main sur sa tête. En 2006 c’est Benoit XVI qui visita le camp
et qui impressionna Lida par son attitude de silence et de prière. Seul, il s’est
assis sur un banc face aux dortoirs des détenus et il est resté un quart
d’heure immobile les mains jointes… En 2021, elle rencontrera
le pape François qui se penche sur elle et dépose un baiser sur son
tatouage 70072. 
Conclusion L’histoire de Lidia nous rappelle évidemment la résilience extraordinaire
d’un enfant mais nous introduit aussi dans l’enfer d’Auschwitz qui restera à
jamais comme un sinistre et immense nuage noir surplombant immobile notre
pauvre terre. Rien, absolument rien ne pourra sur cette terre compenser
l’extraordinaire somme de souffrance subie par les millions de détenus des
camps d’extermination SS. Les cris de ces souffrants sont restés ignorés des
hommes de leur époque et, plus interpellant encore, le nombre incalculable de
prières montées vers Dieu d’Auschwitz n’ont pas reçu de réponse. Existe-t-il
pourtant un endroit au monde qui fut plus priant que cet endroit ? La Shoa nous
a fait en tout cas découvrir une chose Dieu, s’il existe, n’est pas tout puissant.
Le monde appartient bien aux hommes et ils en font ce qu’ils veulent. Mais si
Dieu ne put arrêter les tortures morales et physiques, il fut cependant bien
présent dans ces lieux de déréliction absolue. Il y fut présent à la fois comme
victime et comme témoin. Une jeune femme, Etty Hillesum, exprime
merveilleusement ce paradoxe qu’elle découvre dans le camp de Westerbork où
l’on rassemble, en Hollande, les Juifs avant de les envoyer à Auschwitz. Sur
terre, ce n’est pas à Dieu de nous aider mais nous à l’aider ! « Je
vais t’aider mon Dieu à ne pas t’éteindre en moi mais Je ne peux t’en garantir
d'avance. Une seule chose cependant m'apparaît de plus en plus claire : ce
n’est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t’aider et ce faisant nous
nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qu'il nous est possible de sauver en
cette époque et c'est aussi la seule chose qui compte : un peu de toi en nous,
mon Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à mettre au jour dans les
cœurs martyrisés des autres. Ou mon Dieu, tu sembles assez peu capable de
modifier une situation finalement indissociable de cette vie. Je ne t’en
demande pas compte, c'est à toi au contraire de nous appeler à rendre des
comptes, un jour. Il m'apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation
de mon cœur que tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à nous de t’aider et
de défendre jusqu’au bout la demeure qui t’abrite en nous (…). (Etty Hillesum,
« Une vie bouleversée », page 175, collection Points, Editions du
seuil, 1985) Le
psychiatre Viktor E. Frankl, lui-même ancien déporté, dira la même chose avec
d’autres mots : Trop souvent nous nous demandons « Que
puis-je attendre de la vie ? » au lieu de « Qu’attend la
vie de moi ? » Ce rescapé
autrichien des camps où il a perdu toute sa famille, notamment son épouse
enceinte deviendra célèbre en tant que fondateur de la logothérapie. Se révolter
contre Dieu, ou plutôt lui crier notre stupéfaction qu’il n’ait pas agi devant
la mort infâmante que les nazis ont imposé à des millions d’hommes, de femmes,
d’enfants est une attitude normale…Mais à nouveau, et c’est un grand mystère,
il faut considérer que Dieu lui-même souffrit, à un point que nous ne pouvons
imaginer, de la destruction de tant de ses créatures dans lesquels il vouait
établir sa demeure. Reste encore aujourd’hui à supplier Dieu d’honorer non la
vengeance mais la justice en rétablissant, sans doute d’une manière dont nous
ne pouvons imaginer, la vie de toutes les victimes de la barbarie. Justice et
non vengeance. Curieusement la plupart des rescapés abandonnèrent la haine.
Etty Hillesum pensait qu’il suffit d’un seul homme digne de ce nom pour que
l’on pût croire en l’homme, en l’humanité, d’un seul « Allemand »
respectable pour qu’il soit interdit de déverser sa haine sur un peuple entier.
Le psychiatre Frankl, dans la même ligne de pensée, rappelait un ancien mythe
affirmant que l’existence du monde était fondée sur la présence en tout temps
de 36 personnes vraiment justes. Seulement 36 ! Une minorité
infinitésimale et cependant elles assurent l’existence morale continue du
monde. Pour les
rescapés comme pour nous, l’image insoutenable d’enfants, de bambins marchant
innocents de la rampe d’Auschwitz vers les chambres à gaz nous fera toujours
supplier justice et donc compensations pour ces créatures à l’image de Dieu.
Quant aux hommes possédés par la haine, nous n’en avons aucuns soucis ! Autre
certitude des rescapés : pour éviter de pareils séismes causés par
l’homme, il faut être occupé par sa propre révolution. Etty Hillesum dira que
chacun fasse une révolution sur lui-même et extirpe et anéantisse en lui tout
ce qu’il croit devoir anéantir chez les autres. Et Soyons bien convaincus que
le moindre atome de haine que nous ajoutons à ce monde nous le rend plus
inhospitalier qu’il n’est déjà ! (Etty Hillesum, « Une vie
bouleversée », page 218, collection points, éditions du Seuil, 1985) La
doctoresse Lucie Adelsberger, qui fut elle-même déportée à Auschwitz, nous dira
aussi que le monde doit savoir qu’une petite étincelle de haine peut se
transformer en un brasier très violent, que personne ensuite n’arrive à
circonscrire (…) Une pincée d' antisémitisme de salon, un peu d'antagonisme
politique et religieux, le rejet de celui qui pense différemment en politique,
en soi un inoffensif fourre-tout, jusqu'à ce qu'un dément arrive et en fasse de
la dynamite. Il faut comprendre cette synthèse si l’on veut éviter dans
l’avenir que des choses se passent comme à Auschwitz. Quand la haine et la
calomnie germent à bas bruit, alors, cela veut dire qu'à ce moment, il faut
être éveillé et être prêt. C'est cela le testament de ceux d'Auschwitz. (Lucie Adelsberger, « Une pédiatre à
Auschwitz, page 209, 2024, Editions Anne Carrière) De la poussière, il relève le faible, Dr Patrick Loodts [1]
Oswiecim est une petite ville de
34.000 habitants où fut implanté le camp de concentration d’Auschwitz. Vivre
dans cette cité, c’est vivre avec une dimension tragique, cependant les
habitants tiennent à rappeler que leur cité date de 800 ans alors que le camp
n’a qu’un peu plus de 80 ans d’existence. Avant-guerre, plus de 60% de la population était juive. Aujourd’hui, la
ville se rappelle de cette présence par un musée d’histoire juive et conserve
un vieux cimetière juif, miraculeusement conservé. Les habitants doivent
souvent faire face à de nombreux défis comme vivre normalement auprès d’un site
qui reçoit près de deux millions de visiteurs par an. |
© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©