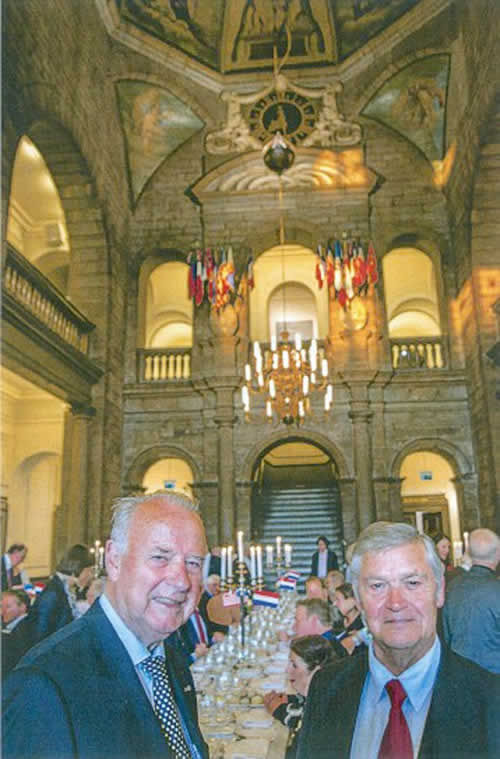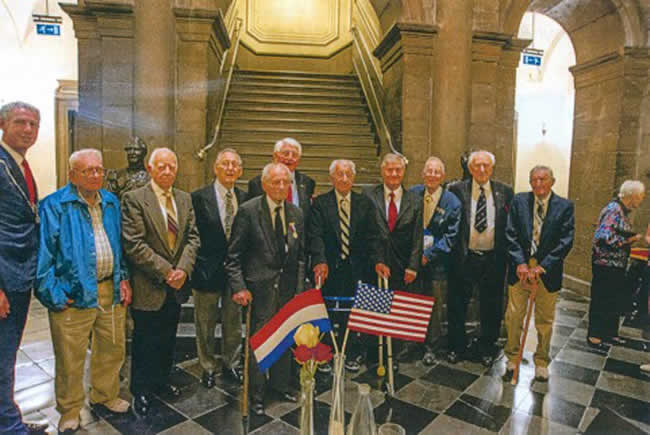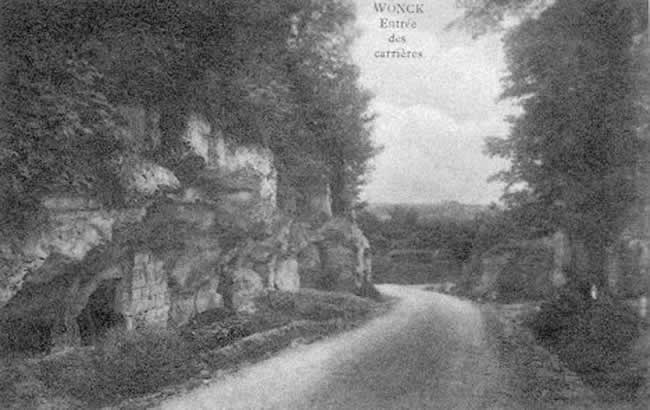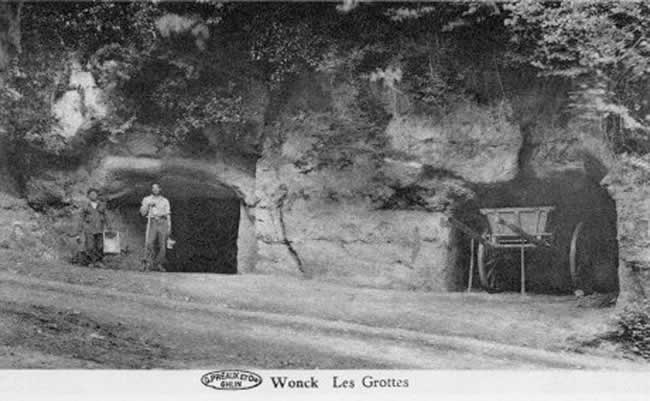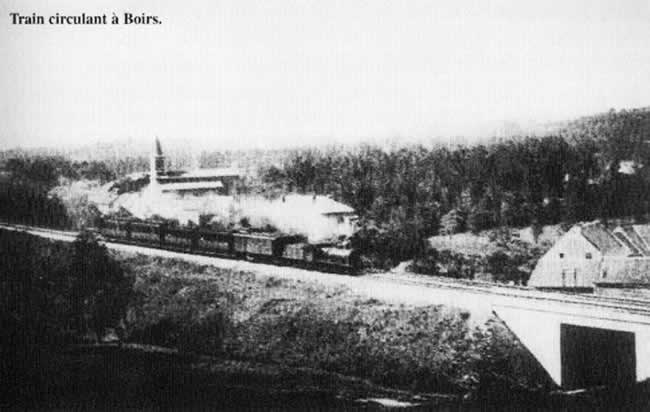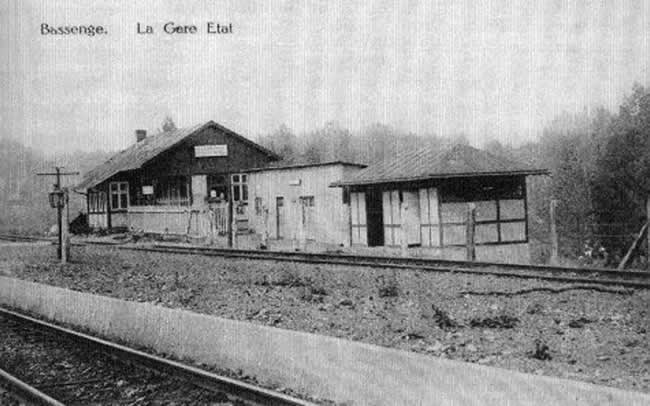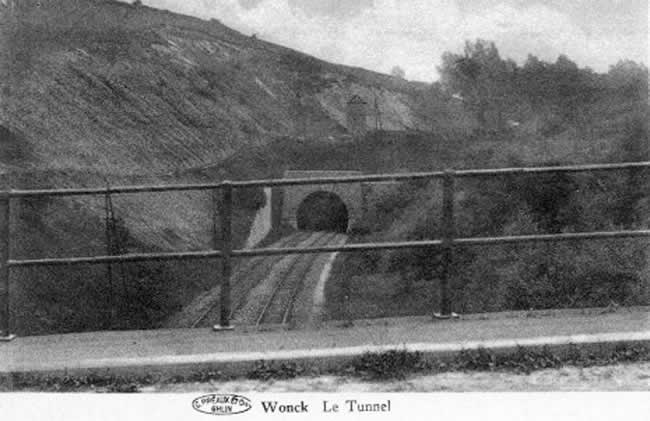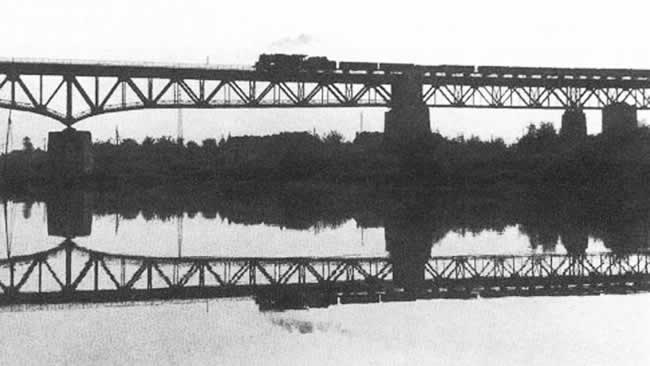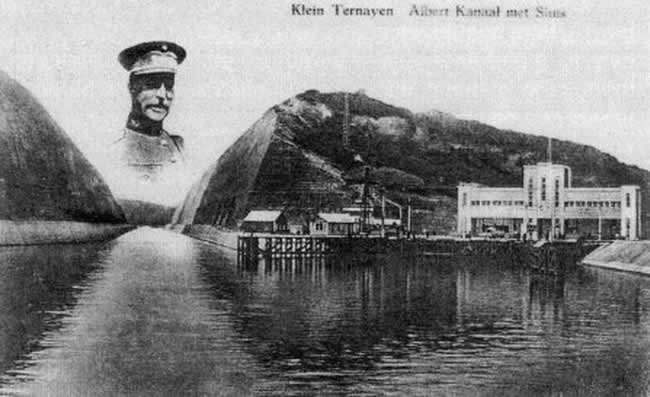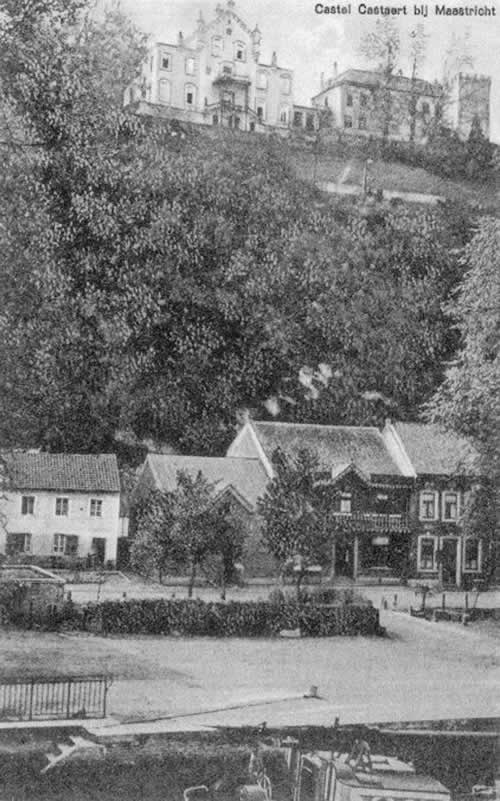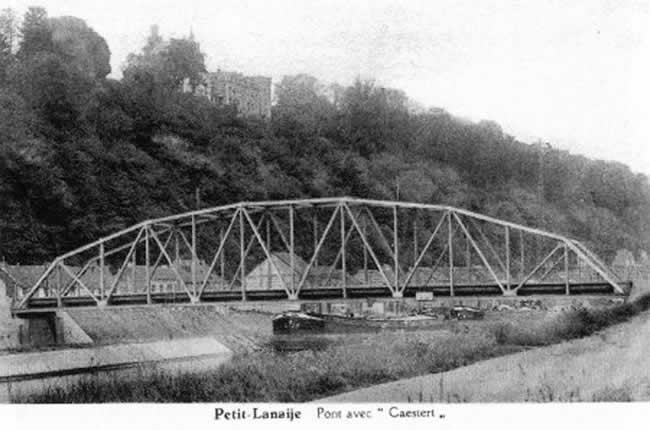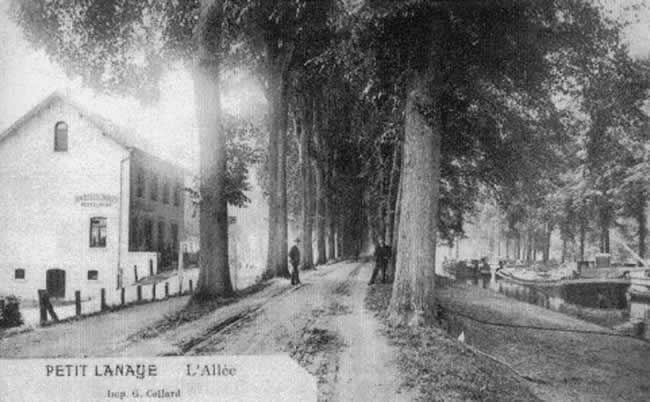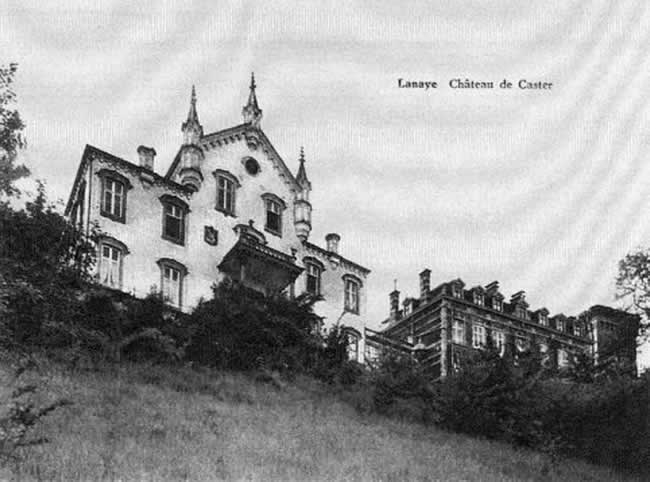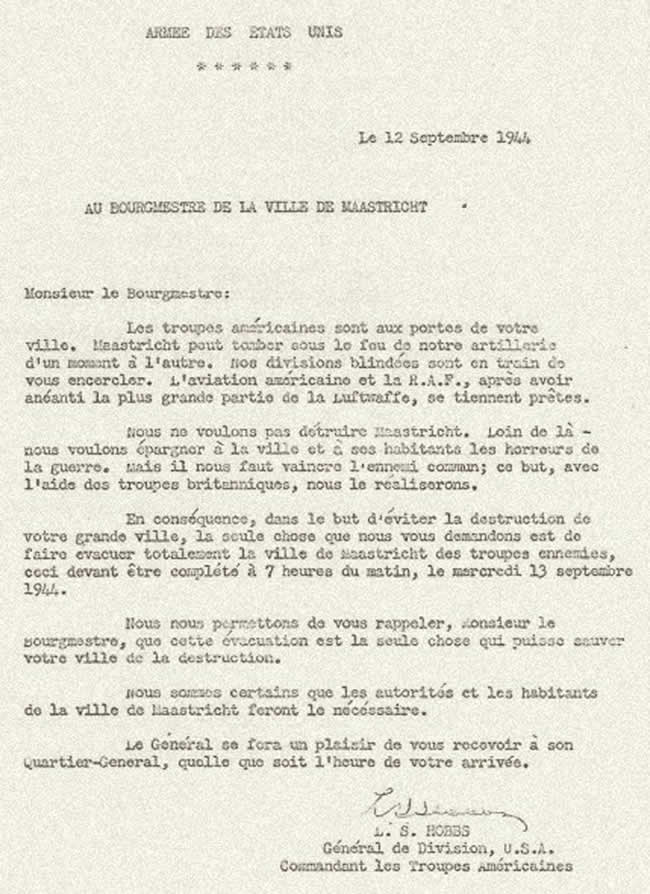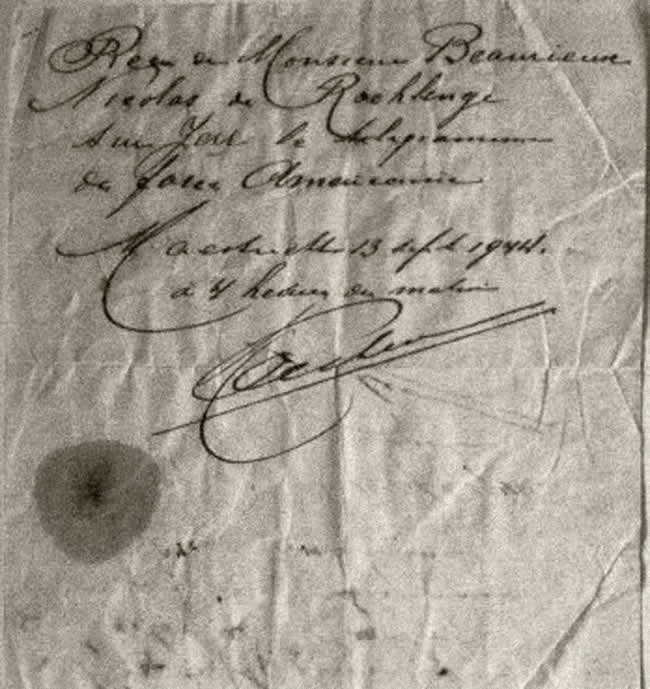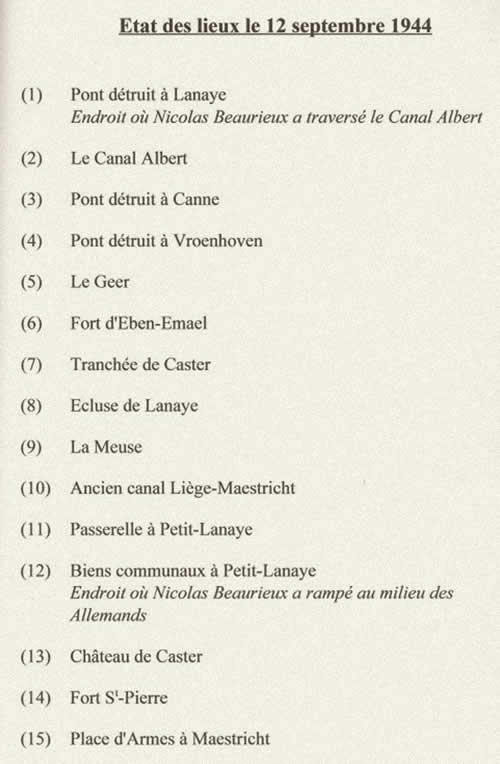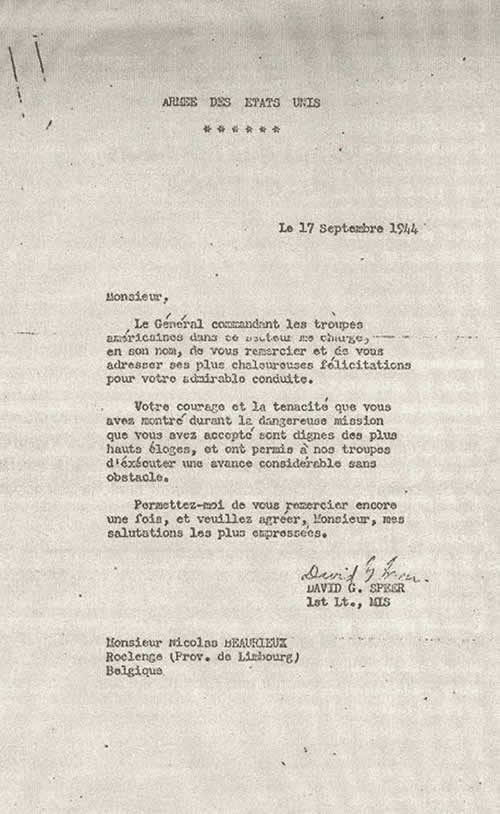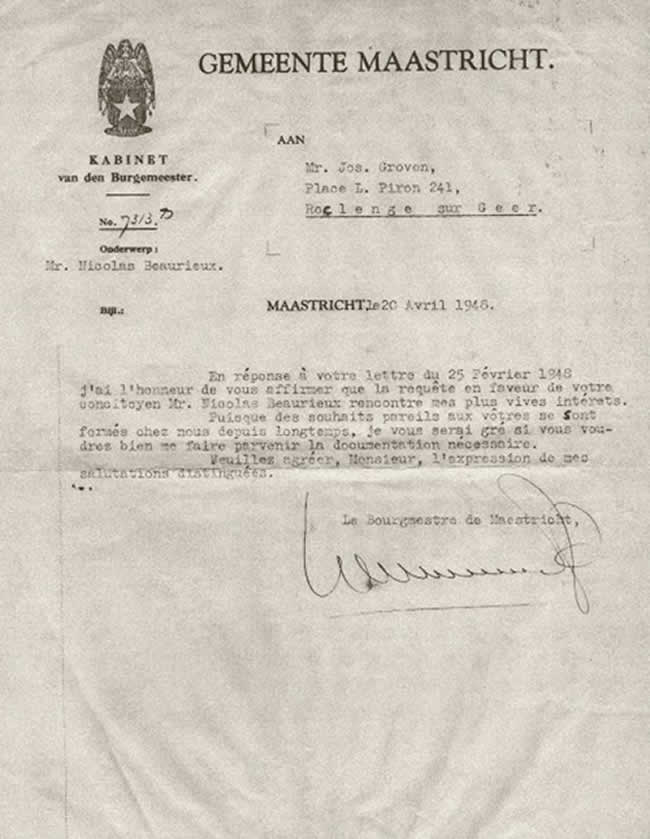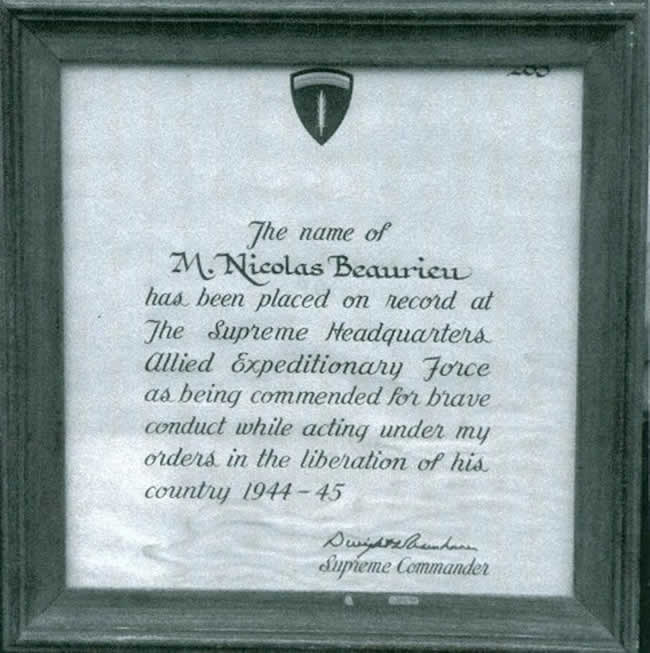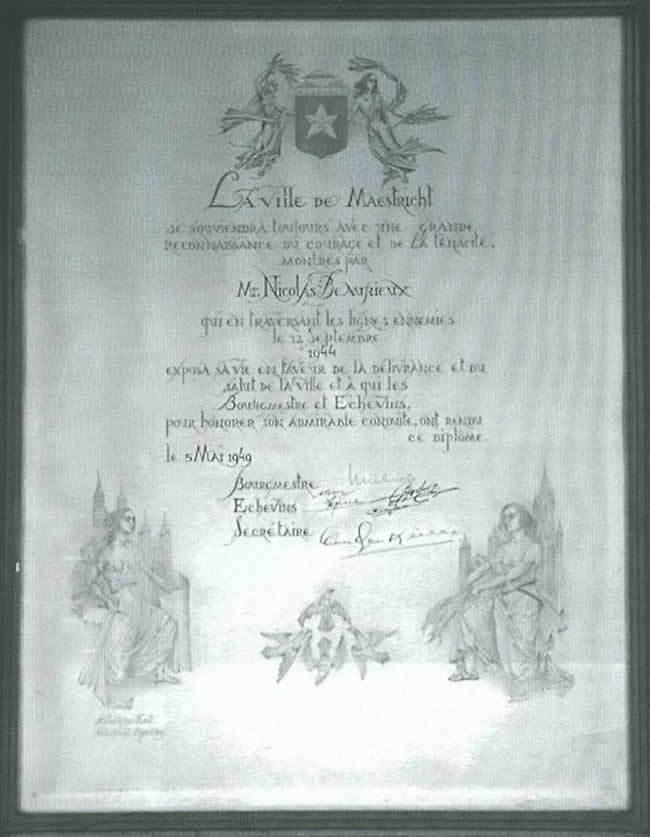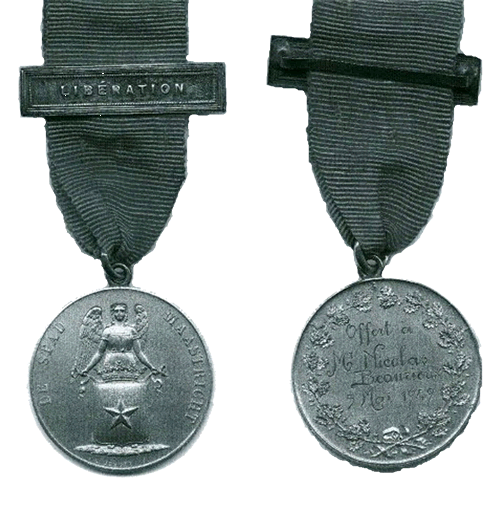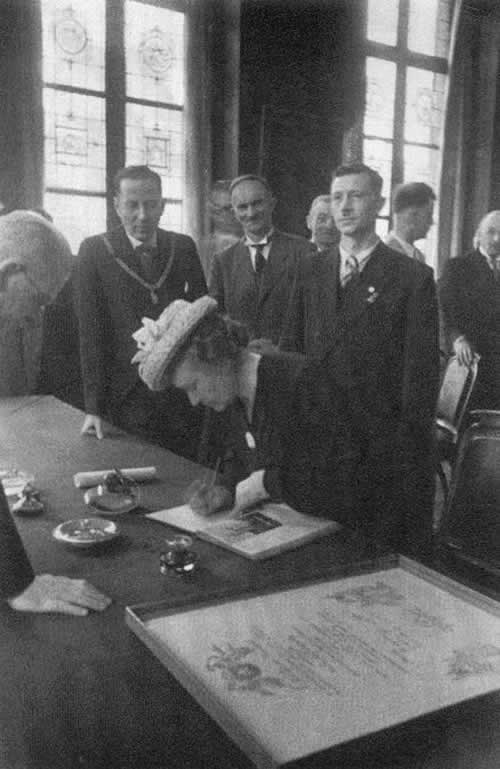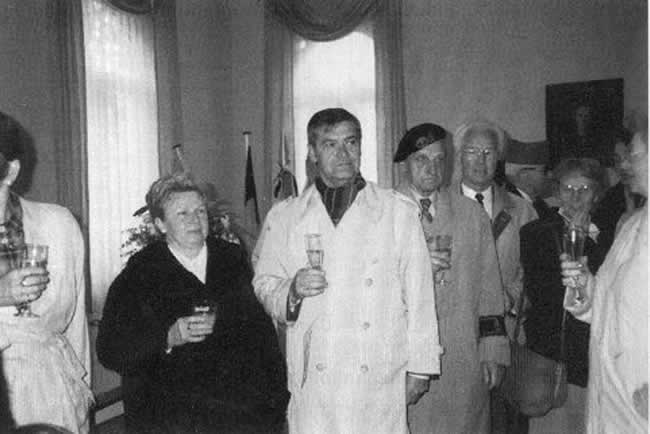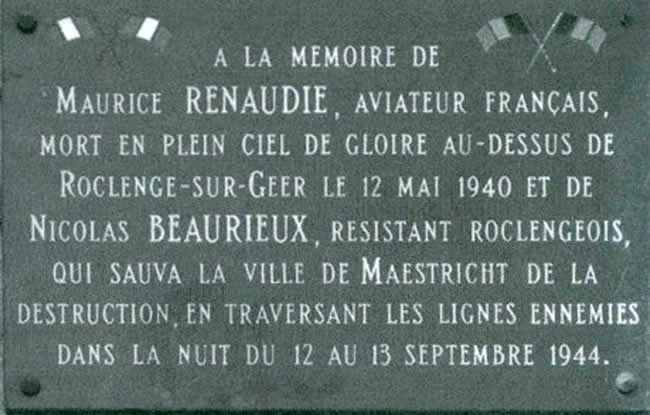Maison du Souvenir
Maison du Souvenir

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Comment nous rendre visite
-
Comment nous rendre visite
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Le comité
-
Le comité
-
![]() Nos objectifs
-
Nos objectifs
-
![]() Articles
Articles
![]() Notre bibliothèque
-
Notre bibliothèque
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Photos
-
Photos
-
![]() Signer le Livre d'Or
-
Signer le Livre d'Or
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
Mille fois merci à
Monsieur Roger Hiance pour avoir permis à la « Maison du Souvenir »
de mettre sur son site, le livre qu’il a consacré à Monsieur Nicolas Beaurieux
grand héros de la Vallée du Geer pendant la seconde guerre mondiale. 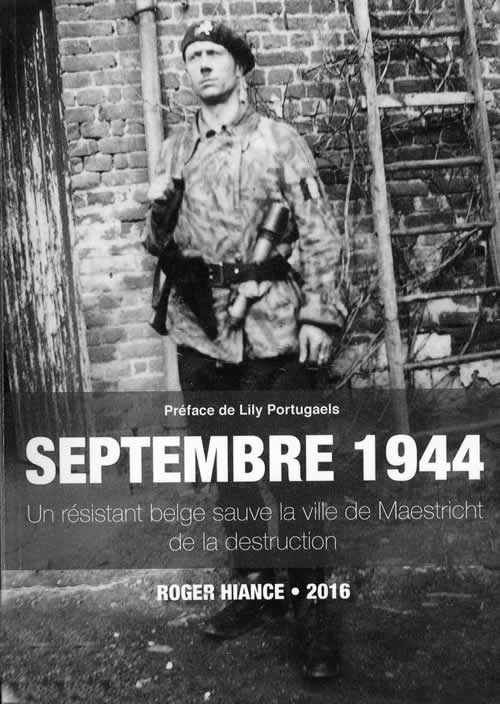
Roger HIANCE
Septembre 1944 Un résistant belge sauve la ville de
Maestricht Préface De
tout temps il y a eu des héros qui, par leurs exploits, ont enflammé les
foules, ont inspiré des poésies ; des héros dont des statues ont été dressées
dans les villes du monde ; des héros dont le nom a été donné à des rues; des
héros dont les photographies et les noms se trouvent dans tous les
dictionnaires. Mais il y a eu aussi, et en bien plus grand nombre, des héros
dont personne ne saura jamais le nom, des héros qui resteront toujours inconnus
des livres d'histoire, des héros qui ont simplement fait leur devoir ...
héroïquement. C'est à
un de ces héros qui, sans lui, serait resté inconnu, que Roger Hiance a
consacré un ouvrage passionnant qui se
lit comme un roman d'aventure. Nicolas
Beaurieux, un habitant de la petite commune de Roclenge-sur-Geer, peut être
considéré comme l'homme qui, en septembre 1944, a sauvé la ville de Maastricht
d'une destruction complète grâce à une détermination à toute épreuve, un
extraordinaire esprit d'aventure et aussi, on ne peut l'ignorer, une chance
exceptionnelle. C'est
pour son premier livre "Journal d'un petit village sous la botte
allemande" publié en 1977 que Roger Hiance, de Wonck, évoque pour la première
fois l'exploit d'un habitant du village voisin qui, la nuit du 12 au 13
septembre 1944, avait traversé, dans les deux sens, les lignes ennemies pour
remplir une mission que lui avait confiée le Major-Général Hobbs, commandant la
30e division d'Infanterie Us. La réussite de cette mission lui
vaudra les félicitations personnelles du Général Eisenhower, Commandant suprême
des forces alliées en Europe. Depuis
lors Roger Hiance, à qui Nicolas Beaurieux a raconté sa vie et ses exploits,
n'a eu de cesse d'écrire un livre qui serait consacré à cet étonnant
personnage. Il a consulté de très nombreuses sources, récolté des souvenirs,
des documents, des photos, qui illustrent l'ouvrage et authentifient
parfaitement les faits relatés. L'auteur
insère son récit dans la relation précise de ce qu'était la vie dans la
Basse-Meuse pendant cette époque particulièrement perturbée. Il
retrace aussi le contexte familial de Nicolas Beaurieux qui nous apparaît sous
les traits d'un véritable aventurier local, un homme de ressources et qui plus
est, un excellent tireur. Le récit fourmille d'exemples qui aident à brosser le
portrait de cette étonnante personnalité. Il sera
un résistant de la première heure mais sans jamais vraiment appartenir à l'un
ou l'autre réseau. Un jour,
à lui seul, grâce à une ruse, il capture une cinquantaine d'Allemands. En
septembre 1944, les troupes du Major-Général Hobbs sont arrêtées devant
Maastricht où les Allemands lourdement armés se sont retranchés en force
protégés par le double obstacle de la Meuse et du Canal Albert. Il est certain
que pour prendre Maastricht, il faudra la détruire et les pertes risquent
d'être particulièrement lourdes. C'est alors que Hobbs décide de lancer une
tentative de la dernière chance en incitant les autorités maastrichtoises à
intervenir auprès de l'occupant allemand en lui annonçant la décision
américaine de mettre toutes les forces de feu en place pour prendre la ville à
tout prix. Peut-être était-ce aussi de sa part, fut-ce sans croire vraiment à
la réussite d'une telle démarche, une manière de se dédouaner pour la
catastrophe qui allait être déclenchée. Toujours
est-il que, par la Résistance, c'est Nicolas Beaurieux que l'on présente au
Général Hobbs pour tenter de traverser les lignes et d'aller porter un message
au bourgmestre de Maastricht. On ne lui cache pas le peu de chance de réussite
et le risque d'y laisser sa vie. Nicolas Beaurieux n'hésite pas. Il accepte la
mission considérée comme impossible. Le talent de conteur de Roger Hiance, fait
vivre au lecteur cette extraordinaire odyssée qui va mener Nicolas Beaurieux
(qui a caché le message dans la semelle d'une de ses chaussures), la nuit, au
domicile de l'ancien bourgmestre (c'est un pro-allemand qui à ce moment
remplissait cette fonction) Le jour
même les Américains entreront dans la ville intacte. Nicolas Beaurieux est fêté
par les Américains qui lui demandent ce qu'il veut comme récompense. " Une
paire de chaussures, car j'ai abîmé les miennes ", répondra-t-il en toute
simplicité. Roger
Hiance termine son livre par plusieurs commentaires particulièrement pertinents
qui sont aussi des réponses à quelques tentatives visant à minimiser l'exploit
de Nicolas Beaurieux et surtout il produit les documents originaux qui étayent
son histoire. Il rappelle aussi que dans l'immédiat après guerre plusieurs
articles de journaux et des manifestations, notamment à Maastricht, ont mis en
valeur l'aventure de Nicolas Beaurieux. Mais très vite, cet épisode est tombé dans
l'oubli. Cet ouvrage, remarquablement documenté,
rend ainsi justice à un personnage qui fait honneur à sa Basse-Meuse natale
mais aussi, à son Pays de Liège et à la Belgique à laquelle le héros du livre,
décédé en septembre 1976, était viscéralement attaché. En fin
d'ouvrage, Roger Hiance évoque aussi un aviateur français dont l'avion fut
abattu le 12 mai 1940 au dessus de Roclenge. C'est Nicolas Beaurieux qui se
chargea de récupérer le corps et de l'enterrer près de l'église de Roclenge.
C'est dans ces circonstances qu'il trouva près de l'appareil écrasé, deux pièces
d'argent. Il les mit précieusement de côté pour les faire parvenir à la famille. Après la
mort de Nicolas Beaurieux, sa fille retrouve dans les affaires de son père les
deux pièces d'argent. Elle demande à Roger Hiance de faire les recherches pour
identifier l'aviateur français. Vu le peu de renseignement dont on disposait,
les recherches furent très laborieuses. Finalement, l'aviateur français est
identifié et sa famille contactée. Roger Hiance entretiendra une correspondance
suivie avec la fille de Maurice Renaudie à qui la fille de Nicolas Beaurieux
enverra les deux pièces d'argent trouvées près de l'avion abattu. Chercheur
infatigable, Roger Hiance a reconstitué la carrière et le dernier combat de
Maurice Renaudie. La fille
de l'aviateur français et la fille de Nicolas Beaurieux se rencontreront à
Roclenge-sur-Geer pour l'inauguration d'une plaque commémorative offerte par
Roger Hiance qui a voulu y réunir le nom des deux héros.
Lily Portugaels
Directeur honoraire
La Libre Belgique-Gazette de Liège Avant-propos Vendredi 5 septembre 2014 Je m'apprête à fermer la fenêtre grande
ouverte de ma chambre à coucher lorsque je me trouve nez à nez avec une belle
inconnue. " Êtes-vous
monsieur Hiance ? " me demande-t-elle avec un léger accent. Elle fait un signe et est bientôt rejointe
par deux collègues. L'un particulièrement souriant se présente : Guy van
Grinsven de la télévision. Il est accompagné de son caméraman. Je les fais
entrer et pendant plus de deux heures, je réponds à toutes les questions et
leur montre tous les documents. Je leur explique comment Nicolas Beaurieux a
sauvé, au péril de sa vie, la ville de Maestricht de la destruction. "
C'est un authentique héros. Sans lui, la ville aurait été complètement rasée.
Et pourtant, à Maestricht aucune rue ne porte son nom. Il y a une avenue
d'Artagnan, une avenue Porthos, une avenue Aramis et une Athos. Certes le
premier a été mortellement blessé Porte de Tongres, lors du siège de la cité
fortifiée le 25 juin 1673, mais les trois autres mousquetaires n'ont existé que
dans l’imagination d'Alexandre Dumas... Nicolas Beaurieux, lui, grâce à son
audace et à son héroïsme, a sauvé la ville ; d'Artagnan, par contre, la
combattait sous les ordres de Louis XIV. D'Artagnan a deux statues à
Maestricht. Pour Nicolas Beaurieux, pas de rue, pas de statue, même pas de
plaque commémorative. C'est scandaleux qu'on l'ait ignoré à ce point. " Gêné, le journaliste me dit qu'à Roclenge,
il y a une plaque qui rappelle son héroïsme. Je ne décolère pas. " Justement,
parlons-en ! C'est moi qui l'ai offerte le 11 mai 1996. Même dans son village,
il n'était pas honoré. " Ils me quittent, après avoir fait de
nombreuses photos de tous les documents et en me promettant de me remettre un
DVD sur le reportage et des exemplaires de l'article qui va paraître dans De
Limburger, promesse qu'ils vont d'ailleurs tenir. Quelques jours plus tard, on sonne à ma
porte. Devant moi, se tient un homme bien de sa personne. " Vous êtes monsieur Hiance ? " Décidément c'est un
défilé orangiste ! Il m'explique qu'il est
l'ancien Directeur du syndicat d'initiative de la ville et qu'il s'occupe de
toutes les festivités concernant la libération de la cité, il y a 70 ans. Il me
remercie d'avoir reçu les journalistes et m'invite aux diverses manifestations.
Il me remet le programme : trois bonnes pages. Je lui dis que ce sera un
véritable plaisir de me rendre à Maestricht, mais que je ne pourrai pas assister
à tout. " Quelle est, à votre avis, la cérémonie la plus importante ?
" Il me répond le dimanche
14 septembre à dix heures trente au palais provincial, près du monument érigé
en l'honneur de la 30ème division d'infanterie U.S. qui a libéré la
ville. On se quitte. " A
dimanche ! Je me permettrai de me faire accompagner par mon fils Philippe, si
vous n'y voyez pas d'inconvénient." " Il sera, comme vous, le
bienvenu." Le soir, un coup de fil.
Je décroche. " van Lijf à l'appareil. C'est moi qui vous ai rendu visite cet
aprèsmidi." J'accepte évidemment et les larmes aux yeux lui déclare que ce sera un
grand honneur pour moi de représenter mon vieil ami Nicolas Beaurieux. Le samedi 13 septembre
2014, septante ans, jour pour jour, après que Nicolas Beaurieux ait réussi son
fameux exploit, une voiture s'arrête devant la maison. Je reconnais aussitôt
Guy van Grinsven, le journaliste de la télévision. Il me remet un exemplaire du
journal De Limburger, paru le jour même. Trois pages sont consacrées à Nicolas,
avec à la Une ce titre oh ! combien évocateur : " Hoe de stad gespaard
bleef' " Comment la ville resta épargnée ". Nicolas Beaurieux et
moi-même figurons en photo dans le journal. Le journaliste me déclare
que l'article a fait grand bruit dans la vieille cité mosane, suite à ma
déclaration que je trouvais honteux qu'il n'y avait pas encore à Maestricht une
rue qui porte son nom, ni même une plaque commémorative. Espérons que ma révolte
porte enfin ses fruits ! Mais nous n'avons pas le
temps. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire attendre le bourgmestre et
ses invités. En chemin, Guy van Grinsven m'explique qu'il habite à Kanne,
dernier village belge avant la frontière et que le reportage télévisé passera
le lendemain à quatre reprises sur la chaîne néerlandaise. Je sens que je me
suis fait un nouvel ami. A l'hôtel de ville, les
tables sont dressées pour une petite centaine d'invités. On me présente le bourgmestre,
Onno Hoes, et les échevins. Malheureusement plus aucun ne s'exprime dans la
langue de Molière. Quel changement depuis les années cinquante où presque tout
le monde à Maestricht parlait notre langue ! Ici aussi l'anglais a supplanté le
français. Un échevin me demande de confier à la ville tous les documents et
toutes les pièces concernant Nicolas Beaurieux. Je refuse poliment. On
m'installe à une place d'honneur parmi les convives. Puis le bourgmestre
prononce son discours, évoquant d'abord en quelques mots le souvenir de Nicolas
Beaurieux. Il poursuit longuement en anglais à l'intention des GI's présents.
Durant tout le repas, qui se passe dans la bonne humeur, je ne cesse de penser
à Nicolas et à ses trois filles. Ce sont elles qui auraient dû se trouver à ma
place. Malheureusement, elles sont toutes trois décédées. A l'issue du dîner, un
vétéran fait une petite allocution, puis il remet au bourgmestre, sous les
applaudissements, un drapeau avec le fameux écusson de la 30ème
Division d'Infanterie. On les appelle ensuite. Ils sont neuf survivants. On les
photographie avec le bourgmestre et moi au milieu d'eux. Je suis vraiment aux
anges... Nouvelle photo, avec les mêmes et quelques autres personnalités. Je
suis un des héros de la fête. Et pourtant mon seul mérite a été de sortir
Nicolas Beaurieux de l'oubli. Il est vrai que sans moi, il serait resté à
jamais, suivant la dernière ligne de l'article de Vikkie Bartholomeus " le
héros inconnu de Maestricht ". Le lendemain, dimanche 14
septembre, mon fils Philippe et moi pénétrons dans le palais provincial. Au
rez-de-chaussée, un lunch réunit les GI's et les invités : croissants, tartes,
café, thé à volonté. Nous buvons une tasse de café, debout devant une petite
table circulaire lorsque nous sommes rejoints par un vieux couple et un
troisième personnage. A sa tenue, je devine que le mari est un vétéran. Je lui
pose la question. Il me répond par l'affirmative. Je lui déclare alors: " I am very happy to meet you (Je suis
très heureux de vous rencontrer) ". Lui aussi il l'est manifestement.
Il engage aussitôt la conversation, s'imaginant que mon anglais est aussi
parfait qu'il ne l'était il y a plus de cinquante ans, au début de ma carrière
professionnelle. Je dis à mon fils: " Je crois comprendre qu'il a détruit
un char allemand avec une roquette et qu'il en est très fier ". Découvrant que nous
sommes francophones, le troisième m'adresse la parole en français : " Vous
avez bien compris ". Je suis ravi. S'il est
allé à Eben-Emael, il a dû forcément passer à Wonck, mon village. Qui sait, il
a peut-être croisé l'enfant de 5 ans et 8 mois que j'étais en septembre 1944. " Son plus mauvais
souvenir ? " Quand il a été blessé en
traversant le Rhin et que deux de ses amis ont été tués à ses côtés. "
Cela on ne l'oublie pas, on ne l'oublie jamais " ajoute-t-il avec
mélancolie. Il admet volontiers
qu'ils sont toujours bien reçus quand ils reviennent en Europe. " Mais on
mange trop. C'est mauvais pour la santé ". '' A-t-il toujours son uniforme
? " Oui ! mais vous ne
l'aurez pas " me déclare-t-il avec un léger sourire. Il est perspicace notre
bonhomme ! Il faut malheureusement
interrompre cette agréable conversation. La cérémonie va débuter en bord de
Meuse, près du monument érigé en l'honneur de " The 30th infantry division
The old hickory[2]
". Une garde d'honneur,
constituée par de jeunes soldats américains en tenue d'apparat, entoure la
bannière étoilée, le drapeau néerlandais et deux autres étendards de régiment.
Une magnifique chorale interprète alors deux beaux chants, puis la flamme
sacrée est rallumée au monument. La chorale, toujours aussi talentueuse,
exécute ensuite les hymnes des deux pays. C'est émouvant de voir ces vétérans
se tenir debout et saluer pendant leur interprétation. Le Gouverneur de la
province du Limbourg, le Bourgmestre de Maestricht, puis l'ambassadeur des
Etats-Unis prononcent alors un discours. Plusieurs gerbes de fleurs sont
déposées au pied de l'imposant monument en béton. Des jeunes gens, en tenue
sportive, apparaissent entourant un flambeau. Ils prennent place dans une
barque et descendent le fleuve. Ils vont se relayer ensuite jusqu'au cimetière
de Margraten, où sont enterrés plusieurs soldats de la 30ème
Division d'Infanterie U.S. C'est la fin de cette
belle cérémonie qui s'est déroulée sous un soleil radieux. Quelques convives de
la veille m'entourent. Ils sont invités pour le repas de midi au petit château
du célèbre musicien André Rieu. Ils s'étonnent que je ne serai pas de la
partie. Monsieur van Lijf, qui a tout entendu, s'approche. Il me prie de
l'excuser. " C'est monsieur Rieu qui
invite. Je ne pouvais pas le faire à sa place. Tout s'est organisé dans la
précipitation ..." Dommage! Cela ne m'aurait pas déplu d'admirer
André Rieu jouer du violon, en passant de table en table. Mais ne faisons pas
grise mine ! Grâce à mon vieil ami Nicolas, j'ai assisté en deux jours à deux
belles cérémonies. Aussi l'idée a-t-elle germé dans mon esprit, sur le chemin
du retour : afin qu'on ne l'oublie plus, je vais lui consacrer un ouvrage et
raconter son extraordinaire histoire. Nicolas Beaurieux sauveur de
Maestricht OCTOBRE 1975 Je viens d'entamer le 10ème
chapitre de mon premier livre: " Journal d'un petit village sous la botte
allemande " que je publierai en décembre 1977 dans les grottes[3]
de tuffeau de Wonck. Ce chapitre doit traiter
de l'arrivée des Américains dans la vallée du Geer et du rôle joué par la
Résistance locale lors de la libération. Malheureusement, j'ai beau chercher,
je ne trouve pas de faits saillants à mettre à l'actif de celle-ci. Bien au
contraire ... Lorsque je me souviens subitement de l'exploit réalisé par
Nicolas Beaurieux de Roclenge-sur-Geer, un village voisin, dont on a toujours
dit qu'il avait sauvé la ville de Maestricht de la destruction. J'interroge mon père qui
le connaît très bien et pour cause ! ils sont tous deux musiciens et ils ont
presté ensemble à de nombreuses reprises. Il me dit que Nicolas a traversé les
lignes ennemies en septembre 1944 pour porter un pli américain à Maestricht et
que ce pli aurait sauvé la ville. Pour en savoir plus, je me décide à rendre
visite à l'intéressé, rue Grand Brou à Roclenge-sur-Geer. Nicolas Beaurieux
m'accueille chaleureusement dans sa modeste maison. Aux murs de sa cuisine sont
fixés de nombreux diplômes patriotiques dont deux attirent particulièrement mon
attention : l'un de la ville de Maestricht, signé par le bourgmestre et les
échevins de la cité, qui honore son admirable conduite, suite à son action
" en faveur de la délivrance et du salut de la ville " ; l'autre
signé par le général Dwight David Eisenhower, Supreme Commander. Décidément Nicolas a
accompli un exploit exceptionnel pour mériter pareils éloges... Je l'interroge aussitôt.
Intarissable, il m'explique dans les moindres détails la mission dont il a été
chargé par les forces américaines et la façon dont il l'a accomplie. Je prends
des tas de notes et le laisse parler jusqu'à la fin, sans l'interrompre. La mission consistait
bien à porter un message de l'armée américaine au bourgmestre de la ville de
Maestricht et ce fameux message a sauvé celle-ci. Quand je lui demande le
contenu de celui-ci, Nicolas m'avoue qu'il ne l'a jamais su. " Vous l'avez bien remis au bourgmestre ? " " Oui ! mais il était destiné à la
Résistance hollandaise." L'histoire est
fantastique, prodigieuse, héroïque. Malheureusement je ne pourrai l'insérer
dans mon livre car il me manque l'essentiel : le message. Qu'avait-il donc
d'exceptionnel ce fameux message pour qu'à lui seul il sauve toute une ville ? Je prends congé à la fois
ravi et très déçu. Ravi car j'ai pu dialoguer longuement avec un véritable
héros, déçu car je ne pourrai le sortir de l'oubli et le mettre en lumière
comme il le mériterait. Il me faut à tout prix trouver ce fameux document. Mais
existe-t-il encore ? Et dans l'affirmative où se trouve-t-il et comment
procéder pour orienter mes recherches ? Procédons par ordre !
D'abord, je dois disposer d'un excellent bilingue pour m'aider. En effet, si
j'ai étudié le néerlandais, si je sais m'exprimer assez correctement dans cette
langue, je me sens incapable de mener, tambour battant, une conversation
concernant un tel sujet. Je réfléchis un moment. Cet interprète, mais je l'ai
sous la main. Depuis douze ans, je travaille aux Ciments Portland Liégeois à
Haccourt, en qualité d'adjoint du Directeur administratif et financier, que je
remplacerai d'ailleurs trois ans plus tard. Nous vendons beaucoup de ciment dans
le pays flamand et aux Pays-Bas. Notre chef d'expéditions est dès lors, comme
il se doit, parfaitement bilingue. Dès le lendemain, je vais le
trouver. " Monsieur Dolfeyn, j'ai
besoin de vous." Monsieur Dolfeyn est anversois
d'origine et maîtrise dès lors parfaitement la langue de Guido Gezelle. "J'écris un livre d'histoire
sur mon village et la vallée du Geer. Un résistant a porté une missive de
l'armée américaine, de la plus haute importance, au bourgmestre de Maestricht
dans la nuit du 12 au 13 septembre 1944. Je dois absolument prendre
connaissance de cette lettre. Je voudrais que vous téléphoniez à Maestricht
mais je ne sais à qui vous devez vous adresser. Au bourgmestre actuel ? A son secrétaire ? A un échevin
ou au service des archives ? Vous voyez, c'est très spécial." Monsieur Dolfeyn fronce
les sourcils. Il réfléchit un instant et saisit le téléphone. " Je vais téléphoner à la
douane." A l'époque, le Marché Commun
existait déjà. Mais ce n'était pas comme de nos jours où les frontières sont
supprimées, et que les hommes et les produits peuvent circuler librement entre
les pays de la Communauté Européenne. Notre ciment expédié aux Pays-Bas devait
dès lors être accompagné de documents spéciaux qui étaient vérifiés à la
frontière. La conversation s'engage
aussitôt, franchement amicale. Au bout d'un certain temps, monsieur Dolfeyn
raccroche. " Vous avez de la chance " me dit-il. C'est vrai qu'au cours de
mon existence, dame chance est venue souvent me prendre par la main. " Vous avez de la chance
car mon interlocuteur est le beau-frère du conservateur des archives de la
ville de Maestricht. Vous aurez la photocopie du document demain, en arrivant
au bureau. " J'esquisse un sourire
sceptique. " Encore faut-il qu'il
existe toujours." " Oui bien entendu ! Mais
s'il a été conservé, vous aurez la photocopie demain." Je le remercie
chaleureusement et vais reprendre mon travail. Inutile de dire que j'ai très
mal dormi la nuit, me tournant et retournant souvent dans mon lit. Inutile
d'ajouter aussi que je n'ai jamais été aussi matinal, le lendemain à la
cimenterie. J'ouvre la porte. Que vois-je ? Une enveloppe blanche,
sans la moindre indication, posée sur mon bureau. Mon cœur bat à tout rompre.
J'ouvre nerveusement l'enveloppe. A l'intérieur se trouve le fameux pli et, qui
plus est, il est rédigé en français. On distingue nettement que le document a
été dactylographié par une machine américaine car les accents ont été ajoutés à
la plume. J'en prends aussitôt
connaissance. Je lis le texte une fois, une deuxième, puis une troisième fois.
Je comprends beaucoup mieux ce qui s'est réellement passé. Cependant, il reste
un petit coin de voile à soulever. Mais je ne doute pas un seul instant que je
vais trouver. Je mets mes notes en
ordre avant de retourner chez Nicolas Beaurieux. Il approuve le récit et me
fournit encore certains détails sur sa mission. Je lui dis que j'ai retrouvé le
message mais qu'il n'apprendra le contenu qu'avec la publication de mon livre
que je lui offrirai.[4]
Il me confie alors tous les articles publiés à l'époque dans la presse, pour
m'aider à la rédaction définitive de mon texte. Dans l'un de ceux-ci, paru en
1949 à l'occasion de la réception officielle de Nicolas et de sa famille à Maestricht,
je trouve la pièce manquante à mon puzzle. Maintenant tout est désormais clair :
Nicolas a bien sauvé la ville de Maestricht de la destruction totale. Avant mon départ, il
ouvre un dernier tiroir de son vieux buffet et me tend un magazine néerlandais,
datant lui aussi de 1949, avec quatre belles photos de la réception officielle.
Le titre est éloquent : " Nic Beaurieux : redder van Maastricht ",
" Nicolas Beaurieux : sauveur de Maestricht ". Qui était Nicolas Beaurieux ? Nicolas, Joseph, Adolphe Beaurieux voit
le jour dans le coquet village de Roclenge-sur-Geer, le 16 avril 1903 à onze
heures du soir. Son père, Louis Beaurieux, trente-neuf ans, exerce le pénible
métier de terrassier, ce qui exige une condition physique particulière. Sa
mère, âgée de quarante-cinq ans, s'appelle Marie-Thérèse Frenay. Comme la plupart des enfants de la
vallée du Geer, à cette époque, il ne fréquente que l'école primaire. Puis il
se fait embaucher dans une ferme de la localité. Journalier, il travaille
souvent au grand air, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Quand il n'est pas au
boulot, c'est encore et toujours dans la nature qu'il passe la majeure partie
de son temps, sillonnant les bois et les champs, observant les animaux, plaçant
des collets pour attraper un lapin ou un lièvre afin d'améliorer l'ordinaire. Il n'a que seize ans lorsque sa maman
décède, ce qui va – si besoin en est – forger davantage son caractère. Quatre
ans plus tard, en 1923, il accomplit son service militaire dans la cavalerie
malgré sa grande taille: 1 mètre 83. Il est très maigre : 62 kilos d'après son
carnet sanitaire individuel. Mais c'est un faux maigre, car il est doté d'une
force physique peu commune, sans doute héritée de son père. En effet, chaque
fois que je le rencontrais, alors même qu'il était âgé de 72 ans, je redoutais
de lui serrer la main. Sa poigne était telle que j'avais l'impression qu'il
allait me broyer les doigts. Mais n'anticipons pas ! Cavalier au 2ème escadron du
1er régiment des Guides, le jeune Beaurieux a, un jour, l'insigne
honneur de faire partie de l'escorte à cheval de la reine Elisabeth. Mais plus
encore que pour les chevaux, il éprouve une passion immodérée pour les armes.
C'est ainsi qu'il devient rapidement un tireur exceptionnel. J'en veux pour preuve cette anecdote qui
m'a été rapportée par un certain René Desamory, habitant de Boirs. Les faits se
déroulent après la guerre. René se promène dans les champs lorsqu'il voit Nicolas
Beaurieux, en tenue de treillis, tapi dans l'herbe, avec un fusil dans les
mains. "
Bonjour Nicolas ! " " Chut ! " fait celui-ci et, d'un geste vigoureux de la
main, il ordonne à son visiteur de se coucher près de lui. Baissant la voix, René lui demande ce
qu'il fait là. " Chut ! " fait encore Nicolas. Le temps passe. René Desamory est bien
obligé de garder le silence et de rester à ses côtés, sans bouger. Après une
longue attente, il voit apparaître à 20 mètres un renard au-dessus du talus et
traverser le chemin creux à vive allure. Nicolas pousse aussitôt un grand cri.
Effrayé, l'animal s'immobilise une fraction de seconde. Réflexe fatal car le
coup part et atteint le renard. Ravi, Nicolas Beaurieux se tourne alors vers
son compagnon, en arborant un large sourire d'enfant. " Ce maudit animal venait voler mes poules. J'ai suivi ses traces et j'ai
remarqué qu'il traversait ce chemin, toujours au même endroit." Il
jette aussitôt le goupil, comme un trophée, sur ses épaules et redescend dans
la vallée en sifflotant. La commune de Roclenge va d'ailleurs
exploiter ses talents. Le 24 juillet 1946, le bourgmestre Rousseau lui délivre
un certificat spécial. « Le Collège des Bourgmestre et Echevins
de la commune de Roclenge déclare que le nommé Beaurieux Nicolas, domicilié rue
Grand Brou n° 172, garde particulier, est autorisé à détruire les bêtes
nuisibles avec une arme à feu sur le territoire de la commune de
Roclenge. La demande d'agréation comme garde est au Gouvernement provincial[5]
depuis plus de quatre mois.
Le Bourgmestre
Rousseau Tireur exceptionnel
certes, mais parfois un peu inconscient... Par une belle journée
d'été, son vieux père s'est rendu dans la petite cabane installée au fond du
potager pour satisfaire un besoin bien naturel. A l'époque en effet, la plupart
des maisons dans la vallée ne disposent pas encore de toilettes modernes comme
c'est le cas de nos jours. Il fait très chaud. Le vieux Louis a laissé la porte
grande ouverte. Il est penché vers l'avant. Seule sa pipe dépasse la porte.
Voulant lui jouer un tour, Nicolas va chercher sa carabine. Il vise, fait feu
et tire la pipe hors de la bouche de son père. Vous devinez aisément la colère
du brave homme et les vifs reproches qu'il adresse aussitôt à son fils ... Le 6 septembre 1930,
Nicolas Beaurieux épouse une jeune fille d'Eben-Emael, Catherine Liégeois, âgée
de vingt-huit ans. De leur union vont naître trois filles : Thérèse (dite
Thésa) le 15 juin 1931, Marguerite (dite Maggy) le 30 juin 1933 et Elise (dite
Lisette) le 23 avril 1936. Nicolas nage
véritablement dans le bonheur dans son pittoresque village de
Roclenge-sur-Geer, d'autant plus qu'il a trouvé, juste avant son mariage, un
emploi stable dans une usine de Herstal, en tant que machiniste. Mais ce n'est pas là sa
seule activité. Doté d'une santé peu commune, toujours prêt à rendre service à
ses concitoyens, il cueille, après journée, des fruits en été et en automne. En
hiver, il élague les nombreux peupliers, dans cette vallée si propice à ces
géants. Grâce à des pointes de fer adaptées aux talons de ses chaussures, les
" gripètes " en wallon, qu'il enfonce dans l'écorce, il escalade le
tronc de ces arbres majestueux sur une hauteur de quinze mètres. N'ayant pour
unique protection qu'une lanière en cuir, pour s'attacher et éviter de tomber
en arrière, il coupe alors avec une serpe les branches superflues. Il faut du
cran et ne pas souffrir du vertige pour oser exercer ce métier particulièrement
dangereux et mériter le salaire de la peur, comme on le qualifie dans la
région. Mais la peur, nous le savons déjà, c'est un mot que Nicolas ne connaît
pas ... Au début de l'hiver, il
capture des blaireaux pour récupérer l'épaisse couche de graisse dont ils sont
enveloppés, ce qui leur permet d'hiberner. Il vend alors celle-ci à ses propres
clients dans la commune, car elle est particulièrement efficace pour soigner
les engelures. Il vend également, à un marchand ambulant, la fourrure des
renards qu'il abat de temps en temps. Ce géant au grand cœur,
cet excellent patriote, cet homme véritablement amoureux de la nature a une
autre passion : la musique. Il fait en effet partie de la " Royale
Harmonie Grétry " de son village et y joue du bombardon, ce qui ajoute
encore à sa haute stature. Si la musique adoucit les
mœurs, elle n'atténue cependant pas la haine implacable qu'il voue aux
Allemands qui, au cours de la Grande guerre, ont brûlé la ville de Visé toute
proche, massacré des civils innocents dans les villages d'Heure-le-Romain et de
Hermée, assassiné le 18 août 1914 Jean Derriks, le brillant député permanent de
Roclenge, et surtout tué deux membres de sa famille, dont le soldat René
Beaurieux du 15ème régiment d'artillerie, mort de ses blessures le 8
octobre 1918 à l'hôpital de campagne de Hoogstade, un mois avant l'armistice.
Tout cela Nicolas ne peut l'oublier, encore moins le pardonner... La guerre Le vendredi 10 mai 1940 à 3 heures 30 du
matin, une grande partie des habitants de la vallée sont réveillés en sursaut
par des coups de canon. Les femmes s'affolent aussitôt. " Mais c'est la guerre..." Les maris tentent de les rassurer "
Mais non ! Ce n'est qu'un simple
exercice ". " A cette heure ?... " Ceux qui ont compté les détonations se
rendent compte, au contraire, que l'alerte est sérieuse. En effet, il avait été
convenu avec le major Jottrand, commandant la garnison du fort d'Eben-Emael,
qu'en cas de menace réelle, la coupole 120 avertirait la population des environs
en tirant vingt coups de canon, à raison de cinq coups par point cardinal. A leur insu, les habitants ont même eu
droit à trois heures supplémentaires de repos et donc de tranquillité. En
effet, la garnison a été informée par la sonnerie du clairon, dès minuit
trente-deux, que la guerre était imminente.[6]
Dans la pagaille et l'affolement général qui en ont résulté, les officiers ont
tout simplement oublié de donner l'alarme aux civils, préoccupés qu'ils étaient
par le déménagement dans la caserne souterraine, du mobilier et du matériel qui
se trouvaient dans des baraquements, en attendant que l'installation du
chauffage soit complètement terminée dans le fort. Puis lorsqu'ils se sont
rendu compte de leur oubli, ils ont constaté que la coupole 120, qui devait
tirer ces fameux coups, était hors d'usage, victime vraisemblablement,
affirmera-t-on après le conflit, de saboteurs installés sous l'uniforme belge à
l'intérieur des fortifications[7]. C'est donc les artilleurs de la coupole
sud qui ont été chargés de faire connaître, aux habitants des alentours, la
terrible nouvelle et d'arracher en même temps de leur lit les soldats de la
garnison, normalement en cantonnement à Wonck, mais qui bien souvent et
contrairement au règlement logent chez leurs parents, leur épouse, voire chez
leur fiancée, parfois dans d'autres villages. Moins d'une heure plus tard, la dramatique
information est confirmée par d'autres détonations, retentissant dans la nuit
et provenant de la même direction, c'est-à-dire d'Eben-Emael. Ce sont les explosions
des charges creuses qu'utilisent les aéroportés allemands, venus à bord de
planeurs, pour réduire au silence la redoutable forteresse. Cette fois, le
doute n'est plus permis : la Belgique, bien malgré elle, est de nouveau entrée
en guerre ... Peu de temps après, des avions par
centaines constellent un moment le ciel. Civils et militaires s'interrogent,
observant anxieusement les formations serrées qui, à haute altitude, se
dirigent vers leurs objectifs : aérodromes et voies de communications importantes. Catherine Liégeois est à ce moment
doublement inquiète. Elle pense à sa famille dans le village d'Emael, dont on
perçoit maintenant le bombardement. Elle pense aussi à son mari Nicolas qui lui
a fait part de son intention de combattre, en dépit de son âge, 37 ans, et de
leurs trois enfants, dont l'aînée est à peine âgée de 9 ans ... Nicolas
pourrait s'abstenir de toute initiative et attendre sagement le déroulement des
événements. En effet, il a reçu l'année dernière un document lui indiquant,
qu'à partir du 1er mars 1939, il faisait partie de l'armée
territoriale sans affectation de mobilisation. Il a dû par la même occasion
remettre sa tenue de voyage, en d'autres termes son uniforme, au commandant du
canton de gendarmerie. Mais Nicolas ne l'entend pas de cette oreille. Il aime
trop l'action et veut absolument accomplir son devoir. En fin d'après-midi, il
se présente à la gendarmerie de Roclenge et réclame une arme de guerre, le
fusil qu'il utilise régulièrement ne pouvant lui permettre de se mesurer aux
Allemands. Les gendarmes hésitent, mais sur ses insistances, ils finissent par
céder et lui fournissent un fusil de guerre. Etant donné l'afflux des mauvaises
nouvelles, les représentants de l'ordre ne risquent pas grand-chose, en
remettant une telle arme à un tireur aussi chevronné. Ragaillardi, Nicolas
Beaurieux s'en retourne chez lui. Si l'ennemi franchit le double obstacle que
constituent la Meuse et le Canal Albert, ce dont il doute cependant comme la
plupart des gens, il mènera sa propre guerre, en se faisant franc-tireur ... Le lendemain, dans le courant de l'après-midi,
des rumeurs inquiétantes circulent dans le village. On répand que cela ne va
pas bien pour l'armée belge. Des ponts n'auraient pas sauté sur le Canal
Albert. En outre, le fort d'Eben-Emael, l'orgueil de la nation, ce fort
considéré comme étant imprenable, se serait rendu en fin de matinée[8].
On aurait même vu les premiers éléments motorisés de l'armée allemande dans la
ville toute proche de Tongres. A Tongres ? Le sang de Nicolas ne fait
qu'un tour. Si l'information s'avérait exacte, les Allemands seraient dans peu
de temps à Roclenge. Nicolas saisit son arme pour aller se joindre aux soldats
belges encore présents dans le village. Hélas ! Il n'en trouve plus. Tous ont
déguerpi pour éviter d'être encerclés. Seuls les avions à croix gammée
continuent de survoler la vallée, mitraillant sur tout ce qui bouge, lâchant au
hasard des bombes sur les fermes. Nicolas va se dissimuler dans un bois. Se
rendant compte de la situation grotesque dans laquelle il se trouve, il
réfléchit tristement sur la conduite à suivre lorsque le vrombissement d'un
avion lui fait lever la tête. Il aperçoit soudain un parachutiste descendant
lentement vers le sol. C'est un éclaireur ennemi que les avions lâchent de
temps en temps pour informer et orienter les troupes. Nicolas Beaurieux, à
grandes enjambées, court dans sa direction. Le para allemand touche terre
lourdement. Il se débarrasse aussitôt de son parachute. Puis après
s'être rendu compte qu'il ne court aucun risque, il se met à consulter
longuement une carte, observé à distance par Nicolas Beaurieux. Il part ensuite
résolument dans une certaine direction. Nicolas, qui connaît les
lieux comme sa poche pour les avoir tant de fois arpentés, a deviné l'endroit
où le Boche veut se rendre. Tout en courant, il coupe au plus court et va se
poster en embuscade. Il arme son fusil et patiente. L'attente n'est pas bien
longue. Comme prévu, le para arrive, longeant une haie, le dos courbé pour
mieux se protéger. De temps en temps il relève la tête pour s'enquérir s'il n'y
a pas le moindre danger. Nicolas, qui l'a déjà dans sa ligne de mire, le laisse
approcher encore, encore ... L'Allemand se relève de nouveau. Une détonation et
l'ennemi tombe à la renverse, une balle en plein front. Nicolas se précipite aussitôt,
lui enlève sa Schmeisser,[9]
lui arrache le ceinturon avec les trois chargeurs. Il s'empare également de sa
toile de tente bariolée. Après quoi, il dissimule le corps derrière la haie.
C'est son premier acte de guerre. Il y en aura d'autres... Le dimanche 12 mai très
tôt dans la matinée, le village de Roclenge est occupé par les troupes
allemandes. Elles ne sont pas venues de Tongres, mais de l'autre côté de la
vallée. Elles ont traversé le Canal Albert par le pont de Vroenhoven pris
intact par des aéroportés, à l'aube il y a deux jours. Puis les villages de
Riemst et de Zichen, avant d'aboutir dans la campagne de Wonck. Elles sont
descendues dans la vallée par la forte pente du Lovain, arrêtant au passage
tous les hommes âgés de 16 à 40 ans, qui s'étaient réfugiés dans les grottes de
tuffeau.[10]
Une partie s'est dispersée dans les villages de Wonck et de Bassenge. Une autre
a poursuivi sa route jusqu'à Roclenge. La rage au ventre,
Nicolas Beaurieux assiste à leur déploiement. Il est impressionnant : des
centaines d'hommes, des chevaux, des camions, des canons et des chars. Une
véritable machine de guerre. Sans oublier les nombreux avions qui les protègent
lors de leur progression... Les deux malheureux
ponts, pris par surprise sur le Canal Albert, ont ouvert une brèche dangereuse
dans le dispositif belge de défense. Aussi, les Alliés vont-ils essayer de la
colmater, en détruisant les deux ponts en question. Vers 13 heures 30,
dix-huit Breguet 693[11]
du groupe d'assaut français 1/54 se ruent sur Vroenhoven. Ils sont aussitôt
accueillis par un feu nourri de l'ennemi. Afin d'empêcher le bombardement du
pont, les Allemands ont placé quatre camions de chaque côté de l'ouvrage et
doté chacun de quatre mitrailleuses, dressées droites comme des chandelles.
Lorsqu'un avion apparaît, elles ouvrent immédiatement le feu, sans changer
d'angle de tir. De sorte qu'il est impossible de se présenter dans l'axe du
pont, sans être aussitôt abattu. Les Allemands vont
d'ailleurs encore renforcer la défense. Tous les cinquante mètres, le long du
canal, sur les quatre kilomètres qui séparent le pont de Vroenhoven de celui de
Veldwezelt, ils vont installer une pièce de flak (D.C.A. automatique constituée
de quatre petits canons aux longs tubes[12]) Sur les dix-huit Breguet,
huit avions sont abattus. L'un d'eux, s'allumant comme une torche, parvient
néanmoins à se poser, train rentré, à la limite de Roclenge-sur-Geer et de
Millen. Le pilote réussit à s'extirper à temps de l'appareil. Hélas ! le mitrailleur,
installé à l'arrière, a été atteint mortellement par un projectile. Son corps,
à moitié calciné, est penché vers l'extérieur sur le bord de la carlingue. Deux jours plus tard,
Nicolas Beaurieux, l'homme à tout faire, est requis par le bourgmestre pour aller
récupérer le corps du malheureux aviateur et l'enterrer dans le cimetière,
derrière le chœur de l'église paroissiale. L'avion restera de
nombreuses semaines au milieu des champs. Curieusement, il va être la cause de
la mort d'un vieux Roclengeois. Le 27 juin 1940, Pierre Gilles, un journalier
de 74 ans, travaille à proximité de l'appareil. Soudain un violent orage
éclate. Afin de se mettre à l'abri de la pluie, le malheureux a la mauvaise
idée de se réfugier sous une aile de l'avion. Un éclair s'abat sur l'épave et
foudroie le Roclengeois. Une fois de plus, Nicolas Beaurieux est chargé de
recueillir la dépouille mortelle. Ce faisant, il aperçoit soudain, sur le sol
détrempé, deux pièces d'argent brillant au soleil, qui a fait suite à l'averse.
Il se penche et les ramasse. Ce sont deux pièces de monnaie française.
Lorsqu'il rentre à la maison, après avoir effectué sa pénible mission, il
confie les deux pièces à son épouse et déclare en présence de ses trois enfants
: " Cet argent appartenait au
malheureux aviateur français. Il faudra le remettre à sa famille lorsque la
guerre sera finie". Nous verrons par la suite
comment cette noble résolution fut tenue... Le résistant L e mardi 28 mai 1940, l'armée belge,
sous les ordres de son Roi Léopold III, dépose les armes après une fort
honorable campagne de dix-huit jours, face à un ennemi nettement supérieur en
hommes, matériel et armement. La capitulation est signée au château d'Anvaing.
Le représentant des forces allemandes n'étant autre que le Major-Général
Frédéric Paulus, chef d'Etat-Major de la redoutable 6ème Armée
allemande, qui a établi son Quartier-Général durant quelques jours au
presbytère de Wonck.[13]
Nicolas Beaurieux entre aussitôt dans la résistance. Non pas dans un quelconque
réseau, car il n'en existe pas encore, mais dans sa résistance à lui, en tant
que patriote modèle qu'il a toujours été. Certes,
il renonce à faire le coup de feu car il ne veut pas mettre en danger la vie de
sa famille et de ses concitoyens. Mais il va agir à titre personnel par des
actes qui, si modestes peuvent-ils être au début, vont occasionner au fil du
temps de plus en plus de dommages à l'ennemi. Quelles furent ses principales actions ?
Un diplôme envoyé à Nicolas, onze ans après le conflit, les résume
parfaitement. Royaume de Belgique Le Ministre de la Défense
Nationale a l'honneur de faire savoir à Monsieur Beaurieux Nicolas que, par sa
décision, en date du 2 février 1956, il a été cité à l'ordre du jour du
Régiment, avec attribution d'un Lion de Belgique à apposer sur le ruban de la
médaille commémorative de la guerre 1940-1945 pour "Membre des Milices Patriotiques.
Prit part au sabotage de voies ferrées, de matériel roulant, etc... Transporta
des armes, des munitions et des explosifs. Participa activement aux opérations
libératrices du territoire. Fit des prisonniers ".[14] Tout est là, tout est
dit... Procédons par ordre, en
fonction des renseignements que m'avait fournis Maggy, sa deuxième fille,
lorsque je préparais, en septembre 2010, la conférence que j'allais donner à
Eben-Emael sur son illustre père ! Le 10 mai 1940 à 20
heures 30, le génie belge fait sauter le viaduc de Bassenge et les ponts de la
ligne de chemin de fer, la fameuse ligne stratégique qui relie Aix-la-Chapelle
à Tongres. Dès que ceuxci seront réparés, après de nombreux mois de travaux, et
que la circulation des trains sera rétablie, Nicolas Beaurieux va se faire un
énorme plaisir en sabotant, par de petits actes bien ciblés, cette ligne aussi
importante pour l'ennemi qu'au cours du premier conflit. Qu'a-t-elle donc de
spécial cette ligne ? Ce sont les Allemands qui
l'ont construite durant la " Grande Guerre ", lorsque le front s'est
stabilisé à l'ouest et qu'ils se sont rendu compte que les hostilités allaient
durer beaucoup plus longtemps que ne l'avaient prévu leurs stratèges. Afin de disposer d'une
deuxième voie ferrée entre l'Allemagne et la Belgique, ils ont décidé de relier
le réseau belge, à partir de Tongres, à la ligne Welkenraedt-Aix-la-Chapelle. Pour amener le plus vite
possible des troupes et du matériel sur le front, ils ont pris toute une série
de décisions dans l'élaboration du projet : Tout d'abord, la ligne en
question devait être à deux voies. Pour qu'elle soit rapide, elle devait être
la plus courte possible, plate sans la moindre pente, constituée de belles
lignes droites, avec limitation maximale de courbes. Tout cela afin de
permettre la circulation, dans les deux sens, de très longs convois de près de
cinquante wagons. Afin d'éviter le moindre
obstacle, elle ne devait croiser aucune autre voie ferrée, aucune route. Il ne
devait dès lors y avoir aucun passage à niveau, mais des viaducs ou des ponts
tous les kilomètres pour enjamber les routes ou de simples chemins de campagne. Des gares, avec des voies
d'évitement, devaient être construites, tous les huit kilomètres afin de
pallier tout incident. Des cabines de signalisation étaient prévues à l'entrée
et à la sortie de chaque gare et le long des voies. Le projet étant
définitivement adopté fin janvier 1915, le chantier va débuter immédiatement.
Des milliers d'hommes vont travailler pour mener à bien cet imposant chantier :
des Allemands tant civils que militaires, des Belges et de nombreux prisonniers
russes. Il va nécessiter des ouvrages d'art très importants, comme notamment
l'imposant viaduc de Berneau, le percement de plusieurs tunnels, comme celui de
Veurs (2 000 mètres) et celui de Remersdael, ou encore la construction du
fameux pont en acier qui enjambe à la fois la Meuse et le canal
Liège-Maestricht.[15] Dans la vallée du Geer,
plusieurs grands travaux seront réalisés. Citons en premier lieu le percement,
à Wonck, du tunnel long de 1 640 mètres, qui relie, sous la Montagne
Saint-Pierre, la vallée du Geer à celle de la Meuse ! Avec les dizaines de
milliers de mètres cubes de terre et de craie extraits, on va aménager le talus
de plus de dix mètres de haut, côté sud de la vallée, qui va constituer
l'assiette de la voie.[16] Plusieurs ponts seront
construits, à Wonck, Roclenge, Boirs et Glons, ainsi qu'un viaduc à Bassenge
au-dessus de la route provinciale. A la limite des villages de Bassenge et de
Roclenge-sur-Geer, on aménagera une gare de manœuvres avec plusieurs voies.
Enfin à Glons, la nouvelle ligne rejoindra le chemin de fer Liège-Hasselt, dont
elle empruntera la voie jusqu'à la gare de Tongres. Une véritable prouesse
dont les ingénieurs allemands étaient passés maîtres ! Autre exploit : la ligne
stratégique sera déjà mise en service, sur une voie, à la mi-février 1917.
Moins d'un an plus tard, le 6 janvier 1918, le trafic à double voies sera
effectif sur la totalité de l'ouvrage. Les trains vont dès lors l'emprunter
nuit et jour pour approvisionner les forces allemandes sur le front, tant en
armement, matériel et munitions et leur amener suffisamment de renforts pour déclencher,
dans les meilleures conditions, leur grande offensive prévue au printemps afin
de forcer la décision avant que les Américains puissent intervenir efficacement
sur le plan militaire. Mais venons-en aux
activités de Nicolas ! Comme le talus du chemin
de fer se trouve juste derrière son potager, inutile d'écrire que la ligne va
être l'objet de "soins" particuliers de la part de notre résistant... Dans un premier temps, il
va s'en prendre aux feux de signalisation qui, c'est le cas de le dire, vont
véritablement en voir de toutes les couleurs... Régulièrement sabotés, ils vont
occasionner de graves perturbations sur la ligne. Les Allemands auront beau
organiser des patrouilles, jamais ils ne le prendront en défaut. L'homme est
bien trop rusé... Il agit seul, de jour comme de nuit, opérant bien entendu à
des endroits différents et en espaçant ses interventions. Il se déplace dans le
talus couvert d'arbres et de végétation, tendant l'oreille au moindre bruit. Il
contourne par de longs détours les ponts gardés par les Allemands. Bref, il
agit comme autrefois lorsqu'il voulait surprendre du gibier. Un jour, alors que la
famille au grand complet est en train de déjeuner, le crissement
caractéristique des roues sur les rails annonce un nouvel arrêt. Catherine
interroge son mari du regard. Celui-ci ne réagit pas. Alors la femme se fâche. " Cette fois, tu exagères. Un jour, tu vas
te faire prendre. As-tu seulement pensé à nous ? " Nicolas ne répond pas. " De plus, le train est arrêté juste derrière la maison. Tu vas me
promettre de..." Catherine n'a pas le
temps d'achever sa phrase. Plusieurs coups de feu claquent soudainement. D'un
bond, Nicolas est debout. Il se précipite à l'arrière de la maison. C'est un
convoi de Juifs. Profitant de l'arrêt du train, certains prisonniers sont
parvenus à ouvrir leur wagon. Ils courent le long de la voie, bravant les tirs
des soldats. L'un d'eux se laisse glisser le long du talus et aboutit dans le
potager. Il est blessé car il se relève difficilement. N'écoutant que son
courage, Nicolas se rue à sa rencontre. De toutes ses forces, il le soulève,
l'emporte à califourchon tout en courant et se précipite dans la maison.
Catherine a déjà fermé la porte derrière eux tandis que son mari va tout de
suite dissimuler l'inconnu à l'étage. Posté à la fenêtre,
Nicolas observe ce qui se passe à 45 mètres de lui. Les bras en l'air, les
fugitifs regagnent le sinistre convoi, certains portants des blessés, voire des
mourants. Plus rien ne se passe, fort heureusement. Après un long moment
d'attente, le train se remet en marche. La généreuse Catherine
n'a pas attendu ce moment pour administrer les premiers soins au blessé. Son
mari non plus. En courant, il est allé quérir un médecin. Celui-ci arrive en
voiture, accompagné de Nicolas. Fort heureusement, la blessure n'est pas bien
grave. Une fois rétabli, le fugitif va bénéficier de la filière, mise au point
depuis juin 1942, pour rapatrier les aviateurs alliés dont les avions ont été
abattus. Catherine, depuis
longtemps, a déjà pardonné à son mari. Elle en est même très fière. Grâce à
lui, au moins un malheureux prisonnier ne sera pas déporté en Allemagne. Elle
va cependant lui demander de redoubler de vigilance à l'avenir... Nicolas va
redoubler de vigilance, mais il va également redoubler d'audace. Durant un certain temps,
il va délaisser les feux de signalisation pour s'attaquer au matériel roulant.
Comme la gare, construite par l'ennemi durant le premier conflit, se situe à
très faible distance de son domicile (à peine 250 mètres), il va réaliser
l'exploit – mais pas trop souvent quand même – d'aller saboter nuitamment, les
wagons à l'arrêt sur la voie d'évitement. Conducteur d'un pont roulant à la
Compagnie électrique de Herstal, il sait comment s'y prendre pour neutraliser
pendant un certain temps les wagons, chargés ou non, en sectionnant d'un coup
sec le tuyau d'alimentation en air des freins ce qui évidemment les empêche de
fonctionner et peut, si on ne le remarque pas à temps, provoquer un
déraillement. Lorsque la gare n'est pas
bien gardée et qu'il dispose dès lors de beaucoup plus de temps, il pousse le
sabotage jusqu'à introduire du sable dans les points de graissage des essieux.
Ce sabotage beaucoup moins détectable produit à la longue un grippage de
ceux-ci et une immobilisation plus importante du wagon. La ligne est vraiment
devenue une aire de jeux pour lui, même si en l'occurrence il s'agit de jeux
particulièrement dangereux. Mais l'homme aime trop l'action et éprouve une
véritable fascination pour le risque, le danger. Comme ces hivers de
guerre sont particulièrement rigoureux, Nicolas a vite trouvé une solution pour
éviter à sa famille de geler dans la maison, faute de charbon. La solution
vient évidemment de sa chère voisine, la ligne providentielle. Les Allemands
réquisitionnent dans les pays occupés tout ce qui leur est nécessaire, tant
pour la population civile que pour la Wehrmacht qui livre d'âpres combats en
Union Soviétique. Des convois entiers de charbon, venant de Campine, passent
chaque semaine sous le nez de Nicolas. Afin de subvenir à ses besoins, tout en
portant préjudice à l'ennemi, il se tapit en haut du talus, à quelques
centaines de mètres en amont de chez lui, en attendant sa prochaine victime.
Les trains circulant à gauche, il se cache à très faible distance de la voie.
Comme en outre, ils ralentissent sérieusement à partir de Roclenge avant de
passer devant la gare puis d'aborder deux kilomètres plus loin la courbe qui
leur permet de s'engouffrer dans le tunnel de Wonck, Nicolas bondit de sa
cache. Puis à l'aide d'une masse il assène un coup violent pour faire sauter le
verrou. Il court un petit instant le long de la voie, s'accroche de toutes ses
forces au wagon, pour faire une petite ouverture. Quand il réussit, le charbon
dévale à toute vitesse suite au cahotement. Il n'y a plus qu'à se servir ...
Furtivement, il remplit des sacs en jute, qu'il dissimule dans le talus. Il va
ensuite les récupérer, un autre jour, une autre nuit, sans oublier la masse
qu'il récupère en premier lieu, bien entendu. Il en dépose partout, dans le
petit local qui sert de buanderie, dans son poulailler et même derrière la
cloison sous l'escalier. Celle-ci va d'ailleurs lui jouer un drôle de tour. Durant le repas, en
l'honneur de la communion solennelle de Thésa, en mai 1943, la cloison en
question cède sous le poids du combustible. Une poussière noire envahit
aussitôt la pièce où se déroule le déjeuner traditionnel, maculant la nappe et
la robe blanche de la petite communiante. Bien entendu la maman n'apprécie pas,
mais le reste de la famille rit aux éclats. La bonne humeur est toujours de
mise chez les Beaurieux. Deux mois plus tard, le
village de Roclenge va être le témoin d'une véritable tragédie. Depuis le début de 1943,
les Britanniques survolent de nuit la vallée en formations serrées, pour aller
bombarder les villes, les usines, les gares et les ponts du territoire
allemand. Ils seront rejoints, à dater du 30 juillet 1943, par leurs alliés
américains qui opèrent en plein jour. A chaque passage massif des bombardiers,
les habitants éprouvent une grande joie car ils se doutent que, tôt au tard,
l'Allemagne nazie sera vaincue, cela d'autant plus que les nouvelles de tous
les fronts, diffusées par radio Londres, sont de nature à inspirer l'optimisme. Le curé Beck de la
paroisse de Wonck a pris l'habitude de noter tous les passages d'avions depuis
1942.[17]
Prenons connaissance de ce qu'il écrit le vendredi 9 juillet 1943 ! " A minuit 45, je suis réveillé :
passage intense d'avions; le bruit sourd des moteurs est soudain ponctué par le
crépitement des armes automatiques. Je me lève et je descends. La nuit est
obscure et je me demande comment les chasseurs de nuit peuvent bien livrer
combat dans cette obscurité. Il est minuit 55. Je vais voir au jardin
: rien à voir. Je rentre et je m'assieds pour lire un peu. Tout à coup, bruit
de combat, l'air est déchiré par le sifflement sauvage des appareils qui
virent... ou qui tombent !... Et puis, fracas de la chute. Nous sortons à
travers le parc pour gagner les grottes.[18]
Il fait clair maintenant, et pour cause ! Un bombardier vient d'être descendu
en flammes. J'opine pour Houtain-Saint-Siméon. Les grottes sont remplies de
fugitifs terrorisés. Dans la direction du Sud-Ouest, l'avion brûle toujours.
Les cartouches explosent. Un homme, qui a voulu se rendre compte, vient nous
annoncer que l'appareil est tombé à Bassenge, devant chez Box, près de la gare
du chemin de fer.[19]
Brusquement, la terre tremble, et on sent le souffle du déplacement d'air;
explosion de bombes sous l'influence du feu ?[20]
..." Le bombardier, un
Lancaster, a décollé la veille à 23 heures 16 de la base de Boum dans le
Cambridgeshire. Il précède le gros des bombardiers en sa qualité de " Pathfinder
" (marqueur). A son bord sept hommes, dont le plus jeune Charles King,
sergent mécanicien n'est âgé que de vingt ans. Aux commandes, Robert Palmer,
Flying Officer, 26 ans, est bien décidé à remplir valablement cette nouvelle
mission, après en avoir réussi trois autres : une à Dortmund (23/24 mai 1943)
et deux à Düsseldorf (11/12 juin 1943 et 25/26 juin 1943). En formations bien
réglées, 282 Lancaster et 6 Mosquito, qui ont quitté des aérodromes situés dans
le sud de l'Angleterre, se dirigent vers leurs cibles : des complexes
industriels dans les faubourgs de Cologne, au nord-ouest et au sud-ouest de
l'importante ville rhénane. Le raid va se solder par une grande réussite
puisque dix-neuf ensembles d'usines seront totalement ou partiellement
détruits. Quant au prix payé, il s'avèrera relativement peu élevé, comparé à
d'autres raids précédents : 7 Lancaster ne rentreront pas au petit matin et 49
lits resteront vides dans les baraquements de la Royal Air Force. Parmi les
pertes, figure le Lancaster immatriculé ED923 du 97 Squadron, piloté par Robert
Palmer. Son destin s'est joué audessus de Wonck. Un Messerschmitt, chasseur de
nuit allemand, piloté par le Leutnant Erlinghagen, venant de sa base de Saint-Trond,
fonce vers lui, guidé par le radar au sol, puis par celui de l'appareil. Il
suffit de quelques rafales pour abattre le bombardier britannique.[21] Ces mêmes rafales que le
curé Beek a entendues à 1 heure du matin et annotées dans son journal. Touché à mort, à la
verticale du centre historique de Wonck, l'avion s'est embrasé aussitôt et a
plongé vers le sol. Courageusement resté aux commandes, Palmer a tout fait pour
stabiliser l'appareil en flammes et permettre à son équipage de sauter dans le
vide. Plusieurs témoins, dont
la famille Van Roy, à Wonck sur la Haute Voie, l'ont vu passer en feu au-dessus
de la vallée. " Il faisait clair comme en plein jour " m'a raconté mon
meilleur ami André. Depuis le presbytère de Wonck jusqu'à son point de chute à
Bassenge, il a parcouru dans sa descente environ trois kilomètres. Il gît en
flammes dans une prairie, près d'un méandre du Geer. Deux membres de
l'équipage ont pu s'éjecter de l'appareil. Hélas ! l'avion était trop près du
sol. L'un s'est écrasé derrière le moulin Boelen à Roclenge, à 200 mètres de
l'impact.[22]
L'autre a eu le bonheur de voir la corolle blanche se déployer au-dessus de
lui. Malheureusement, il a abouti dans les branches du peuplier, au pied duquel
l'avion en feu s'est écrasé. Prisonnier dans les cordages de son parachute, ne
pouvant se dégager, brûlé par la chaleur intense dégagée par l'appareil en feu,
sachant ce qui va se produire immanquablement, l'homme appelle à l'aide de
toutes ses forces. Habitant à faible distance du " crash ",
Nicolas Beaurieux arrive un des premiers sur les lieux de la catastrophe. Tout
de suite, il se rend compte de la situation désespérée de l'aviateur. " Vite, trouvez une
grande échelle ! " ordonne-t-il à la famille Box, tandis que lui-même s'en
retourne rapidement à la maison pour aller chercher ses fameuses " gripètes
" qui lui permettent d'escalader les peupliers pour les élaguer. Il
revient bientôt, tout essoufflé, muni de son matériel. Avec les Box et des voisins,
qui ont déniché une grande échelle, il s'apprête courageusement à intervenir
lorsque le chargement de bombes explose soudainement, déchiquetant l'appareil,
tuant le malheureux rescapé, provoquant de grands dégâts dans les environs,
projetant les restes calcinés d'un autre membre de l'équipage contre la maison
Das, à 75 mètres du point de chute de l'avion,[23]
et un moteur à plus de 200 mètres de là, sur le coteau ouest de la vallée. Nicolas Beaurieux et les
Box l'ont échappé belle... Rageur, car il n'a pu secourir à temps le malheureux
aviateur, Nicolas va quand même escalader l'arbre, avant l'arrivée des
Allemands, et récupérer une grande partie du parachute pour faire des robes à
ses trois petites filles. Quelques jours plus tard,
Nicolas va reprendre son activité " charbonnière ". Deux autres
anecdotes à signaler: l'une particulièrement comique, l'autre qui aurait pu se
terminer de façon tragique. Un jour, Nicolas parvient
à ouvrir une fois de plus un wagon d'un convoi en mouvement. A sa grande
surprise, ce n'est pas du charbon qui s'écoule, mais une quantité
invraisemblable de choux-fleurs. Ils rebondissent sur l'accotement, dévalent le
talus et aboutissent jusque dans son potager... Contre mauvaise fortune, notre
saboteur fait tout de même bon cœur. Le soir, à l'aide d'une manne, il distribue
les légumes à tous ses voisins du Grand Brou.[24] L'hiver 1943 s'annonce
rigoureux, à l'instar des précédents. Nicolas, ayant appris qu'un couple de
vieux roclengeois étaient décédés de froid, il décrète aussitôt, lui Nicolas
Beaurieux, que plus aucun habitant de son village ne connaîtra pareille misère.
Alors il s'acharne et fait de grandes provisions de charbon. Il en récolte
tellement qu'il doit l'enterrer dans son jardin. Puis il s'enquiert auprès de
ses concitoyens et apporte le précieux combustible là où le plus grand besoin
se fait sentir. Les Allemands ont
évidemment remarqué cette activité qui ne fait que s'amplifier, car une traînée
de charbon se trouve le long de toute la voie. Or notre homme, si méfiant et si
prudent d'habitude, va commettre une énorme erreur, indigne de sa personnalité.
Alors qu'il se met à neiger, il veut absolument terminer le travail qu'il a
commencé. Il laisse malheureusement des traces noires sur le manteau neigeux.
Celles-ci aboutissent évidemment à sa maison. Le lendemain, il est arrêté par
les Allemands et incarcéré à la prison de Tongres. Nicolas plaide sa bonne
foi. Il affirme qu'une de ses poules s'est échappée. Il a voulu la rattraper car
les œufs coûtent très cher à cette époque et il a trois enfants à nourrir. Elle
a gravi le talus. Il l'a suivie et c'est là qu'il a découvert du charbon le
long de la voie. Il y en avait tout le long. Il en a ramassé pour faire du feu
pour ses trois petites filles, sa femme et son vieux père, âgé de septante-neuf
ans. Ignorant à qui ils ont
affaire, les Allemands le libèrent après quinze jours de détention, mais en le
menaçant de déportation en Allemagne, en cas de récidive. Il n'empêche, l'alerte,
cette fois, a été chaude. Aussi, se range-t-il définitivement à la
recommandation énergique de son épouse, de s'abstenir dorénavant de toute
nouvelle action. Cela d'autant plus que les réserves enterrées dans son terrain
garantissent à la famille de passer l'hiver au chaud, tout en aidant encore de
temps en temps un couple en difficulté. Définitivement ? Nicolas,
on le sait, a énormément de volonté. Il résiste à tout... sauf à la tentation.
Or l'inactivité lui pèse. Le soir du 24 décembre 1943, il va quelque peu y
remédier. Il s'absente un long moment. Son épouse craint le pire, d'autant plus
qu'il garde le mutisme, une fois rentré à la maison. Il a promis à Catherine de
ne plus s'attaquer aux convois, mais il n'a pas promis de ménager la signalisation. Un train arrive et
s'arrête juste derrière la maison. Ce n'est plus un convoi de Juifs cette fois,
mais un convoi de permissionnaires allemands. Ils boivent et chantent à
tue-tête pour fêter Noël et leur retour à la maison. Apercevant de la lumière à
l'arrière de la maison des Beaurieux, ils descendent le talus, en rigolant, et
frappent à la porte. Nicolas est bien obligé de leur ouvrir. " Choyeux Noël ! " crient-ils. Ils
offrent des friandises aux enfants et du schnaps à Nicolas et à son épouse. A
contrecœur, nos deux Roclengeois sont bien forcés de trinquer avec eux et de
boire à leur santé. Après un très long moment d'éclats de rires et de chants,
le sifflet de la locomotive les invite à regagner leurs voitures. '' Auf Wiedersehen ! Und noch Choyeux Noël ![25] Le train se remet en
marche. Médusé Nicolas ne dit mot, d'autant plus que sa petite Lisette lui
déclare : " Ils sont gentils les Allemands... "[26] Cette fois, c'est bien
décidé, Nicolas tourne définitivement le dos à celle qui fut, durant plus de
deux ans, sa généreuse voisine. Est-ce à dire qu'il
renonce à faire de la résistance ? Ce serait bien mal le connaître que d'oser
l'affirmer. Etant donné les multiples
revers subis par les armées allemandes durant l'année 1943, tant dans les
étendues glaciales de l'Union Soviétique que dans le sable chaud de l'Afrique
du Nord, ou encore dans les îles paradisiaques de Sicile et de Corse, sans
oublier le débarquement allié en Italie du Sud, un réseau F.I. (Front de
l'Indépendance) voit le jour à Roclenge-sur-Geer. Nicolas Beaurieux y adhère
avec enthousiasme. Compte tenu de sa grande
hardiesse et de sa forte personnalité, il est chargé d'une tâche particulièrement
ingrate mais très dangereuse : le transport des armes, des munitions et des
explosifs. Plus de 70 ans après les
faits, il nous est impossible de préciser comment et où il les réceptionnait, encore
moins où il les transportait. Nous savons cependant où il les cachait. Une nuit, la petite
Maggy, dix ans et demi, se lève pour aller sur le pot d'aisances. Elle entend
des chuchotements venant du rez-dechaussée. Intriguée, elle descend avec
précaution l'escalier et ouvre lentement la porte de la cuisine. Elle aperçoit
alors ses parents s'exprimant à voix basse pour qu'on ne les entende pas. Son
père est en salopette et d'une saleté repoussante. Une puanteur insupportable
parvient jusqu'à ses narines. Affolée la petite regagne
aussitôt son lit et se réfugie sous les couvertures. Le lendemain, à l'école
des Sœurs de Saint-Joseph située au bout de la rue, elle affiche une mine
particulièrement déconfite. Pendant la récréation, elle s'isole dans la cour,
elle d'habitude si gaie et si énergique. Son regard, particulièrement triste,
n'échappe pas à une bonne sœur. Celle-ci s'approche. " Qu'est-ce qui se passe Maggy ? Tu as l'air
bien triste ". Maggy ne répond pas. Mais la béguine insiste. " Tu dois tout me dire Maggy. N'oublie pas que
je suis ta meilleure amie ! " La petite fille secoue la
tête en signe de négation. Des grosses larmes se mettent à couler sur ses
belles joues roses. " Oh ! la la, mais c'est un gros chagrin que
celui-là... Confie-le-moi, je t'en
prie. Nous serons deux à le partager et il sera plus léger à supporter. Je te
promets en outre de ne rien dire à personne, ni à tes deux sœurs, ni à tes
parents. " Cette fois Maggy éclate
en sanglots. " Je crois bien que mon
père est un voleur ". "
Comment cela ? " Maggy lui explique alors
la scène dont elle a été le témoin durant la nuit. La sœur sourit avec
bonhomie. " Oh ! non Maggy, tu te
trompes. Ton père n'est pas un voleur. Bien au contraire ! Un jour, tu
connaîtras la vérité et tu seras alors très fière de ton papa. Mais d'ici là ne
raconte à personne ce que tu m'as dit ! " La vérité est que Nicolas
dissimulait les armes, les munitions et les explosifs dans un caveau du
cimetière, au milieu des macchabées ... Vallée du Geer été 1944 L’annonce à la radio du débarquement
allié sur les plages de Normandie, le mardi 6 juin 1944, provoque une explosion
de joie au sein de la population et suscite bien des espoirs. Elle incite
également la résistance locale à passer à l'action. Celle-ci s'est d'ailleurs enrichie d'un
autre mouvement. Pour faire contrepoids à la création du F.I. à Roclenge
quelques mois plus tôt, un autre groupement a vu le jour à Wonck : le M.N.B.,
le Mouvement national belge. Jean Tilkin de Bassenge en prend aussitôt le commandement. Va-t-il
y avoir surenchère entre les deux réseaux car on devine aisément que c'est déjà
la politique d'après guerre qui se dessine ? Sans doute. Y aura-t-il
coordination entre les deux mouvements ? On peut se permettre d'en douter car
ils vont se livrer, l'un et l'autre, sans qu'on sache évidemment à qui les attribuer,
à des actes parfaitement inutiles, n'ayant aucun effet sur le déroulement des
hostilités, mais susceptibles de faire courir de grands risques à la
population. Ainsi, ils dynamitent quatre poteaux électriques
en bois, sur le plateau nord de Wonck, qui amènent l'électricité aux villages
voisins de Zichen et de Zussen. Comme le Limbourg, à cette époque, ne connaît
pas la prospérité qui est la sienne actuellement, le seul résultat a été de
priver les braves paysans flamands de ces deux localités, de plusieurs heures
de cette énergie oh ! combien utile. Le dimanche 11 juin, toujours sur le
territoire de Wonck, ils mettent le feu à la toiture du dépôt des motrices de
la ligne de tramways Liège-Bassenge-Riemst. Le samedi 29 juillet, ils prennent de
nouveau pour cible cette gare du vicinal et y commettent un second attentat. Dans quel but les maquisards, comme on
les appelle, ont-ils agi ? Pour détruire les moyens de locomotion et empêcher
ainsi les ouvriers d'aller gagner leur subsistance dans les usines de Herstal,
comme notamment à la Fabrique Nationale, dont on sait qu'elles fonctionnent
pour les Allemands ? Mais dans ce cas, il fallait agir nettement plus tôt et
non pas quand les perspectives de libération sont de plus en plus réelles et
qu'on devine que ces mêmes usines tourneront bientôt – du moins on l'espère –
au profit des Alliés. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter
un regard sur les nombreuses cartes géographiques qui fleurissent sur les murs
des cuisines de beaucoup de maisons et sur lesquelles les habitants indiquent,
grâce à de petits drapeaux montés sur des aiguilles, l'avance des Alliés tant
en Italie qu'en France et la poussée soviétique sur le front de l'Est. Chaque
semaine, à l'annonce des bonnes nouvelles, ils se font un plaisir de déplacer
ceux-ci : un peu plus au Nord en France et en Italie, un peu plus à l'Ouest en
Russie ... D'autres petits drapeaux sont
déjà prêts pour prendre place sur la carte représentant le territoire national.
Toujours est-il que ce
nouveau sabotage va coûter cher à la commune de Wonck. En guise de
représailles, elle est condamnée à envoyer des hommes pour monter la garde
toutes les nuits et à livrer huit postes de T.S.F., Transmission sans fil,
autrement dit des postes de radio. L'autorité communale va
réagir et proposer aux habitants, afin de ne pas faire retomber tout le poids
de la peine sur quelques-uns, de payer une amende de 20, 100, 200, 300 ou 500
francs par ménage, selon les ressources de chacun. Tout rentre donc dans
l'ordre grâce à l'argent. Mais il est à craindre, que lors d'une action plus
spectaculaire, il y ait arrestation d'otages avec des conséquences plus
dramatiques ... L'accalmie dure un peu
plus d'un mois. Mais au fur et à mesure de l'avance inexorable des Alliés,
l'ardeur guerrière des partisans ne fait qu'augmenter. Début septembre, ils
font sauter à plusieurs reprises des pylônes de la haute tension et les rails
du vicinal. Tout le monde s'interroge une fois de plus, étant donné que ce
matériel pourrait bientôt servir au profit des Alliés. Plus que jamais, les
habitants de la vallée redoutent des représailles, d'autant que le charroi
allemand, dont l'armée bat en retraite, augmente davantage chaque jour sur la
route Tongres-Visé. Pressé par ses
paroissiens, le curé Beck de Wonck recommande, une nouvelle fois, le calme et
la prudence lors des divers offices. Le lundi 4 septembre, la
retraite allemande s'accentue. Visiblement le front se rapproche. Le charroi,
qui avait commencé vers le milieu de la semaine, devient intense sur la route
Tongres-Visé et la route Tongres-Maestricht. La libération est pour bientôt.
Hélas ! une grave menace plane sur la vallée. Le bruit court en effet que les
partisans veulent dynamiter la voie ferrée ... Cette fois, la
désapprobation est générale. Plusieurs habitants s'efforcent de convaincre les
chefs de renoncer à leur projet. En vain ! A la demande du garde champêtre, le
curé Beck fait une dernière tentative auprès des partisans MNB, qui ont choisi
comme repaire les grottes de tuffeau dans le Goffette à Wonck,[27]
nettement plus inaccessibles que celles
du Lovain Tentative bien inutile
puisque vers midi deux fortes explosions se font entendre. Le rail a sauté,
mais c'est la voie que n'empruntent pas les convois allant à Visé.[28]
Les trains roulent toujours ... Ce n'est cependant que
partie remise. A 14 heures 30, une nouvelle explosion ébranle toutes les maisons.
Quelques coups de feu claquent, bientôt suivis par une fusillade nourrie du
côté du Pierreux. Le train a déraillé à la limite de Wonck et de Bassenge, et
les Allemands font feu sur le bois Bechet et les maisons environnantes. Pris de
panique, les habitants de celles-ci, qu'on a omis de prévenir de l'imminence du
danger, s'enfuient à travers les prairies de la Suluze. Se faufilant entre les
peupliers pour éviter les balles, ils n'ont finalement d'autre recours que de
se jeter à l'eau pour traverser le Geer et se mettre à l'abri. Dans le village de Wonck,
c'est évidemment l'exode général. Vers les grottes, en ce qui concerne les
femmes et les enfants. Vers les localités voisines de Val-Meer, de Zichen et de
Hallembaye, en ce qui concerne les hommes. Après avoir ratissé le bois, les
Allemands gagnent les campagnes. Progressant en tirailleurs, ils sillonnent
celles-ci, à la recherche des auteurs du sabotage. Quelques-uns aboutissent
dans la Cour du Pierreux. Ils lancent deux grenades à l'intérieur de la maison
Sauveur et abattent le chien. Ce sera d'ailleurs la seule victime de cette
journée mémorable ... Inspectant minutieusement
les habitations, ils découvrent les sœurs Niesten dans la cave de la maison
Huynen et les obligent à porter de l'eau aux blessés que transporte le convoi.
A l'épouse Huynen qu'ils dépouillent de ses bagues, de son alliance et d'une
caisse de fromage, ils profèrent la menace suivante : " Si nous avons un seul homme tué, nous
brûlons le village...". Même menace à Bassenge,
où les soldats se sont également éparpillés et où ils ne trouvent que des
vieillards. Dans la rue Vinâve, ils pillent deux magasins et saccagent des
maisons. C'est également le sort de certaines habitations de Wonck. Après une bonne
demi-heure de tir, tout redevient calme et les Allemands commencent à réparer
la voie. Trois wagons ont déraillé. Mais la locomotive est intacte et se trouve
toujours sur les rails. A l'aide de crics puissants, les soldats soulèvent les
voitures et enlèvent les rails tordus qu'ils remplacent par ceux de l'autre
voie. Les heures passent,
anxieuses, interminables. Et pendant ce temps, à quelques kilomètres de là,
l'aviation alliée bombarde la route de Tongres-Riemst-Maestricht et le pont de
Visé ... Quelle belle cible le train à l'arrêt aurait constituée pour les
pilotes anglais et américains ! Encore fallait-il qu'ils soient au courant...
Malheureusement il semble bien que les partisans aient agi de leur propre
initiative, sans ordre et sans la moindre coordination avec les responsables de
la Résistance. Leurs chefs seront
d'ailleurs violemment pris à partie par des Wonckois, ces derniers leur
reprochant d'avoir fait courir sans raison un danger terrible au village. Dans
le bois Bechet qui constituait un endroit idéal pour organiser l'attentat, il
n'y avait pas le moindre partisan au moment du sabotage. Tous s'étaient mis à
l'abri, bien avant les premiers coups de feu. Alors les villageois
s'interrogent et se demandent pourquoi ils ont cru devoir bloquer un train qui
regagnait l'Allemagne. A 20 heures, la
réparation est enfin terminée. Les Allemands libèrent un otage, porteur d'un
message. Les termes sont suffisamment éloquents : " En cas de récidive, cent otages seront fusillés dans un rayon de trois
kilomètres du lieu du sabotage ...". Le convoi repart, précédé
des civils qu'ils ont réquisitionnés pour les aider à réparer la voie. Ils les
obligent à marcher devant la locomotive ... L'entrée du tunnel Wonck-Hallembaye
est atteinte. Les otages s'arrêtent, espérant obtenir leur libération. Pas
question ! Particulièrement méfiants, les Allemands leur font signe de
poursuivre leur chemin. Ils ne les libéreront qu'à l'autre extrémité de
l'ouvrage. Trois autres convois
passent encore dans la Soirée, chargés de milliers de soldats. Les habitants
frémissent à la pensée que tout ce beau monde aurait pu être bloqué à Wonck ...
Le lendemain, 5
septembre, grande effervescence à Wonck dans le courant de l'après-midi. Les
partisans s'y regroupent en vue d'une nouvelle opération. Ils affluent de tous
les villages voisins, à pied et à vélo. Pour équiper ceux qui vont à pied, un
ordre de réquisition est signé. Le rassemblement
effectué, les instructions sont données : gagner par les chemins champêtres le
village de Berg où doit avoir lieu un parachutage important d'armes et de
munitions ; ensuite après avoir pris livraison de celles-ci, se rendre à la
caserne de Tongres pour y garder des prisonniers. Au moment du départ,
quelques-uns veulent se dérober à leur devoir. Ils sont aussitôt rappelés à
l'ordre par Jean Tilkin, plus décidé que jamais à agir et à faire oublier le
pénible incident de la veille. Fort d'une quarantaine
d'hommes, le groupe se met en selle et disparaît dans la rue du Goffette. Dans
le lointain, à l'Ouest, on entend des détonations continuelles. Tout à coup,
une fusillade plus rapprochée sème le désarroi dans la population. Les gens
s'interrogent. Est-ce à Roclenge ? Les partisans y seraient-ils mêlés ?
L'angoisse étreint les cœurs. L'attente devient pénible. Fort heureusement à 20
heures, la plupart des jeunes gens sont rentrés. Leur récit est des plus
alarmant : attaqués par les troupes allemandes entre Roclenge et Boirs et
n'étant pas armés, ils se sont sauvés. Certains ont pu aller jusqu'à Berg,
d'autres ont atteint Tongres dont la caserne brûle et saute. Les Allemands,
ajoutent-ils, tirent à la mitrailleuse sur tous ceux qu'ils voient passer ... Jusque 22 heures 30, des
coups de feu sporadiques éclatent dans la vallée. Les Allemands
feraient-ils une chasse à l'homme ? Sans doute ... Mieux ! A 23 heures, un
avion survole plusieurs fois la vallée à basse altitude et lance des fusées
lumineuses. Il fait clair comme en plein jour. Tout à coup il ouvre le feu. Il
tire à la mitrailleuse à plusieurs reprises, puis s'éloigne. Cette fois le
doute n'est plus permis : les Allemands pourchassent les derniers partisans.
Craignant des représailles, la plupart des Wonckois se réfugient, une fois de
plus dans les grottes ... Toute la lumière est
faite le lendemain sur les fameux événements de la veille. Tout d'abord,
l'avion en question était un avion anglo-saxon ... Il a mitraillé l'emplacement
de la D.C.A. de Bassenge et la route de Houtain-Saint-Siméon, toujours aussi
fréquentée par les véhicules allemands. Ensuite, contrairement à leurs affirmations, les partisans
n'ont, heureusement pour eux, fait la rencontre d'aucun soldat ennemi. ..
Certains, il est vrai, sont allés jusqu'à Berg où ils ont attendu vainement le
parachutage annoncé. Mais la plupart ont rebroussé chemin, bien avant cette
localité. Quant à la caserne de Tongres, elle est toujours occupée par des
troupes allemandes ... Enfin, l'essentiel c'est
qu'ils soient tous rentrés. L'avis est unanime après cette double
aventure: il serait préférable qu'ils attendent tranquillement comme tout le
monde, l'arrivée des Américains. Celle-ci ne devrait d'ailleurs plus guère
tarder, du moins à en juger par le son du canon. Toute la journée de ce
mercredi 6 septembre, une forte canonnade se fait en effet entendre à l'Ouest
et au Sud. Elle ne prend fin qu'à 20 heures ... Nicolas Beaurieux a-t-il
participé à l'une ou l'autre de ces actions ? C'est possible compte tenu de son
respect de la discipline, de la hiérarchie. En tout cas ce qui est certain,
c'est qu'il se livre, durant ces jours-là, à l'activité qu'il apprécie
par-dessus tout : la capture de soldats allemands. Les deux premières
victimes sont deux adolescents, qui marchent isolément. Nicolas les a mis en
joue alors qu'ils s'approchent en toute quiétude. Il va appuyer sur la gâchette
lorsqu'il se ravise fort heureusement. " Non Nicolas, tu ne peux pas faire cela, se dit-il. Ce sont encore des
enfants." Il les fait néanmoins prisonniers et se saisit de leurs
armes. Etant donné qu'ils ne portent aucun insigne, aucune décoration, il
arrache à l'un d'eux, comme trophée, une petite chaîne avec une croix,[29]qu'il
porte autour du cou. Il les emmène ensuite à la gendarmerie de Roclenge, pour
les y emprisonner, au grand dam des occupants. Il va bientôt l'avoir sa
croix de fer 1939 avec rubans[30]
car, la fois suivante, il en capture cinq en même temps. En avant marche !
Destination : la gendarmerie locale. Cette fois les gendarmes
sont furibonds. Non seulement ils manquent de place pour accueillir tout ce
beau monde, mais ils n'ont pas de quoi les nourrir. Enfin, ils craignent pour
leur propre vie, car la gendarmerie se trouve juste en bordure de la route
provinciale que les Allemands, en retraite, empruntent de plus en plus. Aussi
menacent-ils fermement notre phénomène de ne plus accepter à l'avenir le
moindre prisonnier. A contrecœur, Nicolas
doit ronger son frein car il pourrait faire de nombreuses autres captures, tant
la retraite ennemie s'accentue au fil des jours. Il ne peut, non plus, se
permettre d'en abattre quelques-uns. A Glons, village voisin, des soldats
" SS " ont massacré des partisans et menacé de représailles la
population. En dépit de ses bonnes
résolutions, Nicolas ne va pas résister longtemps à la tentation. Ayant aperçu
entre Boirs et Slins une fumée se dégageant d'une " chavée ", ces
petits ravins boisés, typiques de la vallée du Geer, qui ont été creusés depuis
des millénaires par les eaux de ruissellement, il s'approche avec précaution.
Il n'en croit pas ses yeux. Au milieu de celle-ci, sept mètres au-dessous de
lui, une cinquantaine d'ennemis sont en train de se restaurer. Non, vraiment, il ne peut
pas se permettre de rater une telle prise. Bien qu'étant seul, il décide
aussitôt d'agir. Il dégoupille deux grenades et les lance au beau milieu d'eux.
Puis il se lève hardiment et les menace de sa Schmeisser. Il crie des ordres et
fait des signes comme s'il commandait à plusieurs partisans. Se croyant
encerclés, les soldats jettent aussitôt leurs armes et lèvent les bras. Sur un
geste de Beaurieux, ils gravissent ensuite la pente en transportant les
blessés. A leur grande surprise, ils se rendent alors compte que le " terroriste
" est seul et qu'il les a bien dupés. Mais il est terriblement menaçant
avec sa mitraillette et ses yeux qui lancent des éclairs. Aussi n'osent-ils pas
faire la moindre tentative de rébellion ... Se tenant à une certaine
distance pour ne pas être pris en défaut, Nicolas leur permet d'abord de
soigner les blessés. Puis " Vorwarts ! ". En avant ! Il les conduit à
travers champs dans une petite ferme de Houtain-Saint-Siméon dont il sait
qu'elle sert de relais pour rapatrier les aviateurs alliés, relais dont a
bénéficié jadis le Juif qu'il a sauvé. Les captifs sont enfermés
dans une grange. Les propriétaires, faisant partie de l'Armée blanche, sont
chargés avec d'autres résistants, de veiller à ce qu'aucun ne s'échappe avant
l'arrivée des Américains. Ceux-ci ne tarderont sans doute pas à venir prendre
rapidement livraison de ces captifs encombrants, à en juger par le bruit du
canon qui, d'heure en heure, ne fait que s'intensifier et se rapprocher. On
entend même crépiter les mitrailleuses lourdes. La libération L e vendredi 8 septembre, bien avant
l'aube, les Allemands, qui gardaient le tunnel, ont quitté définitivement le
village de Wonck. Aussi à 8 heures, beaucoup de fidèles assistent à la messe
solennisée que le curé Beck célèbre en action de grâces. Tout à coup, à la
postcommunion, une violente explosion très rapprochée sème un moment la panique
dans l'assistance. Quelques-uns se précipitent à l'extérieur de l'église.
Au-dessus de Bassenge, un nuage rose a fait son apparition. Bientôt la nouvelle
se colporte de maison à maison : l'arrière-garde allemande, composée de deux
hommes seulement, a fait sauter le pont sur le Geer à Bassenge ... sous les
yeux des partisans. Les dégâts sont hélas ! très importants. Ainsi les résistants ont raté la
dernière chance de se mettre en valeur, la seule occasion où leur action non
seulement se justifiait, mais s'imposait. Hélas! Nicolas Beaurieux n'était pas
présent. Pendant ce temps, il gardait, seul, le pont de Roclenge, en face de la
maison communale. Dissimulé derrière un tas de matériaux de la maison Engelbel,
armé jusqu'aux dents, il était bien décidé à empêcher à tout prix la
destruction de l'ouvrage[31].
Comme celui-ci est situé à environ 120 mètres de la route provinciale, les deux
Allemands de l'arrière-garde ignoraient totalement son existence. Heureusement
pour eux, car s'ils avaient osé la moindre tentative, ils n'auraient pas eu le
loisir de raconter, beaucoup plus tard, à leurs petits-enfants leurs souvenirs
de guerre, si toutefois ils ont survécu au conflit. Nullement gênés de leur passivité
coupable à Bassenge, les deux chefs MNB, juchés sur leur moto, font le tour du
village de Wonck en véritables libérateurs et invitent la population à pavoiser
dignement. Aussitôt, comme par enchantement, des dizaines de drapeaux belges et
alliés font leur apparition aux fenêtres et ornent toutes les façades. Pour peu de temps ... Les deux hommes
réapparaissent, porteurs cette fois de mauvaises nouvelles : " Les Allemands reviennent ! " Il
n'en faut pas plus pour que les rues perdent, en l'espace de quelques secondes,
leur air de fête ... Ce que les chefs maquisards ont
pris pour ennemi n'est autre qu'un véhicule de reconnaissance américain, venant
de Tongres en éclaireur. Par la rue Vinâve à Bassenge et la Haute Voie à Wonck,
il est aussitôt dirigé dans les grottes du Goffette, pourvues d'une grande
entrée permettant son passage et dans lesquelles s'exercent les fameux
guerriers à la salopette beige de lin et au béret alpin enrubanné de tricolore.
C'est mon premier contact
avec nos libérateurs. Ils sont cinq ou six juchés sur leur véhicule, leur radio
de bord fonctionnant sans arrêt. Mon père a cueilli pour eux, dans notre
verger, un petit panier d'excellentes prunes. Du bout de mes petits bras, j'ai
toutes les peines à le tendre à ces inconnus. L'un d'eux s'en saisit avec un
large sourire. Mais je ne reçois rien en retour, car ils ont déjà tout
distribué à la trentaine de curieux accourus pour les voir. Je serai comblé
l'après-midi. Comme les avant-gardes
américaines occupent Houtain-Saint-Siméon, je suis allé les voir avec ma
famille, à mi-côte entre Bassenge et Houtain, un petit bouquet de fleurs à la
main. Les soldats m'ont souri et m'ont donné un curieux paquet de friandises,
friandises qui semblaient faire leur délice mais que j'avais, quant à moi, bien
du mal à manger. Sans le savoir, je venais de faire la connaissance du célèbre
chewing-gum... Pendant que la population
leur faisait fête, un avion allemand a surgi et ouvert le feu. Aussitôt toutes
les mitrailleuses des blindés se sont mises à crépiter, provoquant un beau
vacarme mais ôtant à l'intrus toute envie de recommencer... Tous les Wonckois
sont revenus enchantés du spectacle qui leur a été donné... A 20 heures, la
plupart d'entre eux ont assisté au salut solennel, célébré en l'honneur de
l'arrivée des libérateurs, salut ponctué par l'interprétation des hymnes
nationaux. Le samedi 9 septembre,
les habitants assistent dans la vallée à un véritable raz-de-marée américain.
Des milliers d'hommes de la 30ème Division d'infanterie " The
old Hickory " s'installent dans les villages de Wonck, Bassenge et
Roclenge. Leur chef, le MajorGénéral Leland Stanford Hobbs établit son
Quartier-Général au château " Colleye " à Roclenge. La joie n'est pas de mise
partout dans la vallée, car les Allemands tiennent toujours Emael et le fort,
ainsi que Kanne, le dernier village belge avant l'importante ville de
Maestricht. Le lendemain, dimanche 10
septembre, le bruit court que le fort d'Eben-Emael pourrait être bombardé dans
le courant de l'après-midi pour en expulser les derniers ennemis. En
conséquence, les habitants sont invités, par les partisans, à ouvrir toutes les
fenêtres, afin d'éviter d'éventuels dégâts. Cette nouvelle provoque aussitôt un
nouvel exode vers les grottes. Les moins peureux, désirant assister au
spectacle, gravissent la forte pente du Lovain. Vers 17 heures, à partir
du plateau, ils voient défiler l'infanterie yankee en longues lignes espacées
depuis Zichen jusqu’Eben. Ils distinguent nettement les blindés et les
fantassins se préparer à l'attaque. Celle-ci finalement n'a pas lieu. Sous la
double pression, venant à la fois de la vallée et du Nord, les Allemands
abandonnent Emael et se retranchent à Kanne, derrière le Canal Albert dont ils
font sauter le pont. Le lundi 11 septembre,
les Américains arrivent de nouveau en masse. Leur lourde artillerie, constituée
principalement de pièces de 155 portants à 22 kilomètres, s'installe à Wonck et
dans les environs immédiats (campagne de Zichen, Houtain-Saint-Siméon,
Bassenge). Le canon gronde durant
toute la journée. Pour le moment, les lourdes batteries canonnent les positions
ennemies au-delà du Canal Albert, à 14 kilomètres, leurs tirs étant dirigés par
un petit avion d'observation. D'un rouge vif, l'appareil atterrit en pleine
campagne, près du marronnier, point de repère bien connu de tous les habitants
de la région. Dans le village de Wonck,
la circulation devient intense : canons tractés, autos-mitrailleuses, véhicules
de transmissions, camions et jeeps. Manifestement, les Américains se préparent
à une grande offensive. Dans son Q.G. de Roclenge, le Major-Général Hobbs
affine ses plans. Son prochain objectif est la prise de la ville de Maestricht,
au confluent de la Meuse et de la petite rivière du Geer. Il devine que ce ne
sera pas une opération facile, malgré la bravoure de ses soldats, auxquels les
Allemands ont donné le surnom de " SS de Roosevelt ".[32] Précisément, parlons-en
de ces Allemands ! Contrairement à leurs " Kameraden ", qui depuis le
22 juin 1941 combattent dans des conditions particulièrement pénibles en
Russie, les soldats allemands stationnés en France y ont passé, durant quatre
ans, un séjour fort agréable : magnifique pays, bon climat, excellente table
avec des vins raffinés, diverses sortes de fromages, du champagne à volonté, et
de surcroît des jolies filles, dont certaines consentantes. Ils se sont
cependant bien battus sur les plages de Normandie et surtout dans le Bocage.
Mais après le désastre de la poche de Falaise, dans laquelle ils ont laissé, du
6 au 21 août, 10 000 morts, 50 000 prisonniers et une grande quantité de
matériel, ils n'ont fait que battre en retraite, constamment harcelés par l'aviation
alliée, maîtresse absolue du ciel. Le découragement a gagné les rangs, au point
qu'il a fallu procéder à de nombreuses exécutions pour rétablir le moral et la
discipline. Cependant à mesure qu'ils se sont rapprochés de la " Heimat ",
la mère patrie, ils ont retrouvé toutes leurs qualités guerrières qui avaient
fait d'eux la meilleure armée du monde. Tout cela, le
Major-Général Hobbs le sait, alors qu'il consulte pour la énième fois la carte
de la région, avec l'inscription MAASTRICHT en grand, au-dessus de celle-ci. Il
a conscience que la prise de cette ville constituera à coup sûr sa mission la
plus difficile depuis le débarquement de sa division à Omaha Beach le 11 juin
1944. Il s'attend en effet, compte tenu de la disposition des lieux, à une
bataille particulièrement sanglante, bien qu'il disposera de l'appui aérien et
du concours de l'artillerie qui prépare déjà le terrain en pilonnant sans arrêt
les positions ennemies. Trois possibilités se
présentent à lui pour atteindre son objectif. Tout d'abord le chemin le plus
court par la vallée du Geer. Mais le pont de Kanne sur le Canal Albert, entre
la tranchée de Caster et celle de Vroenhoven, a été détruit par les Allemands.
Livrer combat à cet endroit, pour traverser la voie d'eau, serait un véritable
suicide. Autre possibilité, un peu
plus au Nord : emprunter en partie l'ancienne voie romaine qui relie Tongres à
Maestricht. Mais le pont, qui surplombait la tranchée de Vroenhoven, plus de
vingt mètres audessus du célèbre canal, a sauté lui aussi. Le premier
lieutenant Clarence Jaeggli, parti en éclaireur la veille, a voulu s'approcher
du fortin belge qui gardait l'ouvrage le 10 mai 1940. Il a été tué par un
tireur d'élite ennemi retranché de l'autre côté. Mener l'opération à partir
d'ici se traduirait par un échec plus cuisant encore que si la tentative avait
lieu à Kanne. C'est pourquoi, le
Major-Général Hobbs a retenu la troisième solution, celle qui se trouve à
l'Est. Mais celle-ci comporte également d'énormes difficultés car il faudra
franchir le double obstacle que constituent le Canal Albert et la Meuse. Hobbs, en ce 11 septembre
1944, est confronté au même problème que celui qu'avait rencontré l'armée
allemande le 10 mai 1940. On sait comment l'Etat-Major nazi l'avait résolu :
traversée de la Meuse à Maestricht et attaque, à l'aube par surprise, par des
aéroportés à bord de planeurs, des ponts de Vroenhoven et de Veldwezelt ;
attaque simultanée toujours avec des planeurs du massif du fort d'Eben-Emael et
élimination par charges creuses[33]
des canons tirant vers le Nord pour empêcher ceux-ci de détruire les ponts pris
intacts. La réussite extraordinaire de cette double opération permit aux
Panzerdivisionen de franchir le Canal Albert et de déferler ensuite dans le
centre du pays, faisant croire aux Alliés que c'était de nouveau le plan
Schlieffen de 1914 qui était utilisé, alors que le gros des forces allemandes
était en train de traverser l'Ardenne pour foncer ensuite vers Dunkerque. Les Allemands avaient
bénéficié d'une surprise totale. Celle-ci profite toujours à l'assaillant car
lui seul connaît la date, l'heure et l'endroit où il va frapper et essayer de
percer. Il n'en va pas de même
pour le célèbre général américain de la non moins célèbre 30ème
Division d'infanterie. Cette fois, il n'y aura pas de surprise. Les Allemands
les attendent de pied ferme et savent qu'ils ne peuvent tergiverser. Les
frappes de l'artillerie constituent d'ailleurs en elles-mêmes une précieuse
indication sur les intentions des Américains. Aussi renforcent-ils leurs
positions à Eysden audelà du fleuve. Depuis le massif du fort d'Eben-Emael, les
observateurs américains les distinguent nettement dans leurs jumelles en train
de creuser de nombreux trous individuels et d'installer des pièces antichars. Son plan définitivement
arrêté, Hobbs prend ses dernières dispositions pour le lendemain. La 30ème D.I. essayera de traverser le Canal Albert à
deux endroits différents : à Lanaye, pour faire diversion, près du pont gisant
lui aussi dans l'eau, et à Argenteau légèrement en amont de Visé. En cas de
réussite à cet endroit, les canots pneumatiques seront aussitôt remis à l'eau
pour traverser ensuite la Meuse. Il s'agira alors de libérer la ville de Visé,
puis descendre la vallée de la Meuse, d'abord jusqu'à Eysden, puis ensuite
jusqu'à Maestricht. Ce que Hobbs craint
par-dessus tout, c'est la prise de cette ville. Pour ce faire, il faudra de
nouveau traverser la Meuse, à hauteur de la ville, mais dans l'autre sens cette
fois, et une espèce de petit canal[34]
s'engouffrant véritablement dans Maestricht. Les Allemands peuvent
opposer une résistance farouche. Retranchés dans le fort Saint-Pierre, près du
petit canal et du fleuve, et à l'abri des remparts qui entourent une partie de
la ville (et qu'un avion de reconnaissance a pu photographier) les soldats
allemands peuvent livrer de terribles combats et occasionner de lourdes pertes
aux GI's. Or la prise de Maestricht est absolument indispensable pour la suite des
opérations aux Pays-Bas et en direction du Rhin. Mission impossible Mardi 12 septembre Le
curé Beck de Wonck écrit dans son journal : « La bataille fait rage autour de
nous depuis l'aube : on entend sans arrêt le "tac à tac" des mitrailleuses
et la voix des canons gronde. Le soir, tout se tait. Cependant de temps à
autre, on tire encore quelques obus. Dans l'après-midi, je parviens à dénicher
une batterie dans la campagne de Wonck, presque à mi-chemin de Sichen, au
lieu-dit "Vieille voie de Maestricht". Quand je suis à 500 mètres,
surgit de l'Ouest un avion de chasse allemand qui cherche à repérer les
emplacements américains. Aussitôt un feu intense de mitrailleuses et de canons
de D. G.A. l'accueille. Je saute de mon vélo et m'accroupis à terre, faute
d'abri. Le feu, venant de tous les points de l'horizon, est hallucinant. Le
boche fait un grand cercle, puis disparait vers le Nord. Je me remets en marche
et suis accueilli à bras ouverts par les Américains dont le capitaine W.J. Wright
de Brouxville (New- York) est l'amabilité même. Il y a là quatre grosses pièces
de 155. Pour le moment, on tire au-delà du Canal Albert, à 14 kilomètres... Au
moment où je veux repartir, l'avion allemand surgit de nouveau, venant du Nord
cette fois. L'infernal tac à tac recommence. Les soldats me font signe de
m'abriter à leurs côtés. L'Allemand pique sur Emael : une rafale de
mitrailleuse l'accueille et il tombe. Bravo ! Je reviens enchanté de ce que
j'ai vu ».[35] Et tandis que le prêtre sillonne les
champs en quête d'émotions fortes, Nicolas Beaurieux reçoit à son domicile une
visite impromptue. Mais laissons-lui le soin de nous la raconter ![36] « Le 12 septembre vers 14 heures 30, Monsieur Goujon, Lieutenant dans
l'armée belge et chef de la F.I. roclengeoise, accompagné de quatre membres de
l'Etat-Major américain en auto, vient me trouver alors que je sortais du bois
toujours à la recherche d'autres fugitifs. « Beaurieux, me dit-il, il y a une
mission très dangereuse à remplir. Une dépêche des forces américaines doit
parvenir immédiatement au bourgmestre de Maestricht. Seulement, c'est très
dangereux et extrêmement difficile, vu que tous les ponts du Canal Albert
n'existent plus. Je vous sais le seul capable d'accomplir cette mission et je
compte sur vous. » « Sans aucune hésitation, j'acceptai
promettant de faire tout mon possible pour réussir. J'ajoutai : "Pour sa
patrie, on risque tout, même sa vie". A ces mots, le chef
américain vint me serrer la main avec effusion, en me remerciant. » Devant l'immense
inquiétude qui se lit dans les yeux de son épouse, Nicolas se ravise quelque
peu. "J'ai une femme et trois
enfants, dit-il. Qu'adviendrait-il d'eux, si je venais à perdre la vie ?"
"Signez ce document !" lui dit un officier en le lui
présentant. "Vous serez ainsi membre
du corps expéditionnaire. Si malheureusement vous êtes tué, votre épouse
touchera une pension comme veuve de guerre. " Tout à fait rassuré sur
l'avenir de sa famille, Nicolas accepte définitivement la mission. L'officier le plus gradé lui remet alors
une enveloppe cachetée, ainsi qu'une médaille spéciale à exhiber s'il est
arrêté en chemin par des soldats américains. On lui recommande vivement de
placer celle-ci dans la petite poche supérieure de son veston et non dans une
poche intérieure car les soldats sont particulièrement méfiants en première
ligne... Après quoi, les officiers américains prennent alors congé, en
adressant un vibrant "Good luck !"[37]
à notre volontaire. Pendant que son épouse
lui prépare quelques tartines pour la route, Nicolas s'apprête pour la grande aventure.
Il se coiffe d'une casquette de la Wehrmacht et endosse la bâche du para
allemand qu'il a abattu en mai 1940. Il attache six grenades et un poignard à
son ceinturon, et met un revolver en poche. Puis, avec d'infinies précautions,
il glisse le message sous la semelle d'une chaussure. Un premier problème
surgit, auquel personne n'avait pensé dans l'émotion générale. Nicolas ne
possède pas de vélo et il y a environ quatorze kilomètres à parcourir, avant
d'atteindre Maestricht par la vallée du Geer. Heureusement, un ami lui
prête sa bicyclette, en lui faisant promettre de la lui restituer si possible
en état. Décidé à risquer le tout pour le tout pour que le fameux pli parvienne
à destination la nuit même, Nicolas embrasse sa femme et ses trois enfants avec
– on le devine – un énorme serrement de cœur car il les quittait peut-être pour
toujours. Appuyant sur les pédales
de toutes les forces de ses jarrets, Nicolas Beaurieux traverse sans encombre
les villages de Bassenge et de Wonck, accompagné durant tout le chemin par les
obus américains qui sifflent au-dessus de sa tête. Il atteint Eben-Emael, puis
se dirige prudemment vers le Canal Albert. A Kanne, il grimpe sur un talus pour
mieux observer les lieux. Comme on le lui a dit avant son départ, le pont gît
effectivement dans l'eau. Il cherche néanmoins une possibilité pour traverser
la célèbre voie d'eau. Il se met à ramper dans l'herbe, lorsqu'il entend
quelqu'un crier derrière lui : "halte
!". Il se retourne et aperçoit des soldats américains braquant leurs
armes sur lui. La même voix répète : "halte
!". Elle ajoute : "retour !".
Ils ne savent pas ces braves militaires qui il est, encore moins qui l'envoie.
Avec son accoutrement bizarre, Beaurieux est plutôt suspect... Nicolas se
dresse avec précaution, sort la fameuse médaille de sa poche et la tend au G.I.
qui le tient en respect. Celui-ci l'examine attentivement puis il la lui remet.
"OK" dit-il, en ajoutant ''prudence ! dangereux !". Ce conseil lui est donné
au moment précis où l'artillerie américaine balaie la route de Kanne. Au bout
d'un quart d'heure de salves, Nicolas se dirige vers le pont pour se rendre
compte s'il existe une réelle possibilité de se glisser dans l'enchevêtrement
des poutres tordues. Il descend le talus au prix de mille difficultés et
soulève la tête pour mieux observer. Une rafale de mitrailleuse l'accueille aussitôt,
lui enlevant toute envie de traverser à cet endroit. Nicolas rebrousse chemin
à grands coups de pédales. Il revient à Emael au beau milieu d'un bombardement,
allemand cette fois. Du trou où il s'est terré, il aperçoit des colonnes amies
qui se dirigent vers Lanaye. L'idée lui vient tout naturellement de les suivre.
Au milieu des campagnes, suite à un arrêt provoqué par un nouveau marmitage
ennemi, un officier l'interroge sur sa présence à cet endroit. Il sort aussitôt
son talisman. "No
problem !" (pas de problème !). Il peut poursuivre son chemin. Le calme revenu, il
enfourche de nouveau son vélo et dévale la forte pente vers la Meuse, la tête
sur le guidon car il a déjà perdu trop de temps. Des balles sifflent à ses
oreilles, venant on ne sait d'où, mais fort heureusement il n'est pas atteint.
Arrivé au pont de Lanaye, qui évidemment gît lui aussi dans l'eau, il voit
l'armée américaine en train de traverser le canal dans des canots pneumatiques,
sous un feu nourri de l'ennemi. Il dissimule le vélo dans les fourrés, puis se
glisse en douce dans les rangs. Il est arrêté par une sentinelle qui lui
demande : "militaire ?". Il
sort de nouveau le précieux "sésame" et il est autorisé à monter à
bord d’une embarcation. Les balles sifflent autour d'eux. Le feu vient de
partout. Il traverse néanmoins sans problème. Se faufilant parmi les soldats,
il gagne la première ligne tout près de l'écluse de Lanaye. Les combats qui s'y
déroulent sont particulièrement rudes. D'après les dires de
notre volontaire "Les hommes tombent
comme des mouches". Il assiste alors à un duel d'artillerie. Cinq
ennemis sont déchiquetés en traversant la route qui conduit à Petit-Lanaye;
cinq autres subissent le même sort peu de temps après. C'est effrayant à voir
mais rien, absolument rien ne le fera reculer... Il est maintenant 19
heures 30. La nuit qui commence à tomber n'arrête pas les combats, toujours
aussi violents. C'est alors que Nicolas sent dans le dos le canon d'une
mitraillette. Il se retourne lentement. Comme le soldat lui paraît particulièrement
jeune et méfiant, il sort prudemment la fameuse médaille de sa poche. Elle ne
produit plus le même effet que celui qu'elle a eu jusqu'à présent. Le soldat
lui fait signe de lever les bras, puis il le conduit ensuite, sans le moindre
ménagement, chez un officier dans le petit fortin belge, construit en 1934 en
même temps que l'écluse, à 9 mètres de distance derrière le bâtiment de
celle-ci.[38]
Outre l'officier, il y a là quelques G.I's particulièrement nerveux. On le
fouille et on découvre ses armes. Nicolas va dès lors subir un interrogatoire
spécialement serré. Un interprète est appelé. Les questions pleuvent
aussitôt. "Qui êtes-vous ?"
"Que faites-vous en cet endroit ?" "Pourquoi êtes-vous armé
?" "Et cette médaille, comment l'avez-vous eue ?" "Vous
êtes un espion allemand ?". Nicolas a beau fournir
des explications et déclarer qu'il est en mission pour les Américains, il n'est
pas pris au sérieux. Comme il affirme qu'il
doit porter un message au bourgmestre de Maestricht, l'officier se met à
ricaner. "A Maestricht !
Comment comptez-vous vous y rendre ?". Nicolas Beaurieux insiste
pour partir car il se fait déjà tard et la route est encore longue, et
vraisemblablement semée d'embûches. "Il n'en est pas question ! Un message, dites-vous ? Montrez-le
nous immédiatement !". Nicolas répugne à le
faire car il ne veut pas abîmer davantage la semelle de son soulier. Pourtant,
il doit bien s'exécuter. Comme le message est rédigé en français – nous le
savons déjà – l'officier se fait immédiatement traduire le texte. Non encore
convaincu, il prend enfin la bonne décision. Il entre en contact par radio, en
morse codé[39]
avec le Q.G. du Major-Général Hobbs à Roclenge-sur-Geer. Hobbs s'étonne que son
messager soit arrivé en première ligne. Il l'avait oublié depuis bien
longtemps, trop occupé par l'offensive qu'il est en train de diriger et de
réussir. Et les nouvelles sont excellentes pour lui. Le village de Lanaye a été
occupé dès 16 heures sous le feu des Allemands retranchés de l'autre côté de la
Meuse à Eysden. Ce même fleuve que ses régiments ont traversé à bord de canots
pneumatiques, à hauteur d'Argenteau en amont de Visé, ville qu'ils ont libérée
en fin de journée. Hobbs confirme néanmoins
la mission dont il a chargé Beaurieux quelques heures plus tôt. Dans le
blockhaus, l'atmosphère se détend aussitôt. Reconnaissant enfin qu'il a affaire
à un ami et non à un espion, l'officier offre à Nicolas des cigarettes et du
chocolat. Mais il lui interdit formellement de poursuivre sa route. "C'est beaucoup trop dangereux. De toute
façon, vous n'avez aucune chance de traverser les lignes ennemies".
Nicolas s'entête, déclare qu'il connaît parfaitement la région. "C'est suicidaire" lui répète
l'Américain. Nicolas s'obstine, plaide sa cause avec véhémence. Finalement,
l'officier doit se rendre à l'évidence : il ne parviendra pas à convaincre
cette tête brûlée qui veut se montrer plus téméraire que ses guerriers de
soldats, quitte même à y laisser la vie. Et puis son supérieur, le
Major-Général Hobbs pourrait lui reprocher d'avoir empêché son messager de
poursuivre sa route. Voulant néanmoins éviter
le pire à cet étranger, il se fait apporter la carte de la région et lui
demande de désigner l'endroit où il compte se faufiler à travers les lignes.
Nicolas pointe un doigt sur la carte. Dubitatif, l'officier fronce les sourcils
et hausse les épaules. Il fait une dernière tentative pour le convaincre que la
mission est impossible. Il prend une feuille de papier, dessine un petit plan
et montre à notre résistant les endroits, où ses soldats ont vu l'ennemi placer
des mines. Beaurieux ne bronchant toujours pas, il lui fait remettre sa bâche,
sa casquette et ses armes, à l'exception bien sûr de la médaille américaine.
Comme Nicolas lui explique qu'il reviendra une fois sa mission accomplie,
l'Américain, qui ne s'étonne plus de rien avec cet étrange personnage, lui
recommande de lever le bras gauche afin qu'on puisse l'identifier. Il lui
communique également le mot de passe : "Jack". D'un commun accord, il
est décidé que la tentative aura lieu au cours de la nuit, entre deux et trois
heures, moment où les soldats harassés de fatigue, suite aux durs combats
qu'ils ont livrés, sombrent en général dans un profond sommeil. C'est en outre
le moment propice à Nicolas Beaurieux, veilleur de nuit à la Compagnie
Electrique de Herstal, habitué à cette heure-là de faire des rondes dans les
divers ateliers de la société. Nicolas s'installe tant
bien que mal dans un coin du fortin, mal éclairé par une petite lanterne, et se
met à manger les tartines que lui a préparées sa bonne Catherine avant son
départ. Les divers événements auxquels il a été confronté durant la journée ont
aiguisé son appétit. Et puis il doit absolument prendre des forces avant d'entamer
la dernière étape, les derniers kilomètres incontestablement les plus durs de
sa mission. Les Américains lui préparent aussitôt du café. Il faut dire qu'une
franche sympathie règne à présent dans cet espace exigu, parmi ces hommes confrontés
aux mêmes dangers, aux mêmes risques. Tous l'appellent amicalement par son
prénom. Nicolas prenant un peu de
repos, il est temps de nous poser la question : "Mais où donc ce diable d'homme va-t-i1 essayer de passer ?".
Une chose est certaine : il ne peut pas traverser la Meuse toute proche. Dans
ce cas, les Américains devraient mettre un canot pneumatique à sa disposition
et risquer la vie de deux ou trois soldats forcés de l'accompagner. La rive
droite du fleuve étant encore à ce moment-là farouchement défendue par les
Allemands, l'entreprise aurait peu de chance d'aboutir. Et puis connaissant les
réticences de l'officier quant à la poursuite de sa mission, Nicolas Beaurieux
aurait incontestablement essuyé un refus catégorique s'il avait eu l'audace de
lui proposer cette solution. Notre volontaire a dû obligatoirement opter pour
Petit-Lanaye, sur la rive droite ou la rive gauche du dernier tronçon du canal
Liège-Maestricht. Il est impossible de nos
jours, même en se rendant sur place, de se faire une idée exacte de l'endroit
où Nicolas est passé, tant les lieux ont été modifiés depuis cette époque,
suite aux divers travaux effectués pour faire "sauter" ce que l'on a
appelé communément le "bouchon de Lanaye". Construction en 1963 d'une
nouvelle écluse à côté de l'ancienne datant de 1934 toujours en activité et
creusement d'un canal de jonction avec la Meuse, 57 mètres à l'Est de l'ancien
tronçon du canal Liège-Maestricht, comblement de ce dernier tronçon en 1964 et
1965,[40]
et enfin construction en cours d'une écluse supplémentaire, plus gigantesque
encore que les autres. Mais ce qui intéresse les
historiens et à fortiori les lecteurs, ce sont les lieux tels qu'ils se
présentaient en septembre 1944 au moment des événements. Décrivons-les et
commençons d'abord par évoquer le fameux canal Liège-Maestricht ! Le gouvernement belge,
désirant une voie d'eau fiable entre le bassin industriel liégeois et les ports
maritimes d'Anvers et de Rotterdam, chargea monsieur Adolphe Dechamps, ministre
belge à la fois des Travaux publics et des Affaires étrangères, d'entamer des
négociations avec les Pays-Bas. Celles-ci ayant abouti, le canal fut creusé à
partir de 1846 parallèlement à la Meuse (fleuve trop capricieux pour permettre
une navigation normale) et à courte distance de celle-ci. Plusieurs écluses furent
nécessaires sur son parcours long de 25 kilomètres : quatre en territoire belge
(à Coronmeuse-Liège, à Haccourt, à Grand-Lanaye et à Petit-Lanaye) et deux à
Maestricht. Aux Pays-Bas, il dut
emprunter l'étroit espace dans la commune de Saint-Pierre, puis percer la
ceinture de défense, sans porter atteinte à son efficacité, se faufiler entre
les ouvrages de fortifications, longer les remparts situés à l'Est et se jeter
enfin dans le Bassin, un arrière-port fluvial situé à l'intérieur des
fortifications. Il fut jalonné par des
chemins de halage pour permettre la traction animale des péniches et bordé par
plus de 7 000 ormes, ce qui fit de ses rives, lorsque son ouverture eut lieu en
octobre 1850, des lieux de promenade fort appréciés tant par les Liégeois, les
citoyens des villages qu'il traversait, que par les habitants de la ville de
Maestricht où il aboutissait. Si sa largeur était de 20
mètres, sa profondeur n'était malheureusement que de 2,10 mètres ne permettant
dès lors que le passage de bateaux de 450 tonnes, avec un tirant d'eau jusqu'à
1,90 mètre. Bien vite
l'industrialisation croissante de la Wallonie et plus particulièrement
l'expansion du bassin liégeois nécessitèrent une voie plus importante. En 1930,
la Belgique décida de réaliser une liaison directe, entièrement en territoire
belge, entre Liège et Anvers. Des travaux gigantesques pour l'époque furent
immédiatement entrepris. En général la nouvelle
voie, dénommée Canal Albert, empruntait jusqu'à Petit-Lanaye le tracé du canal
Liège-Maestricht, puis bifurquait ensuite vers l'Ouest par la tranchée de
Caster dans la montagne Saint-Pierre. Son creusement nécessita des travaux
titanesques, étant donné ses dimensions : 1 300 mètres de longueur, 65 mètres
de profondeur et 50 mètres de largeur au niveau du canal. Une grande écluse dotée
de deux sas fut construite en 1934 à Lanaye, avec une chute de plus de 10
mètres, pour relier le Canal Albert avec la partie restante toujours en
activité du canal Liège-Maestricht.[41]
Les autres écluses
disparurent, dont notamment celle de Petit-Lanaye qui fut remplacée par une
passerelle pour permettre aux habitants de cette localité[42]
d'avoir encore accès à la rive droite de l'ancien canal et notamment aux biens
communaux, où ils pouvaient faire paître leur bétail en toute tranquillité. Les heures passent
lentement dans la petite casemate derrière l'écluse de Lanaye. Nicolas
Beaurieux ne trouve évidemment pas le sommeil. Comment le pourrait-il alors
qu'il va tenter l'impossible ? Songe-t-il à ce moment-là à ses trois filles et
à son épouse qu'il a laissées à Roclenge neuf heures plus tôt ? Sans doute !
Mais il les chasse vite de ses pensées, car il ne veut pas s'attendrir, se
laisser gagner par les sentiments. Il doit au contraire faire preuve à la fois
de calme, de jugeote et de sang-froid s'il veut réussir sa mission. Pour
s'occuper l'esprit, il s'efforce au contraire de se remémorer les lieux par
lesquels il a décidé de passer. Comment se présentaient
ceux-ci ? Fort heureusement, j'ai retrouvé dans mes archives deux cartes
militaires : l'une belge datant de 1939, l'autre américaine datant de 1943.
Toutes deux montrent clairement, à partir de l'écluse de Lanaye, deux chemins
parallèles au canal Lièqe-Maestricht.[43]
Comme nous le savons déjà, le chemin de halage sur la rive droite a de nos
jours entièrement disparu. Le chemin sur l'autre rive n'a apparemment subi que
peu de modifications si ce n'est en territoire néerlandais. Longeant sur sa
gauche, les pentes abruptes de la montagne Saint-Pierre, il aboutit à Petit-Lanaye
1 kilomètre 400 plus loin, puis se poursuit de plus en plus étroit jusqu'à
Maestricht. L'officier américain ayant clairement expliqué à notre volontaire
que les Allemands l'ont miné au cours de la journée, s'y faufiler constituerait
pour Nicolas un énorme risque, car il serait en outre rapidement repéré par
l'ennemi... C'est pourquoi il a fait le choix d'emprunter la rive droite.
Celle-ci n'en est pas moins dangereuse car elle aussi est minée d'après le
petit dessin réalisé par le gradé américain. Le choix de Nicolas étant
arrêté depuis le début, décrivons maintenant les lieux, tels qu'ils existaient
sur la rive droite en septembre 1944 ! Il y a tout d'abord un couloir fort
étroit à partir de l'écluse : 100 mètres maximum de largeur entre l'ancien
canal et la Meuse, chemin de halage compris. Puis le fleuve entame une
importante courbe vers l'Est. Le passage atteint alors 550 mètres de large,
puis 400 mètres à hauteur de la passerelle de Petit-Lanaye. A la fin de la
courbe, le passage se réduit brusquement. Sur une longueur de près de 500
mètres, il atteint 50 mètres au maximum, chemin toujours inclus. Un premier
pont, pivotant sur un pilier grâce à une crémaillère, enjambe le canal en
territoire néerlandais, pont situé à 1 kilomètre de la passerelle de
Petit-Lanaye. Deux autres ponts du même modèle, distants respectivement de 1
300 mètres et de 700 mètres, relient encore les deux rives. Nicolas n'aura que
l'embarras du choix pour passer de l'autre côté du canal si toutefois il est
encore en vie ... Bien avant l'heure fixée
Nicolas commence à se préparer, l'attente lui étant devenue insupportable. Et
puis il y a au moins six bons kilomètres à parcourir avant d'atteindre le
centre de la ville, Dieu sait d'ailleurs dans quelles conditions... De plus, il
ignore totalement l'adresse du bourgmestre auquel il doit remettre la fameuse
lettre. Il se noircit le visage
avec du bouchon brûlé pour passer inaperçu dans l'obscurité, aidé dans cette
tâche par le G.I. de faction dans le petit abri en béton. Il endosse la bâche
allemande et se coiffe de la casquette de la Wehrmacht. L'officier qui s'est
réveillé entre-temps consulte sa montre. Il s'étonne de ces préparatifs et
interroge Beaurieux du regard. "Oui
je m'en vais" lui confirme ce dernier. Alors l'officier s'adresse au
soldat et lui fait des recommandations. Il serre la main de Nicolas et lui
répète plusieurs fois le mot de passe : "Jack ! Jack ! Jack !"
afin qu'il ne l'oublie pas. Le G.I. a été chargé
d'accompagner Nicolas sur une certaine distance. Beaurieux s'en rend
immédiatement compte car il sort en même temps que lui. Les deux hommes traversent
dans le plus grand silence la route de l'écluse. Les voilà sur la rive droite !
Ils progressent alors courbés et à pas feutrés au milieu des fusiliers qui
dorment dans leur trou individuel, le "Ricain" répétant sans arrêt et
à voix basse le fameux mot de passe afin de ne pas les effrayer. Puis l'ange
gardien s'accroupit et montre d'un geste la direction que Nicolas doit suivre.
Il lui fait comprendre également, qu'à partir de cet instant, il doit ramper. A
son tour, il lui rappelle le fameux "Jack" et lui serre la main.
"Good luck !" (Bonne chance
!). Nicolas se met aussitôt à
progresser comme un reptile vers le point indiqué. A cinq mètres de
l'avant-poste, il chuchote le mot de passe. La sentinelle se retourne et lui
fait signe de la main d'avancer jusqu'à sa hauteur. Le soldat est dans un trou,
son fusil-mitrailleur placé devant lui. Il se met debout, scrute longuement
l'avant, puis il tape sur l'épaule du Roclengeois. C'est le signal !.. Nicolas se remet à
ramper. Devant lui, à 100 ou 200 mètres peut-être il y a les Allemands. Mais il
s'est porté volontaire. Il faut y aller. Il y a aussi des mines. Mais il est
préférable de ne pas y penser. Ce n'est pas le moment de défaillir, lui qui n'a
jamais eu peur de rien. Aussi avance-t-il courageusement, héroïquement suis-je
tenté d'écrire, vers son destin. Fort heureusement l'obscurité est totale. S'il
ne fait pas de bruit, il a peut-être des chances de passer inaperçu. Aussi
s'applique-t-il à avancer comme un serpent : en silence et à plat ventre. Au bout de plusieurs
minutes de cet exercice particulièrement éreintant, il distingue une forme
étrange s'étendant sur toute la largeur du passage. Il s'en approche prudemment.
C'est un réseau de barbelés. Nicolas peste car on ne le lui a pas signalé. Sans
doute le gradé a-t-il espéré qu'il allait ainsi rebrousser chemin ? Voilà donc
la raison pour laquelle il a tellement insisté sur le mot de passe... Mais
c'est méconnaître Beaurieux, têtu comme une mule. La question se pose néanmoins
: comment faire pour franchir cet obstacle inattendu ? Car il n'a pas de pince
sur lui. Il rampe en direction de la rive. Les Allemands se sont montrés méticuleux
car les barbelés s'étendent jusqu'au bord du canal. Heureusement à 41 ans
Nicolas est en pleine forme physique et jouit d'une souplesse peu commune. Il
se suspend aux pieux au-dessus de l'eau et réussit à franchir l'obstacle.
Nouveau réseau de barbelés cinq mètres plus loin et utilisation de la même
technique pour l'aborder. Hélas ! alors qu'il prend pied de l'autre côté, un
piquet se casse subitement entre ses mains et manque de le précipiter dans le
canal, ce qui aurait vraisemblablement signifié la fin de la mission. Une
rafale de fusil-mitrailleur ou de mitrailleuse déchire l'air aussitôt. Nicolas
plonge dans la boue et s'attend à ce que l'ennemi lance des fusées éclairantes.
Mais rien de tel ne se produit. Par prudence il reste un long moment allongé
sur le sol. Les Américains le croient tué. Mais il n'est pas mort, ni blessé,
ni découragé. Il reprend sa progression, cette fois en diagonale pour passer
vers le centre de l'étroit couloir. Au bout de plusieurs minutes, il distingue
tout à coup une forme devant lui. Est-ce un ennemi ? Il fait un petit crochet
par prudence et s'avance résolument par l'arrière vers la forme. C'est
effectivement un guetteur allemand dans son trou. Il fond sur lui comme
l'éclair. L'homme est totalement surpris. Afin de l'épargner, Beaurieux lui
baragouine dans sa langue : "Va te
rendre ! Les Américains sont à 150 mètres d'ici ..." Pris de panique, le
soldat fait un geste vers son arme. Nicolas lui plante alors son poignard dans
la poitrine. Il le tire hors de son trou et, tout en rampant, il l'entraîne à
sa suite en direction du canal. Lors de la relève, il ne faut pas qu'on le
trouve gisant derrière son fusil-mitrailleur. L'alarme serait donnée aussitôt.
Des fusées éclairantes seraient tirées et Beaurieux découvert serait
irrémédiablement abattu. Il faut, au contraire, qu'on s'imagine que le guetteur
a déserté son poste ... Arrivé au bord, Nicolas
laisse glisser par les pieds sa victime dans l'eau froide. Après un temps
d'arrêt, à la fois pour récupérer et se remettre de ses émotions, car c'est la
première fois qu'il tue de sang-froid un ennemi avec un couteau,[44]
il reprend son rampement en avant, se faufilant entre plusieurs ennemis
endormis et notamment des servants d'une pièce antichars. Dans le noir absolu, il
distingue néanmoins la passerelle de Petit-Lanaye en face de la chapelle où les
paroissiens ont l'habitude d'assister à la messe. Il a un moment la tentation
de l'emprunter mais il se ravise aussitôt car il n'a pas encore parcouru
suffisamment de chemin. Sur l'autre rive, il ne serait plus question de ramper.
Alors comment expliquerait-il sa présence à cette heure et à cet endroit, et la
tenue insolite qu'il porte sur lui ? Bon gré mal gré, il
recommence sa progression sur la rive droite, toujours au milieu des Allemands.
Il y en a partout, devant et derrière lui. Alors il se produit quelque chose
d'inattendu chez cet homme aux nerfs d'acier. Sans doute pour la première fois
de sa vie, il s'affole un moment. Il lève les yeux au ciel et se met à prier
... "J'adresse au ciel une ultime prière,
racontera-t-il plus tard, et je me souviens à ce moment que j'ai en poche un
brassard allemand,[45]
en ma possession parce que je travaille à la Compagnie Electrique de Herstal
comme veilleur de nuit". Ce brassard le rassure aussitôt, étant donné
qu'il est rédigé dans les deux langues "ÜBERWACHUNGSDIENST - SERVICE DE
SURVEILLANCE". Il le passe immédiatement au bras et se débarrasse de sa
casquette, de sa toile de tente, de ses grenades et de son poignard. Il
conserve néanmoins son revolver en prévision d'un éventuel coup dur. Puis il se
lève et emprunte résolument le chemin de halage, plus décidé que jamais à
accomplir sa mission. Il marche à grandes
enjambées en s'efforçant de ne pas faire le moindre bruit. De temps en temps il
s'arrête derrière un orme, tendant l'oreille et observant les environs.
Connaissant parfaitement la région il sait qu'à présent il est nettement en
territoire néerlandais. Comme l'espace entre la Meuse et le canal
Liège-Maestricht se rétrécit encore, il traverse ce dernier sur un pont pivotant.
Le voilà désormais sur la rive gauche. Il fait une première rencontre. Ce sont
des gendarmes auprès desquels il n'a évidemment garde de se renseigner ...
Ceux-ci d'ailleurs ne lui prêtent pas la moindre attention, ce qui constitue un
véritable miracle. Il est vrai que son assurance, sa démarche martiale et
par-dessus tout son brassard allemand ne suscitent aucune défiance quant à ses
intentions. La chance a été de son
côté jusqu'à présent. Elle va lui sourire davantage encore par la suite. Passant
à proximité d'une péniche amarrée à une bitte, il entend subitement un bruit
provenant du bateau. Comme il s'en approche, une tête apparaît à une ouverture.
En étouffant sa voix, Beaurieux interroge le batelier: "Pourriez-vous, monsieur, m'indiquer le
domicile du bourgmestre de Maestricht ?" "Très volontiers ! Il habite
Lenculenstraat." "Comment dites-vous ?" Alors l'homme
articule lentement LEN CULEN STRAAT. Nicolas n'a jamais entendu ce nom.
"Où se situe cette rue ? " "Connaissez-vous la Place d'Armes ?"[46]
"Oui !" "Eh bien ! la Lenculenstraat se trouve à environ 150 mètres, peutêtre même 170
mètres de la Place, mais de ce côté. " "Vous ne connaissez pas le
numéro de la maison à tout hasard ?" "Non ! Mais vous trouverez
aisément. La rue est en légère pente. Si vous la remontez, la maison se situe à
gauche. C'est un grand bâtiment. " a deux étages et une porte de garage.
C'est une orfèvrerie. Vous verrez, il y a de très belles pièces exposées aux
vitrines. Vous ne pouvez pas vous tromper. " Nicolas le remercie
chaleureusement et le quitte promptement car il a hâte d'être au terme de sa
mission. A l'entrée de la ville,
il doit franchir un poste allemand. Sans se décontenancer, il a le toupet de
faire le salut hitlérien en s'en approchant. Les sentinelles lui répondent par
des gestes suffisamment éloquents quant à leur lassitude et leur découragement.
Elles le laissent passer sans la moindre difficulté. La chance, toujours la
chance l'accompagne, mais il faut bien admettre qu'il a l'art de la provoquer. Il pénètre dans la ville
endormie vers 3 heures 45 du matin et se dirige vers la Place d'Armes qu'il
doit prendre comme point de repère pour dénicher la fameuse adresse du
bourgmestre. Sur celle-ci, il doit enjamber plusieurs tankistes. Harassés de
fatigue, les hommes dorment à côté de leurs blindés. Il trouve facilement la
Lenculenstraat et la remonte, suivant en tous points les conseils de son
précieux informateur. Il s'arrête devant le n° 29. Il est enfin arrivé à
destination car le bâtiment correspond parfaitement à la description que lui a
faite le batelier. C'est une maison cossue avec deux étages et cinq fenêtres à
chaque étage. Au rez-de-chaussée, outre la porte d'entrée, il y a effectivement
une porte de garage et trois vitrines exposant des œuvres d'art. Mais Nicolas
Beaurieux n'a garde de les admirer. Il sonne vigoureusement à la porte
d'entrée. Réveillé en sursaut,
Edmond Kersten consulte son réveil. Il est près de 4 heures. Qu'est-ce que cela
peut être ? Edmond Kersten, né en 1880 est un notable de la ville. Son commerce
d'orfèvrerie est florissant malgré la guerre. Il occupe plusieurs ouvriers qui,
installés dans un petit atelier situé derrière la maison, produisent de véritables
œuvres d'art en or, argent, cuivre et même en fer qu'il vend à de riches
particuliers, ainsi que des calices, ciboires, ostensoirs et autres objets de
culte pour les églises. Il était également Premier Echevin de Maestricht, mais
il a perdu son mandat à cause des Allemands qui ne voulaient plus de l'équipe
municipale. Ils ont démis le bourgmestre de ses fonctions et tous les échevins
ont démissionné en 1942 par solidarité. Nicolas s'impatiente. Les
coups de sonnette redoublent et réveillent cette fois madame Kersten, née
Jeanne Leroy, fille d'un marchand de bois verviétois. "Que se passe-t-il Edmond ?" "Je ne
sais pas, mais c'est bizarre à cette heure." L'orfèvre se lève, écarte
le rideau et regarde par la fenêtre. En bas, un inconnu se trouve devant
l'entrée et s'acharne sur la sonnette. Edmond Kersten ouvre la fenêtre et la
conversation s'engage aussitôt. "Que
désirez-vous ?" "Excusez ma présence à pareille heure, mais il est
urgent que je parle au bourgmestre ! Ce ne serait pas vous par hasard ?"
"Oui et non ! Que voulez-vous au bourgmestre ?" Nicolas baisse la
voix. "Je dois lui remettre un message de l'armée américaine. "
''Attendez ! Je descends. " Craintive, Jeanne Leroy interroge son
mari: "Que veut-il ?" "Il affirme qu'il apporte un message des
Américains ..." "Quoi ? Méfie-toi
Edmond, je t'en prie ! C'est peut-être un piège. " Jeanne ne se
souvient que trop bien de l'angoisse qui l'avait étreinte, ainsi que ses neuf
enfants, lorsque son mari avait été arrêté comme otage en 1943 en même temps
que des centaines d'autres notables néerlandais, dont plusieurs avaient été
fusillés. Heureusement étant donné son âge, Edmond Kersten avait été libéré
après quinze jours d'emprisonnement. Par la porte entrebâillée
Nicolas rassure le commerçant du mieux qu'il peut. Enfin, après quelques
hésitations bien compréhensibles, celui-ci ouvre la porte et l'introduit dans
la maison. L'homme s'éclipse aussitôt et va rejoindre son épouse dans une autre
pièce. Toute tremblante, elle l'interroge : "Comment est-il Edmond ?" "Je ne l'ai jamais vu auparavant.
C'est un grand gaillard qui s'exprime en français. Il est calme, très calme
..." Calme, certes Beaurieux l'est. Il lui a fallu d'ailleurs une
maîtrise de soi peu commune pour accomplir son trajet. Mais il commence à
s'impatienter sérieusement suite à l'absence qui se prolonge. Méfiant, il
glisse la main droite dans sa poche et saisit son revolver, prêt à toute
éventualité. Le notable réapparaît. "Je
suis Edmond Kersten", dit-il. "Je suis le Premier Echevin. Vous avez de la chance de m'avoir rencontré,
plutôt que le bourgmestre. Il est pro allemand. C'est un collaborateur ... Fort
heureusement pour vous, il est en fuite. " Nicolas ne peut s'empêcher
de penser au brave batelier qui l'a si bien renseigné. Sans lui, c'était
l'arrestation et la mort à coup sûr. La confiance étant établie, Nicolas lui
remet la précieuse enveloppe. Au fur et à mesure qu'il prend connaissance du
message, les traits d'Edmond Kersten se crispent. Son visage pâlit, ses mains
se mettent à trembler. Un moment, il s'arrête et consulte sa montre, puis il
reprend la lecture, plus angoissé que jamais. Il est vrai que la missive est
particulièrement alarmante, chargée de graves menaces pour la ville de
Maestricht. Edmond Kersten a
maintenant tout lu. Il regarde dans le vide, sans dire mot, tout accaparé par
le message du Major-Général Hobbs. Après quelques instants, Nicolas Beaurieux
le tire de sa torpeur. "Avez-vous
une réponse à me confier ?" Comme dans un mauvais rêve, l'échevin lui
répond machinalement: "Non ! Mais le
nécessaire sera fait." "Pouvez-vous accuser réception du message ?"
"Pourquoi désirez-vous cela ?" "Je veux à mon retour prouver que
ma mission a été remplie." "Mais vous n'allez tout de même pas partir
et traverser les lignes une nouvelles fois ?" "Si ! J'ai hâte de
revoir les miens. Il me semble que plusieurs jours se sont écoulés depuis notre
séparation." Kersten se rend compte qu'il ne parviendra pas à
convaincre cet homme particulièrement courageux. Lui ayant demandé de décliner
son identité, il saisit un papier et écrit ces phrases devenues, depuis lors,
historiques. «Recu
de Monsieur Beaurieux Il y appose un cachet et le remet à
notre héros en lui serrant la main. "Cet
acte courageux ne doit pas s'oublier" déclare-t-il. Nicolas s'efforce
aussitôt de le glisser sous la semelle de son soulier, mais il n'y parvient
pas, celle-ci étant fort abîmée. "Vous
n'avez pas une pince et un petit marteau ?" "Les outils ne manquent
pas ici. Je vais vous en chercher. Mais désirez-vous au préalable boire une
bonne tasse de café ?" "Bien volontiers ! Et si possible je voudrais
un peu manger, car j'ai dépensé beaucoup d'énergie en rampant si longtemps
..." Edmond Kersten appelle son épouse pour
qu'elle réveille Geertruida Loyens, leur petite servante âgée de 14 ans qu'ils
appellent familièrement "Truus''.[48]
L'adolescente se lève à son tour. Elle s'étonne de voir ses patrons si matinaux,
livides, particulièrement anxieux en compagnie d'un étranger à la figure bien
sale. Elle se rend immédiatement compte que quelque chose d'anormal se passe.
Mais évidemment elle n'ose pas poser la moindre question. Sa fonction le lui
interdit. Monsieur et Madame Kersten sont des gens tellement respectables. Elle
s'éclipse dans la cuisine pour préparer, à la demande de sa maîtresse, du café
et de quoi manger pour cet inconnu en grande conversation avec son patron. Bien des années plus tard Geertruida
racontera à sa fille, Marie-Thérèse Lejeune qui par le plus grand des hasards
faisait à ce moment-là partie de mon personnel à la cimenterie de Haccourt, le
climat d'extrême panique qui régna tout au long de la matinée de ce mémorable
13 septembre 1944, au sein de la famille Kersten d'habitude si joviale. Après s'être bien restauré et avoir
réparé son soulier, Nicolas Beaurieux tout à fait requinqué prend congé du
vieux couple maestrichtois, le laissant seul avec son terrible secret, son
épineux problème. Il est 4 heures 40 du matin. Une grande activité règne maintenant
dans la ville. Les tankistes font tourner les moteurs de leurs chars. Des
ordres sont criés. Des Feldgendarmen sillonnent les rues à moto. Fort occupés,
les hommes ne lui prêtent aucune attention. Le brassard salvateur toujours fixé
au bras, il parvient à se faufiler assez facilement hors de la ville et se
dirige par la commune de Saint-Pierre vers Petit-Lanaye. Il n'est pas question
de traverser un pont pivotant et d'emprunter à nouveau la rive droite. Elle est
beaucoup trop dangereuse... Et puis comme il vient de Maestricht, sa présence
sur la route paraîtra beaucoup moins suspecte qu'à l'aller. Près des premières maisons de
Petit-Lanaye, un groupe d'habitants font la queue, une écuelle à la main. Deux
soldats allemands dépècent avec leur baïonnette une vache tuée
vraisemblablement au cours des combats de la veille. Nicolas repère un petit
vieux qui a une assiette dans chaque main. Il se place juste derrière et lui en
arrache une subitement. L'homme se retourne et commence à l'accabler des pires
injures. Nicolas lui fait signe de se taire et pour l'en convaincre, il soulève
légèrement son veston et lui montre son revolver. L'effet est immédiat : le
vieil homme se met à trembler de tout son corps.[49]
A son tour, Nicolas a droit à un bon morceau de viande. Mais tout cela bien sûr
n'est qu'un prétexte pour gagner un peu de terrain ... Son écuelle à la main, notre héros
marche au pas cadencé pour couvrir le plus possible de chemin. Il atteint la
chapelle en face de la passerelle et se dirige résolument vers l'écluse aux
mains des Américains. C'est alors que les combats reprennent subitement avec
une grande violence. Les obus des mortiers commencent à pleuvoir. Les GI's
mettent véritablement le paquet. Ils balaient la route et les alentours devant
leurs troupes. Nicolas bondit dans une maison et se précipite dans la cave.
Celle-ci est remplie de femmes et d'enfants. A sa vue, ils se mettent à hurler
de frayeur. Nicolas tâche de les calmer et pour leur prouver qu'ils n'ont rien
à craindre, il leur dit qu'il est armé et leur montre son revolver. Comme les
cris redoublent aussitôt, il se résigne à quitter les lieux. Dehors, les
combats sont toujours aussi acharnés. Il distingue très nettement la ligne
américaine. Elle est malheureusement encore assez éloignée pour qu'il risque sa
vie au milieu des explosions. Ce serait vraiment trop bête d'être touché par un
projectile allié... Il tambourine des deux poings sur la porte d'une autre maison.
Enfin celle-ci s'ouvre. Avec le propriétaire, il va se mettre rapidement à
l'abri dans la cave, bien décidé à attendre une accalmie avant de faire une
tentative pour rejoindre la ligne amie. Que
s'est-il passé entre-temps chez les Kersten à Maestricht ? Après le départ de Nicolas Beaurieux, la
plus grande confusion règne Lenculenstraat. Edmond a montré la lettre à son
épouse qui a failli s'évanouir en prenant connaissance du texte. "Que vas-tu faire Edmond ? Tu ne peux tout de
même pas prendre contact avec les Allemands. Ils vont te demander dans quelles
circonstances tu as reçu ce pli et te reprocher de ne pas leur avoir livré le
messager. Tu risques cette fois d'être fusillé ..." Le sexagénaire
garde le silence. "Pense à nos neuf
enfants, je t'en supplie ! Ils ont encore tellement besoin de toi. Dans
quelques jours, nous serons libérés." "Oui ! Sur un tas de ruines,
avec de nombreuses victimes. Et tout cela de ma faute, si je n'interviens pas.
Tu as vu l'heure? Dans peu de temps, la foudre va s'abattre sur la ville.
" Mais Jeanne ne se laisse pas convaincre. Elle n'abandonne pas.
"Crois-tu que les autres, à ta
place, se sacrifieraient ? Demande-leur et tu seras vite fixé !" Les
autres ! Sa fidèle épouse a raison. Il ne peut pas garder ce lourd secret pour
lui tout seul. Sortant de sa léthargie, Edmond Kersten saisit le téléphone et
forme le numéro de l'ancien bourgmestre. Après quelques instants, la conversation
s'engage "Kersten à l'appareil. Il
faudrait que vous veniez chez moi de toute urgence." "Quoi ? A cette
heure Edmond ?" "Oui ! C'est très important et surtout ne me posez
pas la moindre question !" L'ex-bourgmestre comprend que celui qui fut son
fidèle collaborateur, en tant que Premier Echevin, a vraisemblablement une
bonne raison pour l'appeler au milieu de la nuit."D'accord! J'arrive
..." Kersten téléphone également aux anciens échevins et au commissaire
de police. Bravant le couvre-feu, ils arrivent les uns après les autres. Ils
sont introduits aussitôt dans le bureau du notable. Ils posent tous la même
question à Jeanne Leroy : "Que se
passe-t-il ?" "Vous verrez bien" se contente-t-elle de
répondre, d'une voix blanche. La réunion de crise commence. Edmond
Kersten lit la lettre à haute voix provoquant aussitôt, en même temps que la
stupeur, toute une série de questions. "La lettre est-elle authentique ?" "Comment lui est-elle
parvenue ?" "Le courrier était-il digne de confiance ?"
"D'où venait-il ?" "De Roclenge-sur-Geer ? Où est-ce ?"
"Il a traversé les lignes ? Mais c'était suicidaire ..." Un moment la porte s'ouvre. Edmond
appelle la petite Truus pour qu'elle apporte du café à tous les invités. La
servante a déjà préparé le petit déjeuner pour la famille. Toute tremblante,
elle toque à la porte l'instant d'après et pénètre dans le bureau avec un grand
plateau. Malgré son jeune âge, elle est frappée par l'air grave et anxieux
qu'affichent tous ces grands messieurs. Décidément, il se passe quelque chose
d'important. Son service accompli, elle retourne à la cuisine et se remet au
travail. Dans le bureau, après de longs et
passionnés débats, tous finalement doivent se rendre à l'évidence : la ville de
Maestricht, leur belle cité qui n'a reçu aucun obus du fort d'Eben-Emael
pourtant si proche, le 10 mai 1940 alors que les Allemands piétinaient devant
les ponts détruits, va être écrasée sous un déluge de mitrailles et de feu, et
cela dans un peu plus d'une heure. Que faire pour l'éviter ? Puisque personne
évidemment ne se porte volontaire pour remettre le pli aux Allemands[50]
? Aucun ne veut risquer sa vie, alors que la délivrance est pour bientôt et
qu'on entend sans arrêt le bruit des déflagrations depuis plusieurs jours. Ils
partent les uns après les autres, navrés, apeurés, paniqués, impuissants et
impatients de rejoindre leurs familles respectives pour les mettre à l'abri. Réveillés par ce va-et-vient, les
enfants Kersten se lèvent à leur tour et interrogent leur maman qui, chose
bizarre, ne leur donne pas la moindre réponse et leur interdit formellement
l'accès du bureau où le commissaire de police s'est quelque peu attardé. Il
s'en va lui aussi, particulièrement penaud. Passant devant Madame Kersten, il lui
dit comme pour s'excuser : "Mes
enfants sont encore bien jeunes. Vous comprenez ..." Jeanne comprend,
bien évidemment. Clémence, la fille aînée, a rejoint sa petite amie dans la
cuisine. "Que se passe-t-il Truus
?" "Je ne sais pas. Je suis debout depuis 4 heures 10 du matin. Il
règne depuis lors une curieuse ambiance dans la maison. " Dans la cave
de Petit-Lanaye, il règne une tout autre atmosphère. Au fur et à mesure que le
temps s'écoule, Nicolas Beaurieux devient de plus en plus nerveux. Il tourne
véritablement en rond comme un lion en cage, devant ses hôtes à la fois médusés
et, il est vrai, un peu inquiets quant au brassard allemand qu'arbore leur
inattendu "invité". Nicolas a remarqué leur trouble. "N'ayez crainte, je suis résistant, membre du
Front de l'Indépendance! Je viens de Maestricht où j'ai porté cette nuit un pli
de l'armée américaine. Il y a quelques heures, je passais en face de votre
maison, sur l'autre rive en rampant au milieu des Allemands. Il y en avait même
qui ronflaient." Le couple se demande sérieusement s'il n'a pas
affaire à un fou furieux, d'autant plus qu'il manipule de temps en temps son
arme comme s'il s'agissait d'un simple jouet et qu'il parle de rejoindre dès
que possible les Américains... Fou furieux, Nicolas ne l'est certes pas. Mais
il s'impatiente car il voudrait tellement serrer dans ses bras sa femme et ses
trois filles qui sont certainement mortes d'inquiétude. En outre, voilà plus de
vingt-quatre heures qu'il n'a plus pris le moindre repos et qu'il a subi une
tension épouvantable depuis son départ de Roclenge et plus particulièrement au
cours de ces dernières heures. "Et ces foutus Américains qui décident de
déclencher un tir de barrage alors qu'il allait toucher au but ! .. Qu'une
accalmie se présente et c'est juré il tentera sa chance !" Mari et femme
s'efforcent de l'en dissuader. "La cave est solide, disent-ils. Il serait
plus sage d'attendre calmement, en notre compagnie, l'arrivée des libérateurs.
Celle-ci d'ailleurs ne va plus tarder, à en juger par la cadence des tirs.
" Mais Nicolas ne veut rien entendre. Il
se montre de plus en plus excédé ... Tout à coup, les explosions cessent, aussi
brusquement qu'elles avaient débuté. Nicolas se précipite à l'extérieur.
Profitant eux aussi de cette accalmie, une trentaine de soldats ennemis fuient
vers le bois de Caster par les deux sentiers qui se trouvent à environ cent
mètres de la chapelle. Complètement démoralisés, ils se débarrassent de leurs
armes. A la vue de cette débandade, Nicolas décide de "risquer le
paquet", comme il le déclarera en 1946. Première difficulté et non des moindres :
il lui faut parcourir un terrain de plusieurs centaines de mètres à découvert.
Mais rien ne l'arrête. Il court, se couche, se relève promptement, enjambe des
cadavres allemands qui jonchent la route. Il repart de plus belle, rampe un
moment, court de nouveau, puis il franchit un premier réseau de barbelés, en
sautant "vif comme un écureuil[51]."
Comme il est repéré, les balles sifflent aussitôt autour de lui. Il parvient
néanmoins indemne à un petit talus où il se couche un moment pour reprendre
haleine. Il n'est plus qu'à 250 mètres du salut. Risquant le tout pour le tout,
il se lève et court en zigzaguant sur le chemin et en donnant le maximum. Tout
en courant, il lève de temps en temps le bras gauche. C'est le signe convenu
avec les Américains, avant son départ, pour qu'ils puissent le reconnaître et
pour qu'ils ne le prennent pas, eux aussi, pour cible. Ils le reconnaissent
effectivement car ils dirigent aussitôt tout leur feu sur les hauteurs de
Caster, d'où partent les tirs qui sont destinés à notre risque-tout. D'un bond, Nicolas franchit le dernier
réseau de barbelés. Il se rapproche de plus en plus de la ligne amie. Déjà,
quelques soldats se sont levés dans leur trou et lui font des grands signes
pour l'encourager. Les balles sifflent toujours à ses oreilles. C'est vraiment
une course contre la mort... Fort heureusement, il n'est atteint par aucun
projectile. Il arrive complètement essoufflé au milieu des Américains et il est
accueilli à bras ouverts. Ils lui serrent la main, le félicitent, lui donnent
des cigarettes et du chocolat. Hélas ! l'un d'eux a été touché en venant à sa
rencontre. Il est emmené rapidement vers le poste de secours. Nicolas Beaurieux est conduit
triomphalement chez l'officier qui la veille a tout fait pour l'empêcher
d'accomplir son devoir. Véritablement stupéfait, suite à l'exploit réalisé par
ce diable d'homme qui par deux fois a traversé les lignes ennemies, le gradé
reste un moment bouche bée sans pouvoir prononcer le moindre mot. Puis il le
prend dans ses bras et le félicite chaleureusement, en le proclamant "un
brave et un homme de confiance", ce qui – on s'en doute – procure un
énorme plaisir à notre Roclengeois. Comme Nicolas Beaurieux lui déclare
qu'il possède une attestation prouvant que le message est bien arrivé à
destination, l'officier demande à la consulter immédiatement. Nicolas arrache
une nouvelle fois la semelle de sa chaussure, puis il exhibe fièrement le
précieux document. L'interprète en traduit rapidement le contenu, ce qui permet
au gradé de prendre aussitôt contact par radio avec le Q.G. de la 30ème
Division d'Infanterie à Roclenge-sur-Geer. A la fois étonné et ravi de la
réussite de la mission, le Major-Général Hobbs prend évidemment la décision qui
s'impose. Il ordonne la suspension immédiate de la grande opération, projetée
pour déloger les Allemands de Maestricht, en attendant toutefois la suite des
événements. Il est un peu plus de 7 heures du matin. La ville est momentanément
sauvée. Or précisément les événements vont
connaître un dénouement pour le moins inattendu à Maestricht. Après l'échec de
la dernière chance à son domicile, pétrifié par la peur, mordillant ses lèvres
devant son impuissance, n'osant même pas se confier aux aînés de ses enfants,
le bourgmestre f.f. Kersten voit le temps s'écouler inexorablement et les
aiguilles de sa montre se rapprocher de l'heure fatidique. Dans un sursaut de
lucidité, il prend une décision qui va se révéler capitale. Afin d'alerter ses
administrés de la terrible menace qui plane sur eux et sur la cité, il fait
sonner sans arrêt toutes les cloches des églises et mugir toutes les sirènes. Rosalina Rousch, née à Maestricht le 28
mars 1931, habite avec ses parents, ses deux frères et ses deux sœurs dans une
des premières maisons de cette ville. Aux environs de 7 heures ce 13 septembre
1944, un bruit infernal la tire de son sommeil. Elle se lève aussitôt avec ses
deux frères et rejoint ses parents déjà sur le chemin. Tous les habitants sont
sortis. Les gens se demandent ce qui se passe car toutes les cloches de la ville
sonnent et toutes les sirènes hurlent sans arrêt. Alors que ce beau vacarme
dure depuis un certain temps, des soldats allemands apparaissent. Ils viennent
de Vroenhoven et se dirigent précipitamment vers le centre de Maestricht. Par
prudence les parents Rousch font rentrer immédiatement Rosalina[52]
et ses frères. Des soldats ennemis arrivent encore. Ils viennent cette fois de
Kanne. Ils sont plus nombreux encore que les
premiers et marchent d'un pas rapide sur plusieurs files. Le père Rousch a
compris. "Ils foutent le camp" dit-il. Alors que les sirènes
rugissent toujours aussi bruyamment et que les cloches résonnent encore, un
autre bruit brusquement se fait entendre. Quelques avions alliés apparaissent
dans le ciel et mitraillent les Allemands. Un cheval, tirant une charrette
remplie d'équipement, est tué. Les soldats en réquisitionnent tout de suite un
autre, mais permettent aux habitants de dépecer l'animal gisant sur le sol.
André Rousch et un fils en profitent et emportent de bons morceaux, car la
viande est particulièrement rare à cette époque. L'initiative prise par Edmond Kersten
produit un résultat inattendu, incroyable, inespéré. S'imaginant que la ville
entière se soulève, comme Paris s'est soulevée trois semaines plus tôt, les
Allemands lèvent aussitôt le camp et fuient dans le plus grand désordre, en faisant
sauter derrière eux les ponts qui enjambent la Meuse.[53] Mis au courant par radio du repli général
et de l'abandon de Maestricht, les défenseurs d'Eysden s'empressent, eux aussi,
de prendre la direction du Nord-Est pour se mettre à l'abri des ouvrages de la
ligne Siegfried. La voie est désormais libre pour la 30ème DI qui a
libéré la veille – comme nous le savons déjà – la cité de l'Oie.[54] Les événements vont dès lors se
précipiter. Hobbs qui a envoyé un avion de reconnaissance au-dessus de la
grande cité mosane et reçu de celui-ci un rapport des plus favorables, donne
aussitôt l'ordre à la Division de se mettre en marche et de descendre la vallée
de la Meuse. Elle va atteindre la rive droite de Maestricht le jour même sans
rencontrer le moindre obstacle et se mettre immédiatement à l'œuvre pour
construire un pont flottant. Celui-ci étant terminé dès le lendemain, les
célèbres G.I's vont libérer la rive gauche, la partie la plus importante de la
ville, en se promenant comme des touristes sous les acclamations de la
population en liesse. Ainsi la prestigieuse, la remarquable,
la vénérable ville de Maestricht, connue de nos jours dans le monde entier
suite à la signature en ses murs le 7 février 1992 de l'important traité
européen,[55] est miraculeusement et
définitivement sauvée. Elle doit son salut à un seul homme : l'humble, le
courageux, l'héroïque Nicolas Beaurieux, modeste habitant du petit village de
Roclenge-sur-Geer. Sans lui, elle eut été réduite en ruines comme le furent
bien des cités qui se trouvaient sur la route des Alliés et qui présentaient,
étant donné leur configuration, un réel danger pour nos libérateurs. Qu'est devenu Nicolas Beaurieux
entre-temps ? Après avoir fait ses adieux à ses nouveaux amis près de l'écluse
de Lanaye, il traverse le Canal Albert sur un canot pneumatique que les
Américains mettent spécialement à sa disposition. Ayant récupéré son vélo, il
gravit la forte pente qui le conduit sur le plateau à Eben-Emael, puis il
plonge dans la vallée du Geer, croisant sans arrêt des véhicules américains. Le
cœur léger, ayant le sentiment légitime d'avoir accompli son devoir, il pédale
allégrement vers son cher village de Roclenge-sur-Geer. Le temps de faire une brève apparition
chez lui où l'inquiétude était particulièrement grande et d'embrasser sa femme
et ses enfants il va, toujours guidé par le devoir, porter le précieux document
signé par Edmond Kersten au chef Goujon. Celui-ci s'empresse de le faire
parvenir immédiatement à l'Etat-Major américain. Mais ce n'est pas Goujon que
les Américains veulent voir, c'est notre héros, d'autant plus qu'ils
connaissent depuis des heures le contenu du document... Ils vont le chercher à
bord d'une Jeep. Nicolas habite dans une modeste maison située à 120 mètres à
peine, à vol d'oiseau, du château Colleye, une magnifique et somptueuse demeure
qu'occupe provisoirement son illustre voisin le Major-Général Hobbs. Nicolas est évidemment accueilli
chaleureusement. Interrogé par les officiers, il donne de précieux
renseignements aux Américains, du moins sur ce qu'il a pu observer à Maestricht
durant sa mission. Comme on lui demande ce qu'il désire comme récompense, il répond
modestement : "Une paire de
chaussures, car j'ai abîmé les miennes". On s'empresse aussitôt de lui
offrir des bottines de combat munies à la partie supérieure de guêtrons en
cuir.[56] Le temps des honneurs et… de l’oubli Ayant rempli sa périlleuse mission,
Nicolas Beaurieux reçoit un premier hommage dès le lendemain 14 septembre. Il
est félicité en ces termes par le chef Goujon devant tous les F.I. roclengeois.
"Il n'y avait que vous Beaurieux pour accomplir cette tâche et l'on ne
devra jamais oublier cet exploit surprenant. Je vous félicite de tout
cœur." Trois jours plus tard, ce sont des félicitations
autrement plus importantes qui lui sont adressées, puisqu'elles émanent du
Major-Général Hobbs en personne, par une lettre portée à son domicile. Ce document[57]
est d'une importance extraordinaire. Il démontre clairement que Nicolas
Beaurieux non seulement a sauvé la ville de Maestricht de la destruction et par
la même occasion de nombreuses vies humaines, mais il a permis en outre aux
troupes américaines "d'exécuter une avance considérable sans
obstacle" et donc sans la moindre perte également. C'est à coup sûr le
plus beau témoignage de reconnaissance qu'il reçoit. La presse régionale relate aussitôt cet
événement. Le lundi 25 septembre 1944, la "Gazette de Liège" consacre
un article particulièrement élogieux à Nicolas Beaurieux : « UN BEAU FAIT D'ARMES
À ROCLENGE/S/GEER C'est certes celui accompli
par notre compatriote Nicolas Beaurieux de Roclenge/s/Geer. Membre du F.I.
ayant à son actif pas mal d'actes de sabotage commis auparavant, Nicolas
Beaurieux fut chargé dans les premiers jours de la libération de porter à
Maestricht encore occupé, au chef de la résistance, une missive importante. Il
devait pour cela traverser le canal et passer à travers les troupes ennemies.
Il tenta d'arriver par Canne, fut mitraillé, contourna le fort d'Eben-Emael et
réussit, malgré de nouvelles mitraillades, à arriver à l'autre côté du canal.
Après s'être terré dans une cave où il passa la nuit, il se faufila au petit
jour à travers des obstacles sans nombre dans les lignes ennemies, d'où à
l'aide d'un brassard allemand, il parvint à échapper pour arriver à l'endroit
désigné et pour remettre au bourgmestre de Maestricht le pli dont il était
chargé. Son retour ne fut pas moins audacieux : malgré de nombreux coups de feu
dirigés contre lui, il revint chez lui sain et sauf, rassurer sa femme et ses
trois petits enfants. Le commandant des troupes américaines lui a adressé ses
félicitations et ses remerciements. Bravo à notre héros roclengeois qui a si
bien mérité de la patrie ! »[58] Le mercredi 27 septembre
1944, c'est au journal "La Meuse" de relater l'exploit accompli par
Nicolas, sous le titre : « COURAGE ET
PATRIOTISME « Roclenge-sur-Geer. Nicolas
Beaurieux, homme d'une grande bravoure patriotique, s'est présenté aux
autorités américaines pour porter un pli d'une extrême urgence, dans la nuit du
12 au 13 septembre, aux autorités et formations de résistance de la ville de
Maestricht. Pour ce faire, ce brave a traversé les lignes allemandes au péril
de sa vie et le surlendemain il était de retour porteur de la réponse. Le haut
commandement américain l'a remercié en ces termes : "Le Général commandant
les troupes américaines dans ce secteur me charge, en son nom, de vous
remercier et de vous adresser ses plus chaleureuses félicitations pour votre
admirable conduite. Votre courage et la ténacité que vous avez montrés durant
la dangereuse mission que vous avez acceptée sont dignes des plus hauts éloges,
et ont permis à nos troupes d'exécuter une avance considérable sans obstacle. »[59] Côté Maestricht, pas la moindre
réaction, ni durant les derniers mois de la guerre, encore moins après
celle-ci. Comment interpréter ce silence absolu ?
Comment expliquer que Nicolas Beaurieux soit ignoré à ce point, comme s'il
n'avait rien fait en faveur de la cité ? Edmond Kersten aurait-il oublié son
nom ? C'est possible compte tenu de son âge et surtout du stress insupportable
qui l'avait habité durant cette terrible nuit de la mi-septembre 1944. A-t-il également oublié le nom du
patelin d'où provenait le messager ? Mais dans ce cas, il aurait pu consulter
une carte de la région. Comme le Geer se jette dans la Meuse précisément à Maestricht,
il suffisait de remonter le cours de la petite rivière et le nom de
Roclenge-sur-Geer lui aurait sauté aux yeux. Puis se rendre dans le coquet
village et s'enquérir du nom du résistant qui avait risqué sa vie pour sauver
sa belle cité. Il est fort probable que le premier
habitant, qu'il aurait consulté, lui aurait donné des nouvelles de Nicolas,
l'exploit réalisé par celui-ci étant archiconnu dans la pittoresque vallée. Alors pourquoi ce silence, pourquoi
cette ingratitude ? Edmond Kersten, au cours de cette fameuse nuit, n'avait-il
pas noté le nom et l'adresse de Nicolas Beaurieux ? Ne lui avait-il pas
déclaré, en lui serrant la main, "cet acte de courage ne doit pas
s'oublier"? Pourquoi
l'ignorer maintenant, alors que la ville n'avait eu à déplorer que la
destruction de ses ponts ? Peut-être l'ex-bourgmestre f.f. et ses collègues,
qu'il avait convoqués chez lui, ne voulaient-ils pas que cet acte héroïque fût
connu de la population de Maestricht, de peur qu'on leur adressât de vifs
reproches de ne pas avoir pris contact avec l'ennemi ? Mais peut-on décemment leur tenir
rigueur de ce manque de courage ? Il est clair que si l'un d'eux s'était
dévoué, il y avait énormément de probabilités qu'il eût été fusillé. Si près de
la libération, il aurait fallu avoir énormément de cran pour oser se sacrifier.
Mais en tant que mandataires municipaux, ils avaient évidemment des responsabilités
envers leur cité, quel que fût le prix à payer ... Dès lors ils ont préféré
garder le silence puisque tout compte fait la ville n'avait pas été bombardée. Dans l'article publié en 1949, suite à
la réception enfin organisée en l'honneur de Nicolas Beaurieux, article auquel
j'ai déjà fait allusion, le journaliste écrit notamment : "Monsieur le Baron Michiels van Kessenich, bourgmestre, prononça
une allocution d'une haute élévation patriotique et relata l'exploit héroïque
de Nicolas Beaurieux. Il rappela avec émotion toute l'anxiété qu'avait fait naître,
à l'époque, le contenu du message, chose d'ailleurs ignorée jusqu'à présent,
car Monsieur Kersten, bourgmestre f.f. en 1944 n'en avait fait part qu'à
quelques personnes de confiance". En d'autres termes à ses
ex-collègues municipaux qu'il avait convoqués Lenculenstraat au cours de
la fameuse nuit pour essayer de trouver une solution et surtout un volontaire,
pour aller prier les Allemands d'abandonner la ville pour 7 heures du matin au
plus tard. Tout s'éclaire donc, tout s'explique. Mais
quant à oublier purement et simplement Nicolas Beaurieux, c'est une autre
affaire ...[60] Le principal intéressé n'en est pas
affecté pour autant. Quand on l'interroge à ce sujet, il hausse les épaules et
déclare qu'il a simplement accompli son devoir.[61]
Il a d'ailleurs repris ses activités d'avant-guerre. Il a retrouvé son
pont-roulant dans l'usine de Herstal, sur lequel il affiche chaque année, au moment
de la semaine sainte, un panneau avec ces mots : "Fais tes Pâques !".
Comme nous le savons déjà, il a été chargé en juillet 1946 par le bourgmestre
de détruire les "bêtes nuisibles" avec une arme à feu. Ce n'est donc
plus les fugitifs allemands qu'il pourchasse dans les bois, mais les renards et
les blaireaux, tout en s'offrant de temps en temps un beau faisan, un lapin ou
un gros lièvre. Il continue de jouer du bombardon dans la fanfare locale qui
anime les cramignons et il est devenu officiellement le porte-drapeau des
Anciens Combattants de Roclenge-sur-Geer. En outre il collectionne – c'est le cas
de le dire – les diplômes patriotiques qui lui sont attribués en fonction de
ses énormes mérites et les médailles y afférentes.[62]
Si Maestricht l'a égoïstement oublié, ce
n'est fort heureusement pas le cas des Alliés. Un beau jour, il reçoit un pli
émanant du Ministère de la Guerre à Londres. « Le grand Quartier Général des Forces
Expéditionnaires Alliées a décidé de remettre 315 diplômes à des Résistants
belges en reconnaissance des services exceptionnels qu'ils ont rendu à la cause
alliée, ce qui a beaucoup aidé au débarquement en Europe et à la marche des
combats qui suivirent. Vous figurez parmi ceux qui ont retenu l'attention du
Ministère de la Guerre pour avoir joué un rôle important à la libération de la
Belgique et j'ai, pour ce motif, l'honneur de vous envoyer le présent diplôme. Afin de tenir à jour la liste des noms, je vous
demanderais de signer et retourner le reçu ci-joint, à l'Ambassade Britannique,
à Bruxelles. J'ajouterais que le numéro de votre diplôme n'a aucun rapport avec
l'ordre de mérite. Au nom du Gouvernement de sa Majesté Britannique, je
vous adresse mes félicitations et vous remercie pour avoir contribué à la
victoire des Nations Unies. » Quant au diplôme, il est
fabuleux, étant donné qu'il est signé par le Général Eisenhower en personne. The name of Dwight Eisenhower C'est évidemment la
consécration pour Nicolas. Aussi la presse, une fois de plus, s'empare de l'événement
et publie plusieurs articles élogieux concernant notre Roclengeois. On peut
lire notamment dans la "Gazette de Liège" le texte suivant : « On sait que le G. Q. G. des Forces
expéditionnaires alliées a décidé de remettre 315 diplômes à des résistants
belges en reconnaissance de servi[1]ces
exceptionnels rendus à la cause alliée. Un de nos compatriotes, Nicolas Beaurieux
de Roclenge a reçu cette haute distinction. Nous adressons à ce héros nos
chaleureuses félicitations. Résistant de la première heure, Nicolas Beaurieux
n'a pas hésité lors de l'arrivée des troupes libératrices à se mettre à la
disposition du commandement allié. Connaissant parfaitement la région, il fut
chargé de porter un message au Q. G. de la Résistance Hollandaise à Maestricht.
Entièrement seul, il traverse les lignes ennemies au prix de difficultés sans
nombre. Son courage, son esprit de décision lui sauvèrent la vie dans maintes
situations délicates, et notamment dans la traversée du canal Albert sous le
feu allemand. Sa mission accomplie avec succès, il revint en rendre compte au
commandant allié, affrontant au retour les mêmes dangers qu'à l'aller. Humble
artisan de la Victoire, Nicolas Beaurieux a droit à toute notre reconnaissance
». Si l'obtention, par
Nicolas, du diplôme signé par le célèbre Général Eisenhower fait grand bruit
dans le petit village de la vallée du Geer, à 14 kilomètres de là, la ville de
Maestricht garde toujours le mutisme. Cette fois, c'en est trop pour Joseph
Groven, instituteur à Roclenge. Le 25 février 1948, il prend sa plume et écrit
au bourgmestre de Maestricht, en faveur de son illustre concitoyen. J'ignore le
contenu de sa requête, mais je possède la réponse du bourgmestre. Il est clair que la
missive de Joseph Groven a plongé le bourgmestre batave dans le plus grand
embarras. Tout d'abord il ne répond qu'après deux mois. Ensuite pour se dédouaner,
il laisse sous-entendre qu'ils avaient envisagé eux aussi d'organiser quelque
chose en faveur du résistant : "Puisque des souhaits pareils aux vôtres se
sont formés chez nous depuis longtemps ..." Enfin, il demande qu'on lui
fasse parvenir la documentation nécessaire, alors que la lettre du
Major-Général Hobbs est conservée dans les archives de la ville et qu'il peut
compter sur le précieux témoignage d'Edmond Kersten. Sans l'intervention de
Joseph Groven, il va sans dire que le souve[1]nir
de Nicolas Beaurieux eût été définitivement enterré ... Il n’empêche, cette fois
l’histoire est en marche, car la grande cité ne peut plus se dérober à ces
responsabilités. Il faudra cependant
patienter encore un an, avant que Nicolas Beaurieux soit officiellement honoré
par les édiles de la ville qu'il a sauvée de la destruction, au péril de sa
vie, lui le père de trois enfants. La cérémonie a lieu le 5
mai 1949 à l'hôtel de ville de Maestricht. Nicolas est assis au premier rang, à
côté de son épouse Catherine et de leurs trois filles, Thésa, Maggy et Lisette. Derrière eux se tient la
délégation de Roclenge, composée du bourgmestre Lambert Hardy, de Joseph et
d'Antoine Groven, de Nicolas Wilkin et du garde-champêtre Jean Hustinx. Assiste
également à la réception le consul de Belgique Monsieur Ubaghs. Le bourgmestre de Maestricht, le Baron
Michiels van Kessenich préside la cérémonie, entouré de ses échevins A. Bovy,
J. Sleede, J. Godfroy et F. Gybels. Le secrétaire communal P.
Rallen est également présent, de même que Edmond Kersten, bourgmestre f.f. en
1944, autre héros de cette fameuse nuit du 13 septembre 1944. Monsieur Minis,
chef de cabinet du bourgmestre, et trois membres de la Résistance hollandaise
complètent la délégation de la ville. Des représentants de la
presse écrite, tant francophone que néerlandaise, sont assis derrière les
invités pour relater l'événement. Enfin derrière tout ce
beau monde on remarque, accroché au mur, le portrait du Major-Général Leland
Stanford Hobbs, libérateur de Maestricht et autre protagoniste de
l'extraordinaire aventure. Le bourgmestre Michiels
van Kessenich prononce un long discours au cours duquel il relate d'abord
l'exploit héroïque accompli par Nicolas Beaurieux en faveur de la ville. Il
rappelle ensuite avec une certaine émotion toute l'angoisse qu'avait provoquée
le contenu particulièrement menaçant du message, par lequel les Américains
faisaient part de leur intention de bombarder la ville si les Allemands ne
l'évacuaient pas dans un très bref délai. Son allocution terminée,
le bourgmestre remet alors au héros du jour, "en témoignage de profonde
gratitude", la Médaille d'Or de la Libération (magnifique médaille avec
l'ange et l'étoile ; symboles de la ville) gravée au nom de Nicolas[64]
et ornée d'un ruban orange comme il se doit. Ensuite, il lui tend, sous les
applaudissements de l'assemblée, le diplôme d'honneur de la ville, spécialement
dessiné par un artiste local[65]
et signé par lui, les quatre échevins et le secrétaire communal. La Ville de Maestricht
C'est au tour de Nicolas
de prendre la parole et de prononcer un petit discours. « Monsieur le Bourgmestre,
Messieurs, Je vous remercie des paroles aimables et élogieuses que vous venez
de prononcer. L'honneur que vous me faites, je le partage avec mes camarades de
la "Résistance ", car nous étions tous unis dans un même idéal, dans
un même dévouement. Je suis heureux d'avoir rendu
service à la Hollande et aux Forces Alliées. Je n'avais pas oublié l'amitié qui
liait et lie encore davantage nos deux pays et l'accueil sympathique et
généreux qu'un grand nombre de mes compatriotes ont reçu ici pendant la guerre
1914-1918. Je garderai de cette manifestation
un souvenir vivace et ému. »[66] Le discours de Nicolas
Beaurieux touche au cœur tous les assistants, à la fois par sa modestie, sa
simplicité et le rappel du rôle qu'avaient joué les Pays-Bas, neutres durant le
premier conflit, par l'accueil chaleureux des patriotes belges fuyant
l'occupation brutale des Teutons. Aussi notre héros est-il applaudi longuement
par l'assemblée. C'est la fin de la cérémonie officielle, mais non de la
manifestation. La famille Beaurieux est priée de signer le livre d'or. Puis un
banquet réunit tous les invités dans un des plus grands hôtels de la ville. Dans une atmosphère de
franche cordialité et de profonde sympathie, le bourgmestre de Maestricht, le
Consul de Belgique et Monsieur Smits, résistant néerlandais, prennent
successivement la parole pour glorifier la résistance belge et pour célébrer
l'union fraternelle qui unit les deux pays. Monsieur Lambert Hardy, bourgmestre
de Roclenge, remercie alors la municipalité pour l'hommage rendu à l'un de ses
concitoyens et pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation de sa commune.
Une visite des principaux monuments de la ville, miraculeusement épargnés grâce
à la réussite de la mission confiée près de cinq ans plus tôt à Nicolas,
clôture cette journée mémorable. Tout à fait ravis, les
Roclengeois regagnent leur beau village. Quant à Nicolas Beaurieux, comme la
plupart des héros authentiques, il entre définitivement dans l'anonymat. Et maintenant quelques réflexions Nicolas Beaurieux sort brièvement de
l'anonymat le 13 septembre 2014 lors de la commémoration du 70ème
anniversaire de la libération de la ville de Maestricht par la 30ème
D.I. américaine. Le héros inconnu de Maestricht, comme
l'écrivait Vikkie Bartholomeus dans le journal De Limburger. C'est ce jour-là
que j'ai pris la décision d'écrire ce livre.[67]
En premier lieu pour sortir mon vieil ami Nicolas définitivement de l'oubli.
Mais également, il est vrai, pour répondre à la mauvaise foi de certains
historiens (!!!) néerlandais qui de nos jours encore tentent de minimiser le
rôle joué par notre héros dans le sauvetage de la cité. Ce qui les chiffonne tout d'abord, c'est
que le fameux message soit rédigé en français. Selon eux et pour cette seule
raison, la lettre n'émane pas du Major-Général Hobbs mais de la Résistance
belge qui voulait jouer un rôle dans la libération de la ville. Certes ils ne
contestent pas l'authenticité de la signature. Comment le pourraient-ils ? Mais
ils mettent en doute le contenu. D'ailleurs, affirment-ils, la meilleure preuve
que Hobbs n'a pas dicté ce message, c'est qu'il est écrit à la fin de celui-ci :
"Le Général se fera un plaisir de vous recevoir à son Quartier-Général,
quelle que soit l'heure de votre arrivée". Alors que, si la lettre était
de lui, il aurait écrit: "Je me ferai un plaisir de vous recevoir". Répondons point par point à ces
allégations fort légères, il est vrai ! L'initiative prise par Hobbs, de prier le
bourgmestre de faire évacuer la ville par l'ennemi qui l'occupe, constitue
incontestablement une "première" dans l'histoire militaire. Elle peut
surprendre étant donné que le premier magistrat de la cité n'avait aucun
pouvoir pour arriver à ses fins. Mais elle est bien réelle et non unique. La
même démarche sera utilisée par la suite pour les villes allemandes d'Aix-la-Chapelle
et de Braunschweig. Comme le résultat fut négatif, les deux villes furent
bombardées. Quant à la rédaction de la lettre en
français, cela s'explique tout simplement parce que les Américains
s'imaginaient que la ville de Maestricht était francophone. Sur la carte
américaine de la région, en ma possession, il est écrit au-dessus, en lettres
majuscules, MAASTRICHT à côté de FRANCE AND BELGIUM. En outre, si leur service
de documentation avait poussé plus loin ses investigations – ce dont je doute
cependant – il aurait découvert que Maestricht avait dépendu de la Principauté
de Liège durant des siècles ...[68]
Que la ville fût francophone était donc tout à fait plausible pour eux. En ce qui concerne la ridicule
affirmation que la "Résistance" de la vallée du Geer voulait jouer un
rôle dans la délivrance de la ville et qu'elle était dès lors à l'origine de la
rédaction du message, remarquons au passage que ses membres n'ignoraient pas
que Maestricht faisait partie des Pays-Bas et que c'était forcément en néerlandais
qu'il fallait rédiger la lettre ! Il ne manquait d'ailleurs pas de bons
traducteurs pour s'acquitter de cette tâche. Enfin
c'est mésestimer outrageusement le Major-Général Hobbs, commandant d'une
division américaine – et quelle division ! – de le croire capable d'apposer sa
signature, sans le moindre problème, sur n'importe quel document qu'on lui
présente. Et par la même occasion c'est surestimer les membres de la
"Résistance" de la vallée de leur prêter l'intention de vouloir jouer
un rôle dans la libération d'une ville aussi importante, alors qu'ils s'étaient
livrés jusque-là à des actes insensés, ridicules, dangereux pour la population
locale. Au moment où l'héroïque Beaurieux
remplissait sa mission au péril de sa vie, les F.I. du village de Wonck
fraîchement incorporés dans ce mouvement accomplissaient des actes autrement
plus dangereux : ils tondaient les cheveux d'une gamine et d'une femme mariée
originaire de Zutendaal qui s'étaient livrées à la collaboration horizontale.
Plus grave encore, ils marquaient, de croix gammées en noir, le visage de
Madame Hilderson, une Allemande qui habitait depuis longtemps dans le village
et qui avait durant toute la guerre tiré de fâcheux embarras plusieurs
habitants qui avaient eu maille à partir avec l'occupant. Pour toutes ces raisons,
il n'y a pas l'ombre d'un doute que le Major-Général Hobbs soit bien l'auteur,
et l'unique auteur de cette fameuse lettre adressée au bourgmestre de
Maestricht. Cette affaire étant
réglée, passons à des questions nettement plus intelligentes ! Le général
américain aurait-il mis ses menaces à exécution ? La réponse est : "sans
la moindre hésitation". La principale
préoccupation des officiers supérieurs américains était d'économiser – et on
les comprend – le maximum de vies parmi leurs soldats, tout en atteignant
évidemment leurs objectifs. Dès lors Hobbs n'aurait pas eu le moindre état
d'âme pour raser Maestricht compte tenu de sa situation stratégique[69]
et de ses défenses tant naturelles que militaires : Canal Albert, tranchées de
Caster et de Vroenhoven, Meuse, ancien canal Liège-Maestricht, ouvrages
défensifs, fort St-Pierre, remparts. Et il en avait les moyens
: l'artillerie lourde capable de tirer à 22 kilomètres était installée à
Zichen, Wonck, Bassenge et Houtain-Saint-Siméon, distants de 8 à 10 kilomètres
à vol d'oiseau du centre de Maestricht. De plus, il pouvait
compter sur les nombreuses formations de la R.A.F. et de l'U.S.A.F. qui depuis
des mois régnaient en souveraines dans les airs. Alors pourquoi avoir
rédigé cette lettre ? Hobbs était suffisamment intelligent pour se rendre
compte que le franchissement des lignes ennemies était une mission tout à fait
impossible et que dès lors sa lettre n'arriverait jamais à destination, surtout
dans un délai aussi bref. Mais alors pourquoi l'avoir quand même écrite ? Avant
tout pour se donner bonne conscience, si comme prévu les événements avaient mal
tourné. On devine aisément ses
commentaires après coup. « Je ne voulais
pas détruire Maestricht. Je voulais épargner à la ville et à ses habitants les
horreurs de la guerre. Si j'ai dû le faire, je le déplore. Mais j'ai tout fait
pour éviter cette catastrophe. J'ai envoyé un messager. Il n'a malheureusement
pu franchir les lignes. Ou bien il a été fait prisonnier. Ou encore il a été
tué au cours de la mission. Ce sont hélas ! les aléas de la guerre. J'ai donc
pris la décision à contrecœur de détruire la ville pour en déloger les
Allemands ». La meilleure preuve que
Hobbs ne croyait pas en la réussite de l'opération, c'est que ses officiers se
présentent à 14 heures 30, le 12 septembre, chez Nicolas Beaurieux, seize
heures et demie seulement avant l'expiration de l'ultimatum. Alors que le temps
presse, ils ne mettent aucun véhicule à sa disposition pour le conduire soit à
Kanne, soit à Lanaye où l'armée traverse le Canal Albert dans des canots
pneumatiques. Ils ne s'inquiètent même pas s'il a un moyen de locomotion. Tout
au plus ils lui remettent une médaille spéciale à exhiber s'il était arrêté en
chemin par leurs soldats et lui souhaitent bonne chance. Une formalité quoi ! Et pourtant l'impensable
va se produire : Nicolas Beaurieux contre toute attente, contre toute
probabilité réussit à franchir les lignes et cela par deux fois, ce qui lui
permet de signaler que le message est arrivé à destination et ce qui procure
ainsi un délai supplémentaire à la ville. Les Américains ont eu
énormément de chance en lui confiant cette mission, et de surcroît les
Maestrichtois ... Nicolas lui-même a bénéficié d'une incroyable baraka. Il
n'est atteint par aucun projectile. En situation délicate, il pense au brassard
allemand qu'il a en poche et qui va être déterminant dans la réussite de sa
mission. Enfin la première personne auprès de laquelle il se renseigne, un
batelier, lui fournit la bonne adresse et non celle du
bourgmestre-collaborateur en fuite depuis deux jours. En conclusion, ce n'est
pas une rue à Maestricht qui devrait porter le nom de Nicolas Beaurieux, mais
un monument devrait être érigé à sa mémoire. Dans un article intitulé "La
ville de Maestricht honore le résistant belge qui la sauva" un journaliste
écrivait en 1949 : « On peut donc
admettre sans être taxé d'exagération que la réussite de la mission confiée à
Nicolas Beaurieux a évité à Maestricht un bombardement "made in USA"
à la suite duquel il serait resté peu de chose de la ville ».[70] Deux pièces de monnaie française J’ai toujours entretenu d'excellentes
relations avec la famille Beaurieux, particulièrement avec Maggy. Un jour, dans
le courant de l'année 1994, elle me téléphone: "J'ai un service à te demander. Pourrais-tu m'aider ?" "Bien
entendu ! De quoi s'agit-il ?" Elle me raconte alors l'histoire des
deux pièces d'argent que son père avait ramassées près de l'avion français le
27 juin 1940. Elle les a retrouvées, en mettant de l'ordre, dans une ancienne
boîte de poudre de riz "Soir de Paris" appartenant à sa maman. Les paroles prononcées par son père ont
marqué la petite fille de 7 ans qu'elle était à cette époque: "Surtout qu'on n'y touche pas! C'est de
l'argent du brave aviateur français. 1/faudra le rendre à sa famille à la fin
de la guerre ". Cinquante-quatre ans après ce douloureux
événement, elle voudrait tenir la promesse faite par celui-ci. Hélas ! elle ne
connaît même pas l'identité du malheureux aviateur dont elle allait fleurir
régulièrement la tombe derrière le chœur de l'église, jusqu'à ce que les
autorités françaises viennent récupérer le corps. Nous entamons aussitôt de nombreuses et
patientes recherches. Maggy écrit plusieurs lettres en France. Quant à moi, je
vais consulter les archives de l'ancienne commune de Roclenge. Je passe des heures
entières dans les vieux dossiers sans le moindre résultat. Si au début du conflit, on n'a pas cru
devoir indiquer le nom et le grade éventuel de la victime sur un document,
j'espérais qu'au moins un petit rapport fût établi au moment de la récupération
de la dépouille mortelle. Maggy n'a reçu aucune réponse à ses
lettres. Elle est dès lors assez découragée. C'est la raison pour laquelle, en
ultime recours, je prends la décision d'écrire au Président de la République
Française, François Mitterrand. Je lui expose l'objet de notre démarche et lui
exprime notre espoir qu'en tant que combattant lui aussi de la deuxième guerre
mondiale, il aurait sûrement à cœur de nous aider en faveur d'un ancien frère
d'armes. Alors même que des centaines de
collaborateurs, tant civils que militaires, travaillent régulièrement au palais
de l'Elysée, on ne daigne même pas accuser réception de ma lettre. Ma déception
est profonde. Où est donc passée la courtoisie française, surtout à ce niveau ? Maggy cette fois est véritablement
inconsolable et je la comprends. Lorsqu'un beau jour, six mois après leur avoir
écrit, nous recevons une réponse des Anciens Combattants de France. Ils ont
retrouvé la trace de celui que nous cherchons. Il s'agit de Maurice RENAUDIE,
né à Paris le 4 juillet 1906. Sa fille unique, Liliane Renaudie épouse Boyer,
habite à Salon-de-Provence. Comme elle a bien voulu marquer son accord que nous
prenions contact avec elle, nous entrons immédiatement en relations. Maggy lui envoie aussitôt les deux
pièces de monnaie, toutes deux en argent, l'une de 20 francs de 1933 et l'autre
de 5 francs de 1876 en lui expliquant les circonstances dans lesquelles elles
avaient été découvertes par son père. Malgré la grande distance qui les sépare,
une franche amitié s'établit entre les deux femmes. Moi aussi j'entretiens une
correspondance suivie avec la fille du malheureux aviateur tombé à quelques
kilomètres à peine de mon village. A ma demande, Liliane Renaudie me fournit de
nombreux renseignements sur son père. Comme son frère Marcel, Maurice Renaudie
fait une brillante carrière dans l'Armée de l'Air. Après avoir fait la campagne
du Maroc, il est nommé secrétaire du commandant de la base du Bourget. A la
déclaration de guerre en septembre 1939, il est élève officier à l'école de
l'air de Salon-de-Provence où il est particulièrement bien noté. En mai 1940,
il est adjudant-chef aviateur à la 54ème escadre aérienne basée à La
Ferté-Gaucher et est mitrailleur à l'arrière d'un Breguet 693. Je m'informe aussitôt sur les
caractéristiques de cet appareil et la mission, dont avait été chargée la 54ème
escadre, au cours de laquelle le père de Liliane avait perdu la vie. Le Breguet 693 est un avion d'assaut
dont l'équipage est constitué d'un pilote et d'un mitrailleur. Il est armé d'un
canon de 20 mm, de 2 mitrailleuses à l'avant et de 2 à l'arrière, chacune de
7,5 mm, et peut transporter 8 bombes de 50 kilos. Le 10 mai 1940 à l'aube, les Allemands
déclenchent l'offensive contre l'Ouest. Grâce à une opération audacieuse menée
par des aéroportés à bord de planeurs, ils prennent intacts les ponts de
Vroenhoven et de Veldwezelt sur le Canal Albert et réduisent au silence le fort
d'Eben-Emael, le plus moderne des ouvrages fortifiés d'Europe. Le 12 mai les nouvelles du front sont
des plus alarmantes. Les Allemands ont fait une percée. Leurs convois motorisés
foncent sur la route Maestricht-Tongres. L'ordre est donné aussitôt aux avions
du groupe d'assaut 1/54 d'attaquer ces convois et le pont de Vroenhoven. Avant de monter à bord de son appareil
et de s'installer derrière ses mitrailleuses, Maurice Renaudie a un
pressentiment. Il serre contre son cœur la photo de son épouse et de sa fille
Liliane âgée de huit ans. "Je sais que je ne les reverrai plus" confie-t-il à un ami. A 13 heures 30, les colonnes allemandes
et le pont de Vroenhoven sont en vue. Protégés par des chasseurs, les Breguet
693 les uns après les autres foncent sur leurs cibles. Hélas ! la flak
allemande est particulièrement redoutable. La Luftwaffe intervient à son tour.
C'est un véritable carnage. Sur les 18 Breguet 693 engagés, 8 ne rentreront pas
à leur base. Soudain Maurice Renaudie s'écrie :
"Je suis touché". Le temps
que le pilote se retourne et lui dise "J'atterris",
Maurice Renaudie s'est affalé sur son siège. Tout l'arrière de l'avion est en
flammes. Le pilote parvient néanmoins à poser l'appareil train rentré et à s'en
dégager. Hélas ! pour Maurice Renaudie c'est fini.[71] Dix-huit heures plus tard, son frère
Marcel sera tué dans le Nord de la France, aux commandes de son avion de
chasse, après avoir abattu un avion ennemi. Ainsi en deux jours, les frères
Renaudie perdaient la vie au service de la France. Chose étonnante, lorsque Liliane a
montré les deux pièces d'argent[72]
à sa cousine, celle-ci lui a présenté exactement les deux mêmes qu'elle
conserve précieusement, étant donné qu'elles avaient été récupérées dans une
poche de l'uniforme de son défunt père. Comme les aviateurs sont superstitieux,
on peut imaginer qu'en septembre 1939, le père Renaudie les ait données à ses
deux fils, comme fétiche ou simplement porte-bonheur. Hélas ! le destin en a
décidé autrement... Liliane m'apprend encore dans une autre
lettre qu'elle n'avait jamais admis la mort de son père qu'elle adorait
par-dessus tout. Lorsqu'on a ramené son corps à Salon-de-Provence en 1966, elle
était persuadée qu'on avait mis de la terre belge dans le cercueil et qu'elle
reverrait un jour son père. Notre démarche avait malencontreusement ravivé chez
elle un fol espoir, comme dans certaines histoires où des soldats disparus
retrouvaient subitement leurs familles après des décennies de séparation. Une autre fois, Liliane m'émeut
particulièrement. Bien qu'ayant fait le sacrifice de sa vie pour la France, son
père ne figure sur aucun monument aux morts. A Salon-de-Provence, on prétend
que c'est à Paris de faire le nécessaire, étant donné que l'aviateur est né
dans la capitale et qu'il y résidait avec sa famille en 1940.[73]
A Paris, on affirme haut et fort, qu'au contraire c'est la municipalité
provençale qui doit l'honorer, dès lors que son corps repose à cet endroit. Scandalisé par ces mesquineries à peine
croyables, je promets solennellement à Liliane que le nom de Maurice Renaudie
sera inscrit sur un monument à Roclenge-sur-Geer, village à la limite duquel il
a trouvé la mort. Je lui écris que j'en fais une affaire personnelle, une
question d'honneur. Fin juin 1995, j'envoie un long article
au journal "La Meuse" qui le publie intégralement le 4 juillet sous
le titre : "Quand deux pièces de monnaie font du bonheur",
"Roger Hiance, passionné d'histoire de la guerre 40-45, nous raconte
comment les familles de deux héros – un aviateur français et un résistant
roclengeois – ont vu leur destin se rencontrer". L'article se termine de la façon
suivante : "Roger Hiance explique qu'il voudrait que cet épisode de la
guerre 40-45 n'en reste pas là". "J'aimerais, écrit-il, que les
autorités communales de Bassenge et les anciens combattants de la vallée du
Geer se souviennent à leur tour de cet événement en élevant, à Roclenge, un
monument commun aux deux héros. L'un, Parisien, Maurice Renaudie, qui sacrifia
sa vie pour que nous vivions libres, l'autre, Roclengeois, Nicolas Beaurieux,
qui risqua la sienne pour sauver la ville de Maestricht". Et le journal de
conclure: "Peut-être son frère, le bourgmestre de Bassenge, sera-t-il du
même avis ..." Hélas ! le résultat escompté n'est pas
au rendez-vous. Je ne renonce pas pour autant. Début 1996, je provoque une
réunion à Roclenge avec le bourgmestre et les représentants des Anciens Combattants
du village. Tous les participants approuvent mon projet. Mais lorsque survient
l'épineuse question de la prise en charge du coût du monument ou de la plaque
commémorative, l'enthousiasme du début s'estompe aussitôt. Les Anciens
Combattants signalent qu'ils n'ont pas les moyens de supporter une telle
dépense. Le bourgmestre, quant à lui, déclare que la Commune, elle non plus,
n'a pas de budget. Je me sens subitement piégé, moi qui ai
fait la promesse formelle à Liliane Renaudie que son père serait mis à
l'honneur à Roclenge. Le comble c'est que je me suis piégé moi-même. Je suis
déçu car j'espérais tout de même un geste des uns et des autres. Que faire ? Je
n'ai pas le choix. Après un long silence, je déclare que j'offrirai la plaque. L'atmosphère se détend aussitôt. Les
Anciens Combattants déclarent que lors de l'inauguration ils organiseront un
petit repas, payant bien sûr, mais qu'ils offriront au couple Boyer-Renaudie et
à celui de Maggy Beaurieux. Le bourgmestre signale que l'Administration
Communale offrira le vin d'honneur à l'issue de la cérémonie. Promesses qu'ils
tiendront scrupuleusement. A moi d'agir maintenant ! Comme je me
suis engagé à offrir la plaque commémorative, je me sens tout à fait libre de
rédiger moi-même le texte et d'unir ainsi dans le même souvenir, à la fois
Maurice Renaudie et Nicolas Beaurieux. Les époux Boyer-Renaudie arrivent de
leur Provence le 9 mai 1996. Nous sommes très heureux de pouvoir enfin les
accueillir. En compagnie de Maggy et de mon ami André Van Roy, je vais leur
montrer l'endroit exact où l'avion s'est posé et est resté de longues semaines
au milieu des champs. Puis nous nous rendons au cimetière de Roclenge dans
lequel Maurice Renaudie a reposé durant 26 ans. Maggy arrache un morceau de
bois de la vieille croix toujours en place et en très mauvais état, et le tend
à sa nouvelle amie Liliane. La
cérémonie officielle a lieu le samedi 11 mai 1996. Le bourgmestre, les échevins
et quelques conseillers communaux sont présents. On compte également une bonne
vingtaine de porte-drapeaux et autant de curieux. Le bourgmestre prononce un
discours, puis René Peters représentant les Anciens Combattants de Roclenge
souhaite la bienvenue à Liliane Renaudie et à son mari. Je prends également la
parole et rappelle les circonstances dans lesquelles Maurice Renaudie a trouvé
la mort le 12 mai 1940, il y a tout juste 56 ans, sans oublier d'évoquer
l'exploit héroïque de Nicolas Beaurieux accompli dans la nuit du 12 au 13
septembre 1944. Le moment est arrivé de dévoiler la
plaque fixée à gauche de l'entrée de la magnifique mairie. Maggy et Liliane
s'avancent et enlèvent les drapeaux belge et français qui la dissimulent. La
Marseillaise retentit aussitôt, suivie par la Brabançonne tandis que les drapeaux
s'inclinent. Des gerbes de fleurs sont déposées au pied de la plaque, puis
Maggy Beaurieux, à son tour, prononce un émouvant discours pour remercier les
organisateurs de cette belle manifestation patriotique. La cérémonie est terminée. Je lis une
intense émotion dans les yeux de Liliane et de Maggy, mais aussi énormément de
gratitude à mon égard. Je suis également fort ému, mais en même temps particulièrement
fier d'avoir pu à tout jamais mettre publiquement à l'honneur les noms de ces
deux héros. A LA MÉMOIRE DE
Roger
Hiance
31/03/2015 J'adresse mes vifs
remerciements R. Hiance [1]
"Journal d'un petit village sous la botte allemande" publié en 1977. [2]
The old hickory signifie le vieux noyer (blanc) d'Amérique. [3]
Mieux connues dans la région sous le vocable wallon " Lès trôs d' Wonck
" (Les trous de Wonck), ce sont en réalité d'anciennes carrières,
desquelles on extrayait des blocs de tuffeau et des pierres de silex utilisés
comme matériaux de construction. Les premières galeries remontent à l'époque
gallo-romaine. Creusées à flanc de colline, dans le Goffette et dans le Lovain,
elles constituent un véritable labyrinthe qui servit, de tout temps, de refuge
pour la population en cas de danger. De nos jours, on y voit encore les
mangeoires creusées dans le tuffeau, les sièges, et les couches aménagées
toutes à la même hauteur: 1,20 mètre, pour profiter de l'haleine des animaux
que les habitants emmenaient avec eux, dès que l'alerte était donnée dans le
village. Dans les grottes du Goffette, on découvre même des espèces de réduits
où les réfugiés d'autrefois conservaient leurs provisions. [4]
Il ne connaîtra jamais le contenu. Mon vieil ami Nicolas décédera le 2
septembre 1976, à l'âge de 73 ans. Je regretterai toujours de ne pas le lui
avoir révélé. Mais j'étais loin de m'imaginer que cet homme, encore si
vigoureux, allait décéder moins d'un an après. [5]
Roclenge, de même que Bassenge, Wonck et Eben-Emael faisaient partie de la
Province du Limbourg. C'était un héritage de la République Française et de
l'Empire. A cette époque, le pays avait été divisé en départements, qui avaient
généralement comme limites des frontières naturelles, constituées notamment par
des cours d'eau. Les communes de la vallée du Geer, ayant leur clocher sur la
rive gauche de la rivière, firent partie du département de la Meuse Inférieure
(Chef-lieu: Maestricht). Le territoire des provinces du Royaume des Pays-Bas,
puis du Royaume de Belgique fut en général calqué sur celui des anciens
départements français. Ces communes wallonnes de la vallée du Geer furent rattachées
à la Province de Liège le 1 er septembre 1963. [6]
Les services belge et allié de contre-espionnage avaient remarquablement
fonctionné. Dès le 9 mai au soir, le commandement belge avait été prévenu de
l'imminence de l'assaut. Le colonel allemand Oster et son ami intime, le
colonel Sas, attaché militaire néerlandais à Berlin, avaient dîné ensemble dans
la soirée du 9 mai. L'officier allemand confirma que l'ordre définitif avait
été donné de lancer l'attaque à l'Ouest, à l'aube le lendemain. Oster fit même
un saut après le dîner au Q.G. de l'O.K.W. (Oberkommando der Wehrmacht, ce qui
signifie : Haut Commandement de la Wehrmacht) pour être certain qu'il n'y avait
aucun changement de dernière heure. [7]
Beaucoup plus tard, lors d'une intéressante série de télévision, un membre de
la garnison, originaire des cantons de l'est, avouera qu'il s'était livré à des
actes de sabotage à l'intérieur du fort. Il ajouta qu'il n'était pas le seul... [8]
Il s'est effectivement rendu le samedi 11 mai à 11 heures 30. [9]
Mitraillette ou pistolet mitrailleur [10]
Les Allemands ont malheureusement découvert dans les grottes un important
équipement militaire abandonné par des soldats du 2ème Grenadiers et de la garnison du fort
d'Eben-Emael : des casques, des havresacs, des fusils et des cartouchières. Les
civils qui s'y trouvaient sont devenus immédiatement suspects aux yeux des
Allemands. Trente deux hommes, âgés de 16 à 40 ans, seront emmenés au stalag
XVIIA près de Vienne comme francs-tireurs. Finalement innocentés, ils ne retrouveront
la liberté et leur vallée que le 17 février 1941. [11]
Le Breguet 693 était un bombardier français dont l'équipage était composé de
deux aviateurs. La longueur de cet avion était de 9,67 m et l'envergure de
15,37 m. Son rayon d'action était de 1350 km et sa charge largable de 400 kg (8
bombes de 50 kg). C'est précisément le 12 mai 1940 que les Breguet 693
participèrent à leur premier engagement. Les résultats furent catastrophiques. [12]
" Wonck Mai 1940 " Roger Hiance (2007), page 288. [13]
La 6ème Armée allemande était
alors placée sous le commandement de Walter von Reichenau. Paulus en prit le
commandement, sur le front russe, le 20 janvier 1942, après la mort subite
(crise cardiaque) du Maréchal von Reichenau le 17 janvier, lequel commandait
depuis le 3 décembre 1941, à la fois le Groupe d'Armées Sud et la 6ème
Armée. Paulus fut chargé de prendre Stalingrad. Les Soviétiques lui opposèrent
une résistance farouche. La dernière poche de résistance de la 6ème Armée,
alors complètement encerclée à Stalingrad, déposa les armes le 2 février 1943.
Promu le 29 janvier à la dignité de Generalfeldmarschall, Paulus fut fait
prisonnier le lendemain. Lorsqu'il apprit la nouvelle, Hitler entra dans une
fureur indescriptible. "Paulus et
les membres de son état-major se sont déshonorés, vociféra-t-il, en préférant
la reddition au suicide". Scandalisés par les propos injustes tenus
par le Führer à l'égard de leur héroïque collègue, certains officiers
supérieurs comprirent dès ce moment qu'ils n'étaient dirigés que par un fou
sanguinaire et incompétent. [14]
Collection Roger Hiance. [15]
A cette époque le Canal Albert n'existe pas encore. [16]
La plus grande partie de ces déblais sera utilisée pour le rehaussement dans la
vallée de la Meuse [17]
Le premier bombardement massif des Britanniques a eu lieu sur Lübeck le 28 mars
1942 [18]
Les grottes de tuffeau du Lovain déjà citées. [19]
A la limite de Roclenge-sur-Geer. [20]
"Journal d'un petit village sous la botte allemande" - Roger Hiance
(1977), page 162. [21]
Tous ces renseignements m'ont été aimablement communiqués par René Torsin de
Boirs, qui inlassablement fait des recherches sur les avions abattus dans la
région. [22]
Bien que je n'étais âgé que de quatre ans et demi, je me souviens parfaitement
de ce corps allongé à mes pieds, que mon père avait tenu absolument à me
montrer. C'est mon premier souvenir de guerre. Louis Meex l'a reproduit dans un
dessin, orné d'une mèche de cheveux qu'il a coupée à l'infortuné. Plus tard, sa
veuve m'a donné ce précieux document. Comme, paraît-il, l'aviateur était très
basané, il pourrait s'agir de Datta Ramesh Shandra, Flying Officer (navigateur)
âgé de 32 ans et originaire de Calcutta (Indes) [23]
Le cadavre était méconnaissable. Complètement carbonisé, il n'avait même plus
la taille d'un mètre. Sur le muret, des débris humains ensanglantés
témoignaient de la violence du choc. Le pilote allemand sera tué trois semaines
plus tard, le 31 juillet 1943, abattu par un Mosquito britannique à Kerniel,
près de Tongres. (Renseignement communiqué par René Torsin) [24]
Cette anecdote m'a été communiquée par René Peters de Roclenge [25]
" Au revoir ! Et encore Joyeux Noël ! " [26]
L'anecdote du train des permissionnaires m'a été communiquée par Thierry Van
Delft, gendre de Nicolas Beaurieux. [27]
Les grottes du Goffette, contrairement à celles du Lovain, ne sont pas en
bordure du chemin fort encaissé, mais dominent celui-ci de près de 20 mètres.
Etant également en retrait d'environ 38 mètres, et cachées par un rideau
d'arbres et de buissons, elles sont difficilement repérables. A moins d'être particulièrement
bien informé, il est très malaisé de les découvrir. Pour y accéder il faut
escalader, en face de la dernière habitation, un étroit sentier zigzaguant dans
le talus. Pour s'y rendre avec un véhicule, il faut encore gravir, à partir de
la maison précitée, le chemin en forte pente du Goffette, sur une distance de
250 mètres. Là, une ouverture de 37 mètres de long, aménagée dans le talus,
aboutit dans la prairie où se trouvent les grottes. Celles-ci sont pourvues de
plusieurs entrées. En outre, un éboulement, qui s'est produit autrefois, permet
d'y descendre par les hauteurs. [28]
Dans leur précipitation, les partisans oublient des bâtons de dynamite dans le
talus. Après la guerre, deux jeunes garçons, pour jouer, mettent le feu à
celui-ci, provoquant une énorme explosion à quelques mètres d'eux, ce qui leur
vaut la peur de leur vie. [29]
Collection Roger Hiance. [30]
Collection Roger Hiance. [31]
Information communiquée par René Peters de Roclenge. [32]
Suite à une enquête, menée en 1946 par trente-cinq officiers américains à la
demande du Général Eisenhower, la 30ème Division d'infanterie sous
les ordres du Major-Général Hobbs fut déclarée la meilleure division américaine
qui ait combattu en Europe. [33]
Charges creuses: Bien que son principe ait été découvert dès 1888 par un
physicien américain, la charge creuse ne fut utilisée pour la première fois
comme arme de guerre que le 10 mai 1940, lors de l'attaque aéroportée du fort
d'Eben-Emael. Le principe de la charge creuse consiste dans le fait que la plus
grande partie de la force de l'explosion soit concentrée sur un point, ce qui
lui permet de transpercer un blindage en acier de 25 centimètres d'épaisseur.
Au contraire d'une charge conventionnelle qui produit comme un violent coup de
marteau sur l'objectif, la charge creuse agit par pénétration d'un dard en
fusion, fondant à une vitesse considérable le blindage qu'il rencontre. Le fort
d'Eben-Emael fut donc l'objet d'une première mondiale : attaque par planeurs et
par charges creuses. Ce qui explique qu'il fut réduit à l'impuissance en quelques
minutes ... [34]
L'ancien canal Liège-Maestricht. [35]
"Journal d'un petit village sous la botte allemande". Ibidem page 194 [36]
Extrait du rapport établi en 1946 sur la mission de Nicolas Beaurieux. Une
copie de ce rapport est conservée dans les archives de la ville de Maestricht. [37]
"Bonne chance!" [38]
Il mesure 2 m sur 2 m 30 et 1 m 93 de hauteur. Une mitrailleuse était pointée
vers Petit-Lanaye. Il est également pourvu d'un système pour laisser tomber des
grenades à l'extérieur. Des impacts de balles sur la porte et le garde-fou
au-dessus du canal témoignent de l'âpreté des combats. [39]
Dans son article du 13 septembre 2014 dans "De Limburger", la
journaliste Vikkie Bartholomeus écrit : "Le 120ème régiment d'infanterie signala en morse qu'un
citoyen belge fut arrêté à 19 heures 45, puis relâché après avoir montré la
lettre de Hobbs", [40]
A Petit-Lanaye, on trouve encore dans l'herbe cinq bittes d'amarrage, sur
l'accotement le long du chemin. [41]
La documentation au sujet de ce canal a été tirée du remarquable livre écrit
par Wil Lem et Rob Kamps : "Le canal de Liège à Maestricht – Un chenal
oublié". [42]
Dominé par le magnifique château de Caster datant du 18ème siècle,
Petit-Lanaye constituait le village favori des promeneurs venant de Maestricht.
Dans les années trente, il comptait au moins 15 cafés et 1 500 habitants [43]
Voir photo de la carte plus loin – Etat des lieux le 12 septembre 1944 [44]
Un jour sa fille Maggy l'entendit raconter son aventure à un vieux voisin. Il
disait : "C'est quelque chose
d'horrible de tuer un homme avec un couteau. C'est bien plus difficile que
d'abattre un ennemi avec un fusil. Mais je n'avais pas le choix. C'était moi ou
lui" [45]
Collection Roger Hiance. [46]
En réalité la place du Vrijthof, la plus grande de Maestricht. Elle fut
rebaptisée "Place d'Armes" après l'annexion française. Cette
dénomination resta longtemps ancrée dans les esprits, à tel point que de nos
jours, certains habitants de la Vallée du Geer l'appellent encore Place
d'Armes. [47]
Collection Roger Hiance. [48]
Originaire de Sint-Geertruid, la petite "Tru us" (Geertruida Loyens)
est née le 29 septembre 1930. [49]
Près de 60 ans plus tard, cette anecdote m'a été confirmée par Marcel Cluten de
Wonck, petit-neveu du vieil homme de Petit-Lanaye : "Après la guerre, mon
grand-oncle a déménagé à Liège. JI venait de temps en temps passer quelques
jours chez mes parents à Wonck. Un jour que je le reconduisais, sa valise sur
mon vélo pour prendre le tramway à Bassenge, nous avons croisé Nicolas
Beaurieux. Il venait à bicyclette en sifflotant. Le reconnaissant mon
grand-oncle a éclaté de colère. Le désignant du doigt, il s'est exclamé :
'Celui-là, il m'a volé ma viande à Petit-Lanaye.' Et de raconter les faits,
comme tu les as décrits dans ton premier livre." (Pour rappel publié en
1977 [50]
En septembre 2014, lors d'un reportage télévisé, le bourgmestre Onno Hoes a
déclaré qu'il aurait fait ce que le Major-Général Hobbs conseillait : prendre
contact avec les Allemands pour protéger la ville et les civils. [51]
Textuellement dans le rapport de 1946. [52]
Rosalina Rousch habite actuellement à Houtain-Saint-Siméon (Oupeye). [53]
Lorsque Nicolas Beaurieux fut reçu officiellement à Maestricht en 1949, la
presse francophone interrogea Edmond Kersten. Le journaliste écrivit notamment
: "Les Américains annonçaient leur intention de bombarder la ville de
Maestricht si les Allemands ne l'évacuaient pas dans un très bref délai.
Désirant éviter tout affolement, toute panique, tout en préservant sa cité, le
bourgmestre f.f fit sonner sans arrêt cloches et sirènes. Les Allemands,
croyant voir là le signal d'un soulèvement populaire, se hâtèrent d'abandonner
la ville." (Collection Roger Hiance) Raymond Kersten, né en 1922, fils
d'Edmond Kersten et de Jeanne Leroy m'a confirmé la péripétie des cloches et
des sirènes. [54]
La ville de Visé. [55]
La C.E.E. devient officiellement la Communauté européenne (C.E.) qui prévoit
notamment la mise en place d'une monnaie unique et la mise en œuvre d'une
politique étrangère et de sécurité commune. [56]
Collection Roger Hiance. [57]
J'ignore où se trouve l'original. Je possède néanmoins une photocopie de ce
précieux document. R.H. [58]
Collection Roger Hiance. [59]
Il est à noter que les deux articles font allusion à un pli destiné à la
Résistance, ce que Nicolas Beaurieux a toujours cru jusqu'à la fin de son
existence. [60]
Raymond Kersten, âgé aujourd'hui de plus de 93 ans, l'un des six fils d'Edmond,
m'a déclaré qu'il n'avait jamais compris qu'on eût fait si peu de cas avec
l'exploit réalisé par Nicolas [61]
Renseignement communiqué par René Peters de Roclenge. [62]
Collection Roger Hiance. [63]
Collection Roger Hiance. "Le nom de Monsieur Nicolas Beaurieux a été
enregistré au Quartier-Général Suprême de la Force Expéditionnaire Alliée comme
ayant été loué pour sa brave conduite, pendant qu'il agissait sous mes ordres à
la libération de son pays en 1944-45. Dwight Eisenhower - Le Commandant
Suprême". [64]
Collection Roger Hiance "De Stad Maastricht. Offert à Mr Nicolas Beaurieux
5 mai 1949" [65]
Collection Roger Hiance. Il est à remarquer que le diplôme reprend quelques
termes de la lettre de remerciement, adressée le 17 septembre 1944 par le 1er
Lieutenant Speer: " du courage et de la ténacité montrés ..." ou
encore "admirable conduite". C'est bien la preuve que Joseph Groven a
envoyé une copie de cette lettre, l'année précédente, pour servir de
documentation. [66]
Le discours, signé par Nicolas Beaurieux, est conservé dans les archives de
Maestricht. J'en possède une photocopie. (R.H.) [67]
Ce livre a pu être réalisé grâce aux entretiens que j'ai eus avec Nicolas
Beaurieux fin 1975 et avec sa fille Maggy par la suite. La collaboration de
Raymond Kersten, l'un des fils d'Edmond, et de Truus la petite servante m'a été
également fort précieuse. Enfin, l'importante documentation en ma possession
constituait évidemment un support particulièrement appréciable. [68]
Comme dans la plupart des "Bonnes Villes" de la Principauté de Liège,
l'hôtel de ville de Maestricht est accessible par deux remarquables escaliers,
un pour chaque bourgmestre, étant donné qu'à l'époque on en élisait deux et on
voulait ainsi éviter toute querelle de préséance. La ville a également un
perron, Place d'Armes, et compte de très nombreuses enseignes en français,
celles-ci particulièrement anciennes. [69]
La prise de Maestricht était indispensable car c'était la porte ouverte pour la
reconquête du Limbourg néerlandais et l'attaque de la ligne Siegfried. Le 6
octobre 1944, les Américains vont construire rapidement une jetée de terre sur
le Canal Albert à Kanne, à côté du pont détruit, pour permettre un passage
considérable d'artillerie lourde et de tanks. [70]
Les villes détruites par les Américains au cours de leur progression sont
particulièrement nombreuses. Ne citons que quelques exemples ! La vieille cité
corsaire de Saint[70]Malo, libérée le 14 août 1944, fut
complètement démolie à l'intérieur de ses remparts, après sept jours de siège
et de combats acharnés, alors que la garnison allemande était réduite au
minimum et que, pendant ce temps, les Alliés avançaient inexorablement vers
Paris... Mentionnons, plus près de
chez nous, plusieurs villes ardennaises au cours de la sanglante offensive von
Rundstedt en décembre 1944 et janvier 1945, dont notamment la cité de Malmedy
qui fut bombardée à trois reprises par l'aviation américaine, alors que les
Allemands l'avaient abandonnée depuis un certain temps ! Incontestablement
Maestricht l'a échappé belle ... [71]
Pierre Clostermann dans son livre "Feux du ciel", publié en 1951 aux
Editions Flammarion, raconte ce combat (pages 13 à 17) [72]
Liliane me donnera par la suite la pièce en argent de 20 francs de 1933. Je la
conserve précieusement dans l'ancienne boîte de poudre de riz "Soir de
Paris" dans laquelle elle est restée 55 ans [73]
Comble de malheur pour la famille Renaudie, la maison sera détruite par un
bombardement en mai 1940. |
© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©