 Maison du Souvenir
Maison du Souvenir

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Comment nous rendre visite
-
Comment nous rendre visite
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Le comité
-
Le comité
-
![]() Nos objectifs
-
Nos objectifs
-
![]() Articles
Articles
![]() Notre bibliothèque
-
Notre bibliothèque
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Photos
-
Photos
-
![]() Signer le Livre d'Or
-
Signer le Livre d'Or
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
In Memoriam Le 7 août
1944, une Belge de trente ans à peine était décapitée à la hache dans la prison
de Wolfenbüttel, après une longue captivité. Celle qui couronnait ainsi, par un
héroïque sacrifice, une tâche obscure de dévouement total à la cause sacrée de
la liberté des peuples, s’appelait Marguerite Bervoets. Ce nom n’est encore connu que d’une élite.
Il doit être glorieux demain, car c’est celui d’une héroïne qui rejoint dans le
sublime une Edith Cavell et une Gabrielle Petit. Marguerite
Bervoets : une héroïne[1] 
Marguerite Bervoets Les Grecs
élevaient au rang des demi-dieux ceux qui étaient tombés pour la patrie. Dante
les plaçait dans son Paradis immédiatement après les martyrs, confesseurs de
leur Dieu. Toujours,
dans toutes les civilisations, leurs noms furent magnifiés, leur histoire
servit à l’exaltation de la vertu. C’est que de leur sublime sacrifice se
dégage une beauté à jamais émouvante, qui force l’admiration et fait couler les
larmes. Notre
héroïne, Marguerite Bervoets, se place, elle aussi, dans cette élite dont un
pays s’honore. Je fis sa
connaissance, en 1929, alors qu’elle faisait partie de la classe de troisième
gréco-latine de l’Athénée de Mons, où j’enseignais à cette époque. Dès qu’elle
devint étudiante à l’Université de Bruxelles, elle prit l’habitude de me rendre
visite. C’était l’occasion de longs échanges de vues dont le caractère de
quiétude et de calme m’a toujours frappée, tant il contrastait avec l’habituel
fracas que faisaient, autour de moi et pour leur propre compte, mes jeunes
enfants. La
conversation se déroulait avec aisance. Ses travaux, son activité
d’enseignement, ses souvenirs, ses projets d’avenir, ses lectures étaient nos
thèmes favoris. Ces substantiels propos se déroulaient harmonieusement au sein
de cette toute familiale atmosphère qu’elle aimait retrouver. Au mois de
mars 1942, rentrant chez moi par une fin d’après-midi, je rencontrai Marguerite
comme elle quittait ma maison, où elle m’avait attendue durant plusieurs
heures. Cette fois-là, je n’eus avec elle qu’une conversation de quelques
minutes : ce devait être la dernière. Quelques
mois plus tard, j’apprenais sa détention à la prison de Mons et sa déportation
en Allemagne. Enfin, ce n’est qu’après l’écroulement de nos ennemis que je
connus sa fin tragique. Depuis
lors, j’ai maintes fois songé à ce que fut sa vie. Je la vois comme une courbe
régulière, sans heurt, dans une atmosphère de spiritualité et de courage. Elle est un
exemple. Il ne faut pas qu’on l’oublie, jamais. *** Marguerite,
Marie, Joséphine Bervoets naquit, le 6 mars 1914, à La Louvière. Ses premiers
souvenirs se rapportaient aux joies débordantes des fêtes qui marquèrent
l’armistice de 1918. Enfant unique de parents qui menaient une vie
particulièrement active, Marguerite acquit, dès ses premières années, une
relative indépendance, à la faveur de laquelle elle se forma une personnalité
qui demeura par la suite la marque essentielle de son caractère. Très tôt
apparurent, chez elle, des traits psychologiques assez significatifs, qui
pouvaient faire prévoir l’action héroïque qu’elle consentit librement plus
tard : à la poupée splendide dont on avait voulu émerveiller son enfance,
elle préférait des soldats de plomb, qu’elle avait coutume de ranger en vue d’un
imaginaire défilé de la victoire. De bonne heure également, ses goûts
s’affirmèrent : dans sa solitude d’enfant unique, elle se créait un
vocabulaire personnel, étendu au point de pouvoir y transposer, sans peine,
l’essentiel du langage ordinaire. Il était constitué de mots puérils, sonores à
souhait, que, plus tard, elle s’amusait parfois à rappeler lorsqu’ils se
prêtaient à la mélodie du vers qu’elle cherchait. De cette tendance – dont les
enfants sont coutumiers – mais particulièrement développée chez elle, est né
« Guibout », mot unique en lequel elle avait contracté les sonorités
de ses prénom et nom. Ses parents l’avaient adopté, et c’est par Guibout
qu’elle signa la seule lettre qu’elle leur écrivit de sa cellule, à la prison
de Mons. C’est par « Toutvit » aussi, mot qu’elle forgea dans le
secret de son petit cœur, qu’elle appelait sa chère et fidèle bonne, la Valérie
qui l’a élevée, qui l’a tant aimée et que Marguerite n’a cessé de chérir comme
une seconde maman. Quelques
années plus tard, Guibout fréquenta les classes primaires à l’Ecole moyenne de
La Louvière. A peine sut-elle former les lettres qu’elle essayait à écrire en
vers, témoin cette lettre qu’elle adressa à saint Nicolas (elle avait alors 7
ans) : Saint Nicolas, Excusez-moi, Voyez en moi Une petite fille Qui s’efforce d’être
gentille Pour obtenir du grand Saint, Distributeur de jouets aux
éblouissantes couleurs Les plus brillantes faveurs. Toutes ses
institutrices ont gardé d’elle un souvenir précis. Mme Lehardy-Masuy, Mlle Siraut,
ses premières éducatrices, ont deviné son caractère indépendant et fier. Mlle
François, qui lui enseigna en sixième primaire, nous fit d’elle un portrait
dont la fidélité s’avéra tout à fait conforme à ce que devait être l’avenir de
Marguerite : un amour illimité pour la lecture, un besoin de rédiger pour
son plaisir de menus faits dont elle avait été témoin, une indifférence totale
pour le calcul. Quant aux travaux manuels, Marguerite les subissait comme une
pénitence. Pas trop commode à diriger, elle s’imposait cependant, par son
intelligence et sa droiture, à la sympathie de ses maîtres, sympathie qu’elle
leur rendait, ainsi que le témoigne le texte ci-contre de la lettre, tout
empreinte de personnalité, qu’elle adressait à Mlle François, appelée à d’autres
fonctions. Mademoiselle, Je vous demande de bien vouloir m’excuser
de ne pas vous avoir écrit après la brève petite carte, peinte par moi, que je
vous ai envoyée. J’espère, Mademoiselle, que vous conserverez une bonne
impression de notre classe. Je fais meilleur ménage avec mes aiguilles et le
tricot et je ne suis pas en retard pour mes bas. Je continue à bien faire mes
rédactions ; j’en ai fait une bien jolie, cet après-midi ; elle était
intitulée : « Le Moineau ». Suzanne vous fait part de ses
meilleurs sentiments de respects. Adrienne et Renée continuent toutes deux à
progresser. Ma chère Demoiselle, je tiens à vous faire
savoir que l’on a plus (sic) congé au
carnaval. Que dites-vous du ministre qui a mis à exécution ce projet baroque et
insensé, imaginé ... par lui évidemment. Au revoir, Mademoiselle, je joins à cette
lettre mon adresse. Marguerite
entra en section moyenne. En deuxième et troisième années, elle éprouvait pour
Mlle Spitals, son professeur de français, une particulière affection. Elle
s’intéressait de plus en plus à la littérature. « Je la revois, nous
confie son professeur, vibrante au cours de français ; tout
l’intéressait ; mais elle manifestait surtout un goût prononcé pour la rédaction
et l’analyse littéraire, matières qui lui permettaient d’affirmer sa
personnalité déjà marquée. Je me souviens d’une causerie traitant de Verhaeren.
Les idées exprimées, le timbre de la voix, les yeux profonds m’avaient
frappée : je sentais que la fillette vibrait à l’unisson du grand poète,
de tous les poètes, d’ailleurs. » 
Maison natale de Marguerite. (photo Weder) Marguerite
fut par la suite, élève de la section d’Athénée du Centre. Même constance
dans les possibilités et les aspirations : elle continuait à montrer peu
de dispositions pour l’algèbre et pour la géométrie, mais se révélait
singulièrement douée pour les lettres. M. Michel,
son professeur de français en quatrième gréco-latine, nous la représente
instinctivement portée vers la poésie, irrésistiblement attirée par la valeur
musicale du vers. « Un jour, nous dit-il, comme je lui critiquais l’emploi
d’une expression inadéquate, afin de l’amener au terme exact, précis, j’
m’attirai cette réplique significative : « Mais, Monsieur, les mots
que j’ai employés sonnent si bien ! » Un an plus
tard, elle quittait l’Athénée du Centre et suivait les cours du Lycée de Mons,
que Mme Bervoets dirigeait avec une autorité, une amabilité, un charme enfin,
qui n’appartient qu’à elle. C’est à
cette époque que je fis la connaissance de Marguerite. Je revois encore sa
silhouette de jeune fille qui avait trop grandi : la femme s’annonçait
déjà par la stature et la prestance, alors que le visage, les gestes
demeuraient ceux d’une enfant. La grande fille en jupe plissée bleu marine, en
casaquin rouge, coiffée d’un béret alpin crânement collé sur l’oreille gauche,
allait devenir ma plus exceptionnelle élève, et plus tard ma plus fidèle amie. Au cours de
français, que j’avais le prestige de donner à cette époque, Marguerite était
toute attention. Durant certaines lectures que j’étais amenée à faire, ses yeux
brillaient d’un enthousiasme qui, tout en demeurant calme, raisonné, faisait
resplendir son regard. Je compris très vite ce qui la retenait rivée à ma
lecture : l’expression musicale de la phrase dans sa sonorité et son
rythme. Dès cette époque déjà, un sens esthétique du style, aussi aigu que
précoce, lui faisait apprécier la relation plus ou moins heureuse qui pouvait
exister entre le sens d’une phrase et la musique de son expression verbale. Elle
essayait à son tour de créer entre la forme et le sens, à l’occasion des sujets
de rédaction qui étaient proposés en classe, l’harmonieux rapport qu’elle avait
décelé dans les chefs-d’œuvre littéraires. Elle y réussissait souvent. Son
talent procura à ses condisciples et à moi-même des heures exquises, car les
rédactions de Marguerite étaient presque toujours du type de celles qu’il
convient, pour l’exemple, de lire devant une classe. Avant de se donner toute à
sa Patrie, elle donnait au cercle restreint de ses condisciples l’occasion
hautement spirituelle de s’émouvoir. Mais en même temps que se poursuivaient
ses études, au cours des années ultérieures passées à l’Athénée, le champ des
préoccupations de Marguerite, purement esthétiques d’abord, s’étendit au
domaine moral ; ses rédactions, qui nous avaient ravies, commencèrent à
faire penser. Aujourd’hui
seulement, je comprends pleinement quelle résonance avait dû éveiller en elle
le sujet d’une rédaction que j’avais proposé : « Plus est en
vous ». C’était à l’issue d’une excursion scolaire qui nous avait menées à
Bruges et au cours de laquelle nous avions visité la maison des Gruuthuus. En
une prose sobre, précise et élégante, Marguerite s’emparait de la devise de
cette grande famille, en faisait jaillir le sens profond et trahissait ainsi
une maturité d’esprit telle qu’elle me fit présumer, à cette époque déjà,
qu’elle avait l’habitude de se complaire dans un domaine moral supérieur. Ses
lectures confirmèrent mon opinion. Son professeur de morale, Mme Bellemans,
avait demandé un jour à ses élèves, quelle pensée, à leur sens, pouvait être
mise en exergue de leur vie. Elle fut frappée, dit-elle, de la réponse de
Marguerite, qui avait choisi dans La
Sagesse et la Destinée, de Maeterlinck, les deux extraits que voici : « Il n’y a qu’une chose qui ne se transforme
jamais en souffrance, c’est le bien que nous avons fait. » « Il est beau de savoir se sacrifier simplement
lorsque le sacrifice vient au devant de nous et qu’il apporte un bonheur
véritable aux autres hommes. » Les
professeurs de lettres n’étaient pas seuls à juger Marguerite, une élève de
choix. Son professeur de mathématiques, Mlle Degroot, quoiqu’elle reconnût que
les tendances intellectuelles de notre héroïne, déjà impérieusement sollicitées
par les lettres, cadraient assez peu avec les exigences rigides des sciences
exactes, voyait en elle, une élève d’une psychologie originale. « Au cours
de mathématiques, nous dit-elle, Marguerite était totalement absente ..., sans
répulsion, sans agressive animosité. L’air de dire : « Peut-être
bien... je vous suivrais, je vous accompagnerais un bout de route si j’en ai le
loisir, car vous semblez fervente et de bon vouloir... mais, voyez-vous, je
suis captivée ailleurs ! » 
Portrait d’enfance. (photo Séverin) Marguerite
avait seize ans, quand un jour elle vint à moi, avec une certaine timidité, une
certaine gaucherie dans les manières, dont elle ne se départit jamais tout à fait,
pour me présenter, sur un feuillet quadrillé, enlevé sans doute à quelque
cahier d’étude, sa première poésie, « Madrigal ». C’est par ce poème
que commence le recueil intitulé : « Chromatisme », qui réunit
sa production littéraire avant son entrée à l’Université. Cette œuvre de
première jeunesse, je la considère seulement au point de vue de l’aspect
psychologique qu’elle revêt. Des réminiscences nombreuses de chefs-d’œuvre
classiques montrent l’influence énorme qu’eurent sur elle l’école et la
lecture. Les images y foisonnent, rendues par des mots choisis pour leur
couleur, et qui appellent et expliquent le titre du recueil. Dans ces
chatoyantes évocations se synthétisent ses préoccupations esthétiques. A côté
d’audaces et de gaucheries puériles, certaine note grave acquiert aujourd’hui
une signification douloureuse : Je mourrai seul, sans bruit,
à la chute d’un soir. Poudré de ce
soleil qui sait combien je l’aime... Est-ce
aussi prescience qu’il soit question, dans la préface, du condamné à
mort ? En 1932,
Marguerite entra à l’Université de Bruxelles, à la Faculté de Philosophie et
Lettres, avec le dessein d’y poursuivre les études de philologie romane. Ce
fut, selon elle, avec les années passées à Mons, la période la plus heureuse de
sa vie. Toute sa conversation d’alors était l’écho de la joie profonde qu’elle
éprouvait à l’occasion de l’initiation qu’elle y recevait. Elle fut
une brillante élève. Elle obtint le grade de Licenciée en Philosophie et
Lettres, avec grande distinction, et celui de Candidate en droit[2].
Ces succès ne purent la consoler de quitter l’Université, où elle s’était
initiée à un labeur austère et passionnant. Aussi voulut-elle continuer sa vie
d’études en approfondissant, pour sa thèse de doctorat, son travail de licence
sur le poète André Fontainas. C’est alors qu’elle fit la connaissance de ce
poète dont l’œuvre l’avait si longtemps occupée ; elle entra même, à sa
plus grande joie, dans l’intimité de sa famille, et ce furent, pour elle, des
heures bien heureuses et bien claires. Esprit
large et curieux, heureux d’approfondir toute chose, elle partit sur ces
entrefaites pour l’Angleterre, en vue d’y acquérir une connaissance vivante de
la langue. Pendant un an, elle suivit les cours de l’Université du Cambridge,
qui lui décerna un certificat de connaissance de la langue anglaise
contemporaine. Rentrée en Belgique, elle fut nommée, en 1937, professeur à
l’école normale primaire de Tournai et professeur de littérature française à la
section des Régentes annexée à cette école. Elle fut un
professeur d’une valeur authentique et l’impression qu’elle laissa sur ses
élèves fut si profonde que, plusieurs années plus tard, l’une d’entre elles, se
souvenant de son ancien professeur, écrivit à Madame Bervoets, mère de
l’héroïne, cette lettre émouvante : ... J’ai d’elle une image exacte : Le
visage très doux, pâle, les yeux sombres, le maintien calme. Sa voix était
musicale, très basse... Je garde de cette voix un inoubliable souvenir. ... J’ai aimé Marguerite Bervoets avec
toute l’admiration, tout l’enthousiasme d’une jeune fille. Entrée à l’école
normale en 1937, j’ai eu le bonheur de suivre ses cours de français pendant une
année. Nous étions, mes camarades et moi, charmées par sa grâce, son
intelligence, sa bonté. Elle m’a influencée profondément pas sa
sensibilité, son tact, sa gentillesse. Elle m’a entraînée dans un monde de
poésie, d’art et d’idées. J’ai lu et relu « Chromatisme ». ... J’ai mis mon âme entière dans mes
pauvres rédactions de petite fille. Je les conserve encore pour les remarques
qu’elle y a faites. Elle me taquinait en me disant que je me laissais égarer
par la « Folle du logis »... qu’il fallait condenser. Je soignais
spécialement les brèves causeries qu’elle nous proposait. Enfin c’est bien elle
qui a développé en moi le goût de la vraie lecture. Je lui suis tellement reconnaissante
de m’avoir appris à m’évader ! Elles nous a aidées dans la formation d’un
rudiment de bibliothèque ; conseillant, grondant, souriant ; elle
nous habitua à rejeter ce qui était banal : C’est Théophile Gauthier, avec
son « Roman de la Momie » - je le possède encore paraphé M.B. par
elle – et « Emaux et Camées », qui nous plaisait le plus. Cette année donc, que j’ai vécue, à son
contact, a été exceptionnellement enrichissante pour notre esprit. * * * Mademoiselle Bervoets n’était pas un de ces
professeurs qui entrent en coup de vent, pointent une victime sur leur liste,
puis se « mettent en route » à une allure telle qu’on ne peut le
suivre que très peu. Elle
entrait sans bruit. Avec sa simple jupe brune, son pull un peu garçonnier. Elle
s’accoudait, parlait assez peu, mais très bien. Sa leçon était plutôt une
causerie, une conversation (nous pouvions l’interrompre et solliciter ses
explications). Elle avait une manière si personnelle de retenir notre
attention, de provoquer notre enthousiasme ! Comme j’aimais
l’écouter et comme je vibrais à ses paroles ! C’était une amie, une grande
sœur ... sans aucune familiarité pourtant. 
Prison de Wolfenbüttel où Marguerite fut décapitée. Je ne voyais en elle que pensée et que
rêve. Jamais je n’ai soupçonné en elle la guerrière, la résistante active. Ce
n’est qu’après son arrestation que j’ai pu m’expliquer ses arrivées trop
rapides, certains matins, en bottes poussiéreuses, quelque peu décoiffée aussi.
Quels dangers ne frôlait-elle pas alors ? ... Qu’il me suffise, enfin, de vous
assurer que mes jeunes élèves connaîtront et aimeront Marguerite Bervoets,
soldat et martyre. Qu’il me suffise de vous dire avec quelle tendresse, quel
respect, je présenterai son sacrifice à mes deux fils, quand le moment sera
venu. Puis-je enfin vous affirmer, Madame
Bervoets, que votre « petite fille » est lumineusement vivante dans
mon cœur. (S) C.
Beaucamp. Sa
puissance de travail, qui était considérable, lui permit de mener de front
l’enseignement, la thèse de doctorat, qui demeura pour elle un souci constant
jusqu’à son entrée dans la Résistance[3] et enfin une activité littéraire
marquée par la production de plusieurs poèmes et quelques contes en prose. Peu
nombreux en raison de ses occupations substantielles, ils sont la manifestation
d’un monde féerique dont seules l’obsèdent les visions picturales et nouvelles
qu’elle traduit par des mots sonores et vibrants, vraies trouvailles d’une âme
musicale. L’indépendance du caractère et le besoin de liberté lui ont fait
rejeter la contrainte de la rime et la métrique du vers classique. C’est sous
la forme du vers libre moderne que ses dernières productions nous parvinrent. Une telle
surabondance d’activité et de réalisation serait presque l’œuvre de toute une
vie, et pourtant Marguerite n’avait alors que vingt-six ans ! Grande,
forte, physiquement belle, elle avait banni de son existence toute futilité. En
dehors de ces occupations professionnelles et de ses recherches littéraires,
elle consacrait peu de temps à quelques déclassements du plus spirituel
éclectisme, parmi lesquels la musique était au premier plan. * * * Mais
l’horizon politique s’enténébrait de menaces précises. Sa nature sensible,
énergique voyait venir la crise tragique. Loin de se réfugier dans sa tour d’ivoire,
elle comprend que se dérober à l’action serait une preuve de faiblesse :
le don de soi est la plus belle affirmation de la vie. Rechercher la jouissance
égoïste, même lorsque celle-ci vient des plus pures sources de l’intelligence,
c’est, pense-t-elle, se priver d’espace et de grand air. Des les premiers
instants de la guerre, Marguerite se donne corps et âme à la cause de la
Liberté. Sa ligne de conduite sera tracée par les événements, mais son but,
dont la grandeur ne lui échappe pas, reste à jamais fixé. Lors des
bombardements de Tournai, elle dut quitter l’appartement qu’elle occupait
terrasse Saint-Brice. Elle y retourna quelque temps après et usa de son
influence pour relever le moral des uns, soutenir la rébellion des autres, se
lançant résolument dans une lutte que d’aucuns croyaient déjà perdue. Aux
timides comme aux persifleurs, elle lançait le mot de Cyrano « C’est bien
plus beau lorsque c’est inutile ! » Dès les
premiers mois de 1941 elle fit partie des mouvements organisés par la
Résistance. Son activité y fut débordante. Elle était de ces natures exigeantes
lorsqu’il s’agit du devoir, qui pensent avec Guynemer « qu’on n’a rien
donné quand on n’a pas tout donné ». Aussi, sans mesure comme sans
hésitations, elle se lança dans les périls glorieux où se consacrent les héros.
Par ses seuls moyens, à l’aide d’un matériel rudimentaire, elle fait paraître
un hebdomadaire clandestin : La
Délivrance. Elle me conta alors le plaisir qu’elle éprouvait à colorier à
l’aquarelle le drapeau belge qui illustrait la couverture. Elle fait partie de
l’armée secrète (la 803 à L.B., qui devint à la libération l’A.S.). D’abord
elle fut chargée d’obtenir et de transmettre au groupement de Bruxelles des
renseignements divers : troupes en garnison, passages de troupes, de matériel,
de trains, puis elle devint agent de liaison entre les groupements de
Résistance de Lille et de Tournai. Tandis qu’elle recrutait de nouveaux membres
pour le groupement dont elle faisait partie, elle consacrait tout son
dévouement à placer en lieux sûrs les parachutistes alliés, qui, descendus dans
le Nord de la France, étaient chargés d’établir un réseau serré et efficace
d’espionnage en vue du débarquement. Il lui parvint tout un arsenal d’armes de
guerre, dont elle pourvoyait ceux qui se chargeaient de supprimer les traîtres
particulièrement dangereux. Elle dépensa sans compter sa vie et ses ressources,
et même elle eut recours, lorsqu’il le fallut, à l’argent de ses parents, à qui
elle signait des reçus en règle et exigeait qu’ils les gardassent. A propos
des victoires allemandes de 1941 et 1942, elle me disait, non sans humour,
« ces Boches ressemblent à ces élèves qui font de bons devoirs, mais
jamais le devoir proposé ! » Elle estimait, en effet, que tous ces
succès allemands ne pourraient être définitifs s’ils n’atteignaient pas l’autre
côté de la Manche. Dès
décembre 1941, Marguerite dut avoir conscience de quelque grand danger, car, à
cette époque, elle me demanda d’être son exécutrice testamentaire. Elle me
remit deux plis cachetés, dont j’eus le douloureux devoir de prendre
connaissance le 22 juillet 1945, date à laquelle sa mort ne laissait plus aucun
doute. Août 1942.
Nous sommes dans les mois les plus mornes de la guerre ; dans l’ombre,
l’armée des résistants aide à forger la victoire, dans l’ardeur et la
discipline. Marguerite reçoit l’ordre de se procurer des photographies du champ
d’aviation de Chièvres. Elle part avec Mlle Cécile de Tournay, autre membre de
la Résistance tournaisienne, afin de remplir sa mission. Elles emportent avec
elles, car il faut tout prévoir, un sac à provisions. Vers 11 heures, alors
qu’elles s’emploient à photographier le champ, un Allemand surgit d’un fourré
où il s’était dissimulé, arrête les deux jeunes femmes, qu’il conduit devant un
officier, lequel procède à un interrogatoire serré. Elles expliquent avec
beaucoup de naturel que le but de leur visite à Chièvres était d’obtenir des
vivres qu’elles venaient d’acquérir dans une ferme voisine. Les photographies
prises étaient destinées à épuiser un film commencé, dont les premières photos
étaient des portraits. Les Allemands s’occupent de vérifier ces affirmations,
qui sont reconnues exactes. Toutefois, l’officier allemand, dans l’esprit
duquel un doute subsiste, décide de procéder à une perquisition au domicile des
inculpées. Rien n’est découvert au domicile de Mlle de Tournay. Par contre,
tout l’arsenal fut mis au jour dans l’appartement de Marguerite. 
Maison qu’habitait Marguerite à Tournai et où fut découvert son arsenal. Les
Allemands se rendirent compte qu’ils avaient mis la main sur une redoutable
espionne, et ils ne cachèrent pas leur joie. Elles
furent alors, toutes deux, conduites à Ath, puis à Tournai, où elles
comparurent devant un tribunal allemand qui siégeait à l’Hôtel de la
Cathédrale ; après quoi, elles furent incarcérées à la prison de Mons. Le soir
même, la Gestapo fit une descente au domicile de M. et Mme Bervoets. Ceux-ci
furent arrêtés, ainsi que leur vieux père et la fidèle Toutvit, qui se
trouvaient en leur compagnie. A l’exception de Mme Bervoets, tout le groupe fut
libéré le surlendemain. Mme Bervoets fut, en effet, retenue afin de fournir des
explications sur les reçus de sa fille trouvés dans son portefeuille. Mme
Bervoets déclara qu’elle avait été amenée à consentir à Marguerite quelques
avances importantes pour lui permettre de meubler son appartement à Tournai.
Grâce à la complicité de divers voisins de cellule, il fut possible de porter à
la connaissance de Marguerite les allégations de sa mère. Celle-ci fut libérée
cinq semaines après son arrestation et entreprit immédiatement de nombreuses
démarches afin d’alléger le sort de sa fille. Le seul résultat fut la remise à
Marguerite d’un unique paquet de vivres. Dans la suite, grâce au généreux
dévouement d’une religieuse attachée aux services de la prison, Mme Bervoets
obtint une poésie de sa fille, intitulée « Orphée ». L’élan lyrique
de ce poème témoigne du moral admirable de la captive. En juin
1943, Marguerite et sa compagne, Cécile de Tournay quittaient la prison de Mons
pour l’Allemagne par le convoi du 13 juin 1943. Elles vécurent six mois à la prison
d’Essen, soumises à un régime alimentaire qui leur accordait invariablement,
chaque jour, deux tranches de pain, deux tasses d’ersatz de café, quelques bols
d’une soupe aux rutabagas. On y vivait
nuit et jour dans un vacarme affreux que produisaient d’innombrables scies
mécaniques, foreuses et machines-outils d’une usine d’aviation installée dans
les sous-sols de la prison. Dans les
émanations de toutes espèces provenant de l’usine, le long d’un chemin bétonné
bordant une petite étendue de gazon, les prisonnières effectuaient, chaque jour
et par groupes, une promenade d’une vingtaine de minutes. Marguerite vivait, là
comme ailleurs, d’une vie profonde que n’altérait en rien l’atmosphère du lieu.
Elle y écrivit plusieurs poésies où il n’était question que de liberté
reconquise et de la vie sereine et constructive que connaîtrait l’humanité
après la défaite de l’Allemagne. En janvier
1944, à la suite des bombardements aériens infligés à Essen, la prison fut
évacuée. Marguerite et Mlle de Tournay furent, avec d’autres prisonnières
politiques, internées au camp de Mesum, non loin de Munster. La nourriture y
était insuffisante, l’hygiène douteuse. Le cachot servait d’infirmerie. Toutes
les vingt minutes, dans la cour, un groupe de prisonnières tournaient en rond,
les mains derrière le dos, sans pouvoir parler, sous la surveillance de deux
gardiennes. A Mesum, Marguerite n’écrivit pas, ou peu : « Que veux-tu
que j’écrive, confiait-elle à Mlle de Tournay, je n’ai plus l’ambiance... le
soleil, les fleurs, la musique... la liberté ! » Le 15 mars,
Marguerite et son amie furent transférées à la prison de Leer, pour y être jugées. Mlle de
Tournay nous a laissé un compte rendu fidèle de ce procès. « Le
mardi 22 mars 1944 l’heure du jugement est arrivée sans que nous ayons vu l’avocat
désigné d’office pour nous défendre. Vers huit heures et demie, nous partons
pour le Palais de Justice, attenant à la prison, escortées du chef et de deux
soldats, baïonnette au canon... Nous sommes introduites dans la salle d’audience,
les soldats se mettent au « garde à vous » : l’entrée des juges
est solennelle... Nous devons sortir et c’est à tour de rôle que nous serons
appelées et interrogées. Lorsque les interrogatoires sont terminés, commence le
réquisitoire public, qui est long, et où les griefs d’accusation semblent être
nombreux. Après la plaidoirie, qui fut courte et froide, le jury se retire pour
délibérer. Au bout d’une demi-heure d’attente anxieuse, le jury (Volksgericht) revient, et la sentence
est proclamée : Bervoets, condamnée à mort ; de Tournay, 8 ans de
travaux forcés. Les avocats s’approchent de nous et conseillent à la condamnée
à mort d’introduire son recours en grâce, qu’elle était, d’ailleurs, décidée à
solliciter. 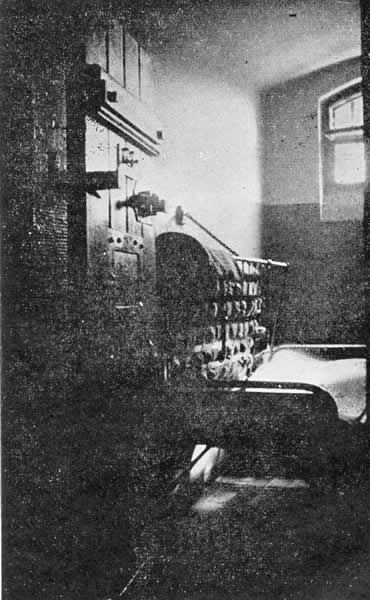
Cellule de Wolfenbüttel où Marguerite vécut ses dernières heures. (On y a retrouvé un graffite « Marg. Bervoets ») Marguerite
m’apprit par la suite que son avocat lui avait déclaré qu’elle avait eu tort de
jouer à la Jeanne d’Arc. Il est treize heures lorsque nous rentrons à la
prison. Le chef nous préviens que nous allons être séparées mais il nous laisse
ensemble jusqu’au souper. Nous savons que ces heures sont les dernières...
jusqu’à bien longtemps ! » Le soir
même du jugement, les deux amies furent définitivement séparées. Marguerite fut
dirigée vers une destination qu’il n’est pas possible, aujourd’hui, de
préciser. Cependant,
le 22 avril 1944, Mme Carlier, d’Hornu, qui fut une des compagnes de Marguerite
à la prison de Mons, la rencontra à la gare d’Osnabruck. Elles firent
temporairement partie du même convoi, qui la mena à Brême, où elles vécurent
ensemble deux jours. Mme Carlier rapporte que Marguerite n’avait rien perdu de
son courage, et elle ajoute quelques informations à celles qui sont déjà
connues : Marguerite lui confia qu’elle avait dû subir, pendant quinze
jours, les menottes... ... Un
officier allemand de sinistre réputation, du nom de Müller, lui avait, au cours
d’un interrogatoire en Belgique, posé cette question : « Si on vous
fusillait, que dirait-on à Tournai ? » Marguerite avait répondu sans
sourciller : « On penserait de moi ce qu’on a pensé de Gabrielle
Petit, et de vous ce qu’on continue de penser des officiers allemands qui l’ont
fait exécuter ! » De Divers
renseignements qui nous furent donnés, il semble résulter que Marguerite fut,
de Brême, dirigée vers Brunswick, où elle aurait séjourné à la prison de la
Gestapo. Elle y partageait une cellule avec une jeune femme française :
Mme Mathieu. Elles vécurent ensemble plusieurs mois. Et c’est le
7 août 1944[4] vers
13 heures qu’elles furent toutes deux emmenées à Wolfenbüttel, sous la garde d’une
geôlière, Emma Klünder. Elles furent emprisonnées dans une même cellule,
pendant plusieurs heures et autorisées à écrire à leurs parents une dernière
lettre, qui, d’ailleurs, ne leur est jamais parvenue. A 18 h. 34,
Marguerite fut décapitée. Ainsi s’ajoutait
une nouvelle martyre à la longue liste des victimes de la barbarie allemande ;
ainsi le monde libre comptait une héroïne de plus. * * * La nouvelle
de la fin tragique de Marguerite nous parvint le 22 juillet 1945. Elle
plongeait dans la douleur la plus cruelle ses parents et ses amis qui, tout en
comprenant la gravité de l’accusation, avaient gardé le ferme espoir de
retrouver celle dont tous les actes s’étaient uniquement inspirés du
patriotisme le plus pur. Je pris
connaissance, avec l’émotion que l’on devine, de la lettre qu’elle m’avait
adressée et qui accompagnait son testament. Cette lettre constitue une sorte de
testament moral : « Mon amie, Je vous ai
élue entre toutes, pour recueillir mes dernières volontés. Je sais, en effet,
que vous m’aimez assez pour les faire respecter de tous. On vous dira que je
suis morte inutilement, bêtement, en exalté. Ce sera la vérité... historique.
Il y en aura une autre. J’ai péri pour attester que l’on peut à la fois aimer
follement la vie et consentir à une mort nécessaire. A vous
incombe la tâche d’adoucir la douleur de ma mère. Dites-lui que je suis tombée
pour que le ciel de Belgique soit plus pur, pour que ceux qui me suivent,
puissent vivres libres comme je l’ai tant voulu moi-même ; que je ne
regrette rien malgré tout. A l’heure où je vous écris, j’attends calmement les
ordres qui me seront donnés. Que seront-ils ? Je ne le sais pas et c’est
pourquoi je vous écris l’adieu que ma mort doit vous livrer. C’est à des êtres
tels que vous qu’elle est tout entière dédiée, à des êtres qui pourront
renaître et réédifier. Et je songe à vos enfants qui seront libres demain.
Adieu. Marg. Bervoets. Le 13-11-41. » 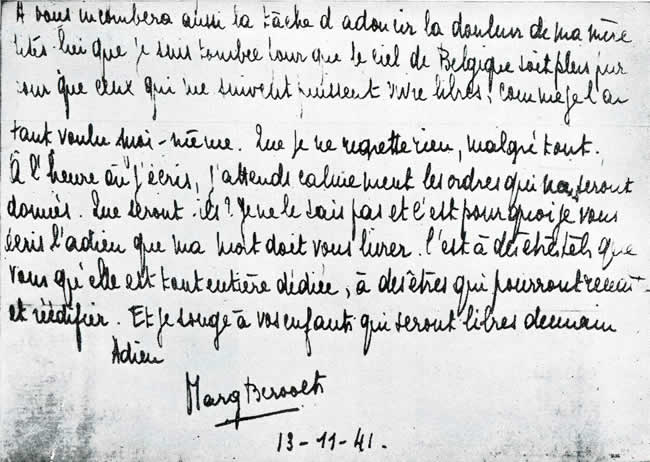
Testament moral de Marguerite Bervoets confié à son amie L. Balasse-De Guide. L’immense
tragédie que fut la guerre suscita des actes ignominieusement affreux, dont la
mémoire entretient au cœur de chacun de nous une perplexité troublante. Un
doute angoissant pèse sur l’espoir en un monde moralement meilleur. Des faits
sont là, implacables, qui banniraient l’espérance aussi irrémédiablement qu’aux
portes de l’Enfer dantesque, si quelques lumières ne s’allumaient dans la
longue nuit de nos misères pour nous rassurer et guider notre idéal. Marguerite
me paraît resplendir parmi elles. Elle est au nombre des êtres courageux,
tenaces, héroïques et sans peur qui se mirent en travers des desseins
démoniaques, et cela, par principe, sans intérêt matériel d’aucune sorte,
simplement parce qu’un idéal de haute splendeur morale était le point de
convergence vers lequel tendaient toutes ses actions. Au moment
où, en pleine liberté, Marguerite écrivait son testament moral, elle avait
vingt-sept ans. Par ses brillantes études, elle était entré dans l’élite
intellectuelle ; elle avait acquis, du point de vue social, une situation
qui, tout en réclamant d’elle un labeur qu’elle aimait, lui conférait le droit
à l’aisance. Elle était physiquement belle ; ses goûts affinés la
rendaient une femme accomplie, s’émouvant tendrement au contact de la vie. Elle
avait, par ses talents, été à l’aube de la célébrité. C’est dans
ces conditions qu’elle accepta de mourir « pour que le ciel de Belgique fût
plus pur. » Des âmes
aussi exceptionnelles se détachent à tel point de l’ambiance qu’on les croirait
surnaturelles ; pourtant elles prirent leur départ de nos labeurs, de
notre vie ; mais elles eurent foi en des principes sacrés, réalités
éternelles et humaines, et c’est là le secret de leur grandeur. Que valent nos
regrets, que signifient nos larmes ? De quel prestige plus grand les
tristes faveurs de ce monde auraient-elles auréolé son nom ? « Tôt ou
tard, nous ne jouissons que des âmes. » Celle de
Marguerite Bervoets, désormais sereine dans son ciel de gloire, entendra
toujours monter vers elle, et notre reconnaissance et notre amour. Lucienne Balasse-De Guide. [1] La Renaissance du Livre 12, Place du Petit Sablon, Bruxelles. Lucienne Balasse-De Guide [2] Elle obtint à la même université les diplômes d’histoire de la musique, avec distinction, et d’histoire de la peinture, avec la plus grande distinction. [3] La thèse de doctorat de Marguerite Bervoets, terminée avant son incarcération, a été publiée par les soins de l’Académie de langue et de littérature françaises. (Mémoires – Tome XVIII.) « L’œuvre d’André Fontainas » par Marguerite Bervoets, 1949 – Préface de Monsieur le Professeur G. Charlier. [4] Le service de rapatriement a donné, par erreur, la date du 9 août 1944. |
© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©
























